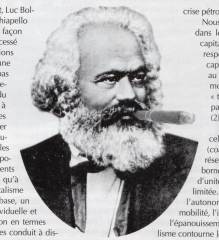
Alors que le monde devient globalement toujours plus riche, et que des masses financières toujours plus énormes circulent d'une place à l'autre, les écarts de revenus et de patrimoine ne cessent de grandir, tant entre les pays qu'à l'intérieur de chaque pays. Au sein des entreprises américains, le facteur multiplicatif entre le salaire moyen et le plus élevé est passé de 20 à 419 en l'espace de trente ans ! La fortune des trois personnes les plus riches du monde dépasse aujourd'hui à elle seule le montant de la production annuelle des 48 pays les plus pauvres, où vivent 700 millions d'habitants. Partout, le fossé s'accroît qui sépare les « connectés » et les « non-connectés », les élites financières et la masse des travailleurs précaires, petits salariés, chômeurs de longue durée, jeunes inactifs et sous-qualifiés. Cette nouvelle rupture sociale à l'échelle planétaire est elle aussi un fait nouveau.
Dans le même temps se met en place une élite « branchée », une « hyperclasse » (Jacques Attali) égoïste et volatile, dont les membres ne sont ni les entrepreneurs ni les capitalistes vieux style, mais des individus riches d'un actif nomade, qui détiennent le savoir, contrôlent les grands réseaux de communications, c'est-à-dire l'ensemble des instruments de production et de diffusion des biens culturels, et n'ont pas le moindre désir de diriger des affaires publiques dont ils connaissent mieux que personne le rôle de plus en plus limité.
« Il est indéniable, écrit Laurent Joffrin, qu'une "néo-bourgeoisie" domine désormais la société française, comme beaucoup d'autres sociétés démocratiques. Autant que par la fortune ou par l'occupation de places éminentes, cette nouvelle classe se distingue par sa mobilité. Mobilité professionnelle, intellectuelle, géographique. Concentrée dans les professions "qui bougent" la communication, la finance ou la technologie de pointe, elle détient le pouvoir symbolique autant que matériel, et par là les moyens d'influencer l'opinion. Elle fait partie d'un monde de la rapidité, de l'adaptation, de la concurrence, elle forme une humanité décontractée, internationale, tolérante, un brin cynique, à la culture cosmopolite et au pouvoir d'achat variable et élevé [...] Rien ne lui est plus étranger, au fond, que les frontières, les statuts, les garanties, les règlements, les interdictions, bref les protections qui semblent au commun des mortels une barrière indispensable face aux aléas de l'existence [...] À l'abri des vicissitudes d'une société soumise à l'ouverture et à l'anomie, protégée par ses sociétés de vigiles et ses stock-options, la nouvelle classe abandonne à son triste sort le peuple commun et taxe de "populisme" sa volonté de maintenir les anciennes protections » (22).
L'État-Providence se trouve frappé d'impuissance face à des capitaux volatiles
Face aux libéraux qui en tiennent pour le marché « autorégulateur », les dirigeants sociaux-démocrates prétendent réguler ou encadrer le néocapitalisme (23). Mais le peuvent-ils encore ? Les socialistes ont depuis longtemps abandonné l'idée d'appropriation collective des moyens de production (24). Le gouvernement de Lionel Jospin s'est opposé au rachat d'Orangina par Coca-Cola, mais il n'a empêché ni les licenciements chez Michelin ni la fermeture de l'usine Renault de Vilvorde. Quand le Premier ministre déclare vouloir que l'État s'engage dans une « politique industrielle vigoureuse », s'imagine-t-il vraiment qu'il en a les moyens ?
Qu'elles soient à vocation corrective ou redistributive, les tentatives sociales-démocrates, voire « libérales de gauche », pour trouver un compromis acceptable entre les impératifs de la vie sociale et démocratique, d'une part, et de l'autre l'hégémonie du marché et les exigences de la mondialisation, ne débouchent pratiquement sur rien. Dans la mesure où elles rapportent le niveau de bien-être à la seule richesse monétaire, loin de remettre en cause le modèle social dominant, elles renforcent même la centralité du travail rémunéré, continuant ainsi à s'inscrire dans le processus d'individualisation et de monétarisation de la vie sociale (25).
La vérité est que l'État-Providence a aujourd'hui de plus en plus de mal à intervenir dans le champ économique, ce dont se félicitent les libéraux, qui aspirent depuis longtemps à l'« impuissance publique ».
L'ancien capitalisme était encore ordonné à lai nation, dans la mesure où les profits des entreprises! étaient pour l'essentiel réalisés dans ce cadre, contribuant ainsi, indirectement au moins, à la puissance] nationale. Aujourd'hui, ces gains sont recherchés en dehors du cadre des États-nations, la conséquence! étant que le régime normatif du néocapitalisme vau indifféremment pour tous les pays. La mondialisation financière a déplacé la réalité du pouvoir économique du niveau des nations à celui de la planète, des entre prises classiques aux firmes transnationales, de la] sphère publique aux intérêts privés. Victimes de la puissance croissante et de l'internationalisation des marchés, les États n'ont plus les moyens d'une politique économique à long terme. La mobilité des investissements internationaux, qui ne cessent de se déplacer pour rechercher de meilleurs profits, limite directement leur capacité d'action, en particulier dans les domaines social et fiscal toute volonté de régulation qui ne va pas dans le sens des intérêts du capital est immédiatement sanctionnée par les délocalisations d'entreprises, l'expatriation des cadres et la fuite des capitaux. En Europe, plus de la moitié des décisions qui ont un effet direct sur le produit intérieur brut sont désormais de nature non gouvernementale. En France, la montée des dépenses obligatoires (dette, emploi, fonction publique) a de surcroît ramené de 43 % en 1990 à 12 % en 1998 les marges de manœuvres budgétaires réelles !
Wolfgang H. Reinicke a bien analysé ce décalage entre les États-nations, qui continuent à tirer leur légitimité du maintien de frontières qui n'arrêtent plus rien, et des marchés qui, autrefois dépendants du pouvoir politique comme des socialités locales, se retrouvent aujourd'hui émancipés de toute contrainte territoriale (26). La création de richesse, et même de monnaie, se fait désormais au-dessus des banques et des États, tandis que les échanges s'organisent pour échapper à toute fiscalité.
Ce serait donc une erreur de croire que l'expansion du néocapitalisme peut être enrayée par un État-nation pratiquant une sorte de keynésianisme rénové. Non seulement l'État est aujourd'hui de plus en plus impuissant, mais de plus, contrairement à une idée encore répandue, il y a longtemps qu'il ne représente plus l'intérêt général contre les intérêts particuliers. À bien des égards, il s'est même délibérément mis au service du marché. « Le succès du capitalisme est autant dû au rôle de l'État qu'à celui du marché », rappelle l'économiste Amartya Sen, Prix Nobel 1998. On s'étonne de voir une certaine gauche oublier ce rôle joué par l'État bourgeois dans la promotion du marché, en même temps que la « nature de classe » qu'elle lui attribuait autrefois.
Le système intègre ses anciennes valeurs de contestation
Dans leur livre, Boltanski et Chiapello s'interrogent également sur les raisons de l'affaiblissement des critiques portées naguère contre le capitalisme. Ils distinguent la « critique artiste » et la « critique sociale ». La première, caractéristique à la fois de l'anticapitalisme romantique et de la contestation libertaire de Mai 68, mettait surtout l'accent sur le caractère inauthentique du capitalisme, en critiquant la généralisation des valeurs marchandes engendrée par sa domination. Elle s'exprimait par une forte revendication d'autonomie et de créativité. La seconde s'en prenait plutôt à l'égoïsme du capital et à l'exploitation de la misère. Outil classique de la gauche et de l'extrême gauche depuis le xix6 siècle, elle se bornait à dénoncer l'injustice et à réclamer de meilleurs salaires et plus de sécurité.
Ces deux critiques, qui se complétaient sans se confondre, puisqu'elles visaient des formes d'aliénation différentes, sont aujourd'hui de toute évidence sur le déclin. L'incorporation des valeurs en vogue en Mai 68 (créativité, convivialité, dérision, etc.) à la dynamique du néocapitalisme, non pas tant du fait d'une stratégie délibérée (contrairement à ce que disent Boltanski et Chiapello) que comme le résultat d'un effet de symbiose, a largement désarmé la « critique artiste ». La « critique sociale », elle, a non seulement pâti de l'effondrement des théories ou des systèmes alternatifs, mais aussi de la montée de l'individualisme et de la désinstitutionnalisation, qui ont fait fondre les effectifs des syndicats et des partis.
Il ne fait pas de doute, enfin, que l'une des clés de la longévité du capitalisme réside dans sa capacité à se nourrir des critiques dont il fait l'objet, en se redéployant sous des formes nouvelles sans pour autant abandonner sa logique de perpétuelle accumulation du capital.
L'erreur de la critique sociale traditionnelle, telle qu'on la trouve encore aujourd'hui chez un Pierre Bourdieu, est d'en être restée à une conception archaïque des formes de la « domination ». Cette critique n'a pas pris la pleine mesure des « déplacements » opérés par la logique capitaliste au travers des délocalisations, du remplacement de la main-d'œuvre par les machines, de la disparition relative de l'ancienne classe ouvrière, et de la montée de l'actionnariat. Elle n'a pas su déceler les formes d'aliénation caractéristiques du nouveau monde des réseaux.
Les contradictions entre le capital et le travail n'ont pas disparu, mais elles ne jouent plus qu'un rôle ponctuel au regard de la rationalité d'ensemble du système. L'expansion du pouvoir des marchés n'entraîne plus simplement l'exploitation de la force de travail, mais induit une série de ruptures d'équilibre fondamentales, tant vis-à-vis du politique que de la diversité des formes de l'échange social. La monétarisation des rapports sociaux, en particulier, transforme et appauvrit le lien social d'une manière inédite, tandis que les institutions publiques sont progressivement frappées d'obsolescence.
Le fait nouveau est que le monde du travail a renoncé à renverser le capitalisme, en se bornant à vouloir l'aménager ou à le réformer. On continue à s'affronter sur la répartition de la plus-value, mais on ne discute plus de la meilleure façon de l'accumuler. C'est ce que Jacques Julliard a très justement appelé « l'intériorisation par les travailleurs de la logique capitaliste ». Ce qui semble ainsi disparaître, c'est un horizon de sens justifiant le projet de changer en profondeur la situation présente. En fait, tout le monde s'incline parce que personne ne croit plus à la possibilité d'une alternative. Le capitalisme est vécu comme un système imparfait, mais qui reste en dernière analyse le seul possible. Le sentiment se répand ainsi qu'il n'est plus possible d'en sortir. La vie sociale n'est plus vécue que sous l'horizon de la fatalité. Le triomphe du capitalisme réside avant tout dans ce fait d'apparaître comme quelque chose de fatal.
Il en résulte une lente conquête des esprits par les valeurs marchandes, inséparable de la colonisation par le marché de toutes les sphères de la vie sociale, les deux phénomènes prenant appui l'un sur l'autre et se renforçant mutuellement. Cette marchandisation généralisée de la vie humaine signifie que se trouvent désormais soumis à la logique du marché des domaines qui y échappaient jusqu'ici, au moins en partie. L'information, la culture, l'art, le sport, les soins aux personnes, les rapports sociaux en général, relèvent désormais du marché. L'instauration d'un marché des « droits à polluer » relève de la même logique. « Dès qu'une partie des activités d'un secteur est servie par le marché, observe Jacques Robin, tout le secteur tend vers la privatisation. Aussi voit-on s'engouffrer vers le marché toutes les activités ayant trait à l'éducation, à la santé, aux sports, aux arts, aux technosciences, aux relations humaines » (27).
À suivre