3. Les véritables enjeux du déficit et de la dette publique
Le débat sur la dette publique et la possibilité d'une défaillance de l’État est obscurci par le flou qui entoure la notion de dette.
La faillite résulte techniquement d'une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, le montant de la dette publique d'un État n'est qu'un aspect de la solidité ou de la vulnérabilité des économies développées.
Si effectivement, comme la plupart des ménages, l'Etat est titulaire d'un passif constitué de dettes, il possède également un actif infrastructures, immobilier, actifs financiers. Même si ces derniers ne sont pas directement mobilisables en paiement des dettes, une partie de ce patrimoine public est évaluable et évalué dans les comptes nationaux, ce qui implique une référence à un prix de marché et donc à la possibilité, au moins théorique, d'une cession de ces actifs. Les privatisations ne sont qu'une modalité de monétisation de ce patrimoine, ce qui pose par ailleurs d'autres problèmes (notamment de politique industrielle). En outre, une partie de ce patrimoine ne figure pas dans un bilan patrimonial et se diffuse dans l'économie productivité du travail (dépenses dans l'enseignement supérieur), expertise technologique (efforts publics de recherche et développement), niveau de vie...
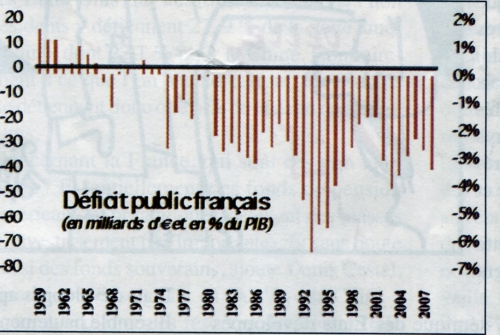
L endettement n est donc pas toujours un signe de fragilité. Lorsqu'elle est la contrepartie d'investissements productifs et pas une simple manière de financer les dépenses courantes, la dette est au contraire une décision productive.
Chaque contribuable, s'il est abstraitement redevable d'une partie de la dette de l'Etat de son pays, est tout aussi abstraitement possesseur d'une fraction du patrimoine public, qui s'ajoute à l'épargne privée des résidents du pays en question. Un État endetté peuplé d'épargnants n'est pas vulnérable.
Le niveau critique d'endettement est lié aux spécificités culturelles des États
La comparaison entre l'Etat et les ménages s'arrête ici puisque leurs horizons temporels diffèrent radicalement; contrairement à un ménage qui doit rembourser l'emprunt contracté pour l'achat de son appartement avant sa disparition, l’État ne disparaît pas. Ce qui signifie qu'il peut maintenir un endettement constant.
L'inquiétude peut provenir, non pas de la créance, mais du créancier 59 % : de la dette publique française est détenue par des non-résidents, alors que la dette publique américaine, bien que colossale, est détenue à 72 % par des résidents (entreprises et ménages) américains. Et au sein des 28 % restants, le Japon et la Chine occupent des places prépondérantes et équivalentes. La répartition de la dette publique entre les différents créanciers possède plus d'implications géo-économiques que le montant lui-même : l’épargne chinoise s'investit autant dans la dette publique américaine que dans le capital des entreprises européennes. La Chine a autant intérêt que les Occidentaux eux-mêmes à la pérennité de la stabilité de leurs économies…
Au-delà des chiffres astronomiques, la taille et la structure du budget des États modernes est la conséquence d'un choix collectif. Il n’existe pas de fatalité à l’endettement public, les dépenses sont des choix politiques, reflet d'une certaine vision du lien social et indicateur de la solidarité entre les membres d'une nation. Il pourrait arriver que les États développés connaissent un niveau d'endettement si élevé qu'il implique un renoncement aux dépenses publiques nécessaires à assurer la cohésion sociale. Ce niveau critique n'est pas universel, mais relève des spécificités culturelles des différents États et varie en fonction des pays puisqu'il dépend essentiellement de la représentation que se font les individus du rôle et de la place de l’État dans la vie sociale, néanmoins que se passerait-il si leur dette publique atteint ce niveau d'endettement irrémédiable ?
Évoquer la possibilité d'une faillite systémique des États développés revient a minima à discuter de la légitimité de l'intervention de l’État dans l’économie et a maxima à discuter de la nécessité même de l’État.
4. Quid d'une faillite générale des États ?
Tel un épouvantail, le spectre d'une faillite générale des grands États resurgit de manière invariante à chaque crise économique internationale majeure, jusqu'alors, les faillites souveraines frappent surtout des États isolés ou les économies émergentes. À titre d'exemple, les États d'Afrique subsaharienne vivent, pour des raisons historiques, dans une situation de cessation des paiements chronique, qui obligent les créanciers internationaux (Club de Paris) à renégocier, rééchelonner et annuler une partie de leurs séances. La crise mexicaine de 1994 ou la situation préoccupante de l’État de Californie en 2008 sont les exemples les plus frappants de la réalité de la menace de banqueroute qui pèse individuellement sur un État. La question prend un tout autre relief quand il s'agit d'envisager la question d'une faillite collective des États les plus puissants.
Cette peur contemporaine de l'incapacité de l’État à assumer sa place dans la sphère économique, quasiment synonyme d'apocalypse, révèle avant tout le caractère historique de notre conception moderne du rôle de l’État. La possibilité même de la faillite d'un État comme la France est tributaire de l'existence d'une structure particulière, liée à la modernité juridique et politique, garante de la souveraineté de la collectivité particulière que l’État-nation a vocation à incarner.
L’État garant de la stabilité du corps social
C’est donc une appréciation collective, puisant ses déterminants dans la culture et l'histoire singulière des peuples, qui explique les contours différents de l'intérêt général et des moyens qui lui sont affectés. Le passage de l’État-gendarme, cantonné aux fonctions régaliennes, à L’État-providence, est intervenu en Europe à une période où le développement économique et les circonstances sociales requéraient une extension des prérogatives de l’État. Ces prérogatives sont aujourd'hui mises à mal par de nouvelles circonstances économiques, contredisant leur mise en œuvre : la prise en charge par la solidarité nationale du processus de « libération de l'homme du besoin » est devenue très coûteuse parce qu'elle repose sur des équilibres démographiques et sociaux historiquement datés, qui sont aujourd'hui menacés.
Cependant, on doit souscrire à la justification d'un État même minimal, qui passe par la nécessité d'assurer le respect des droits de propriété en transférant à un tiers « le monopole de la violence légitime », selon la formule de Max Weber. La possibilité d'une économie repose tout entière sur l'assurance que ces droits de propriété sont garantis. La faillite de l’État, et donc la disparition du monopole de la violence légitime, laisseraient prévoir un avenir troublé. C'est parce que nous avons conçu l’État (au-delà des choix concernant les formes institutionnelles concrètes de son intervention : minimales pour la pensée libérale maximales pour la pensée absolutiste) comme le dépositaire de l'intérêt gêné et le garant de la stabilité du corps social et de l'équilibre politique que la faillite des États développés apparaîtrait comme tragique.
Il semble hautement improbable qu'une faillite générale frappe les États développés en même temps. Dans un contexte de mondialisation économique, une telle faillite traduirait en définitive un échec plus profond d'ordre politique et culturel. Ce serait le constat de l'artificialité des liens qui unissaient des individus entre eux, ou au moins de leur caractère contingent, irrémédiablement lié aux circonstances changeantes de l'Histoire. Les conséquences politiques d'un tel bouleversement seraient difficiles à prévoir.
Antoine Michel monde & vie 25 avril 2009 n° 810