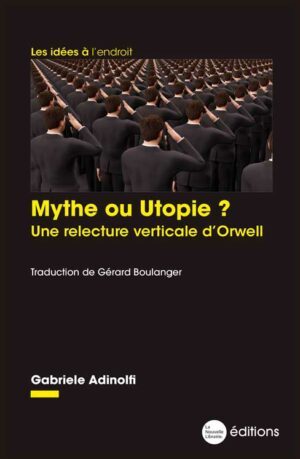ÉLÉMENTS : Pourquoi s’être intéressé à Orwell et avoir réalisé cette relecture ?
GÉRARD BOULANGER. Cette relecture a des raisons conjoncturelles. En effet, l’arrivée dans le domaine public de l’œuvre de George Orwell, en 2020, a donné lieu en Italie à de nombreuses rééditions et exégèses où la révérence, sinon le dithyrambe, étaient en général de mise, qu’il s’agisse de saluer le paladin de l’antifascisme ou le contempteur des « crapules staliniennes ». S’il fut assurément l’un et l’autre, Orwell méritait mieux que de paresseuses génuflexions bien-pensantes ! Or, quel plus bel hommage lui rendre que cette confrontation – même s’il n’en sort pas victorieux – avec des auteurs tels que Nietzsche, Evola, Jünger et Guénon ?
ÉLÉMENTS : En quoi Orwell se distingue-t-il des autres auteurs classiques d’utopies ?
GÉRARD BOULANGER. De fait, ce que Orwell nous décrit n’est pas une anticipation d’un monde terrifiant à venir : nous ne sommes pas dans le domaine de la science-fiction. En cela, il se distingue absolument d’un Zamiatine (Nous autres) ou d’un Wells (Le meilleur des mondes) et ses compagnons de route – dans tous les sens du terme – sont bien d’avantage le London du Talon de fer et le Koestler du Zéro et l’infini.
George Orwell ne fait pas œuvre d’imagination, mais d’observation : tout autant que Hommage à la Catalogne et La ferme des animaux, c’est l’actualité présente que nous décrit Mil neuf cent quatre- vingt-quatre. Comme le relève son traducteur Philippe Jarowski dans son excellente préface : « Ses premiers lecteurs ne s’y sont pas trompés, qui n’ont pas eu de peine à reconnaître, dans le Londres de la Zone aérienne n° 1, la capitale anglaise de l’après-guerre. »
On pourrait ajouter que les mêmes n’avaient aucun mal non plus à assimiler le « néoparle » orwellien au bourrage de crâne du War Office qu’ils avaient dû subir pendant cinq ans ! Encore fallait-il avoir des yeux pour le voir et des oreilles pour l’entendre, et c’est précisément ce à quoi Gabriele Adinolfi nous invite à son tour.
ÉLÉMENTS : Beaucoup ont souligné le pessimisme tragique de George Orwell. Ne fait-il pas écho à celui des penseurs de la Tradition ?
GÉRARD BOULANGER. Pour nous en tenir à Evola, voici en effet quels sont les premiers mots de son fameux Orientations : « Il est inutile de se faire des illusions avec les chimères d’un quelconque optimisme : nous nous trouvons aujourd’hui à la fin d’un cycle. » Pour autant, cette analyse ne débouche sur aucune forme de soumission à un prétendu « sens de l’histoire », comme le montrent les dernières lignes du même texte : « L’homme nouveau, l’homme de la résistance, l’homme au milieu des ruines : c’est à cet homme, et à lui seul, qu’appartient l’avenir. » Ce volontarisme est certes absent chez Guénon, mais on le retrouve chez Jünger : si le Rebelle et l’Anarque partagent le même constat sans illusions des dévastations irrémédiables causées par le Léviathan totalitaire, ils refusent eux aussi tout fatalisme : ce n’est pas à la résignation mais bien à l’action qu’ils nous appellent.
En termes de vision du monde, un gouffre sépare cette phrase de Jünger : « Il n’y a de décisif que l’individu qui se bat à contre-courant », qui résonne comme un joyeux cri de guerre, de celle-ci d’Orwell : « Nous ne gagnerons pas. Certains échecs valent mieux que d’autres, c’est tout », qui a les accents lugubres d’une épitaphe.
Propos recueillis par Laurent Vergniaud