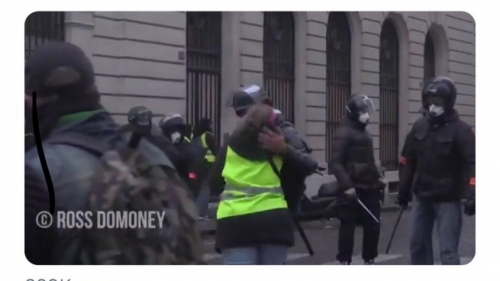
On connaissait les fausses factures. Il y a aussi les fausses fractures. Celles qui ne sont qu’apparentes.
Les réseaux sociaux ont ubérisé les chaînes d’information continue. Dit autrement, mon épicière peut s’improviser reporter. Chaque acte des gilets jaunes, par exemple, est couvert par une fourmilière de journalistes du dimanche – enfin, du samedi – dispersés dans la foule, saisissant ces instants fugitifs insolites qui, il y a encore dix ans, seraient passés inaperçus, restés hors des écrans radar de la presse.
C’est ainsi qu’une petite vidéo très courte, prise par un Anglais se définissant comme « sometimes a journalist », a été vue près de 830.000 fois. La scène se passe sur les Champs-Élysées. L’ambiance est tendue, des policiers casqués, armés de Flash-Ball®, avancent dans les fumées des grenades lacrymogènes, des manifestants les croisent qui courent pour leur échapper. Soudain, un policier s’arrête, marquant un mouvement de surprise. Il a reconnu une jeune femme parmi les gilets jaunes. Elle aussi a stoppé net. Il lui tend les bras et elle accourt. Ils s’embrassent. Pas un baiser follement romantique ou une accolade théâtrale pour la caméra. Non, ils se font la bise, comme on dit dans le Sud, tels deux vieux copains qui se retrouvent par hasard.
Cette bise banale, ce moment suspendu comme un jeu du chat et de la souris où l’on aurait crié pouce, au-delà de l’anecdotique, est infiniment symbolique, comme une photo de Robert Kappa. Elle illustre à elle seule une réalité sociologique : si gilets jaunes et flics se caillassent parfois, s’insultent peut-être, se reprochent mutuellement à grand bruit leur comportement respectif en le qualifiant d’indigne – et il peut l’être, en effet, d’un côté et de l’autre car il se prennent au jeu, l’énervement montant, de cette guerre forcée -, ils font chacun à leur façon ce qu’ils estiment être leur devoir. Ils souffrent des mêmes maux et sont du même monde. Celui de la petite France méritante dont on méprise les valeurs désuètes.
Et cette France-là, malgré tous les noms d’oiseaux, se reconnaît. Comme le montre encore, s’il le fallait, une autre photo, prise elle aussi samedi sur les Champs-Élysées. On y voit un grand calicot, tendu par deux gilets jaunes souriants devant une rangée de gendarmes casqués, avec ces quelques mots : « Même si vous nous foutez sur la gueule… merci pour Strasbourg ! »
Il est amusant – ou tragique – de voir à quel point le gouvernement, comme le faisait remarquer récemment Pascal Célerier dans ces colonnes, n’a de cesse de passer de la pommade aux forces de l’ordre. Pas un jour sans que ces ci-devant anars, jadis militants de l’UNEF (comme Christophe Castaner à Aix-la-Provence) ayant peut-être crié « CRS-SS » comme leurs petits camarades, ne rendent un hommage vibrant, la voix mouillée, à ces gaillards dont ils ne peuvent plus se passer, qui sont devenus leur béquille et leur garde prétorienne, qu’ils passent fièrement en revue, au petit matin, le torse bombé, tel Bonaparte avant le pont d’Arcole.
C’est, du reste, une constante de la gauche que de finir par déclencher une répression implacable pour venir à bout du grand n’importe quoi que son impéritie a suscité. Car, évidemment, quand on laisse s’installer le désordre, il enfle et se propage, devenant si puissant qu’il n’y a pas d’autre choix, en dernière extrémité, que de sortir la grosse artillerie. C’est sous le règne d’Emmanuel Macron que l’on aura vu des lycéens matés, façon Guantánamo, à genoux et mains sur la tête. Sans doute l’avaient-ils bien mérité. Le fait est qu’il aurait fallu, en les éduquant fermement, ne pas en arriver là.
Mais nos gouvernants tendent à oublier un détail : ce respect, cette fidélité indéfectibles des forces de l’ordre ne sont pas dus à leur personne mais à leur fonction.

