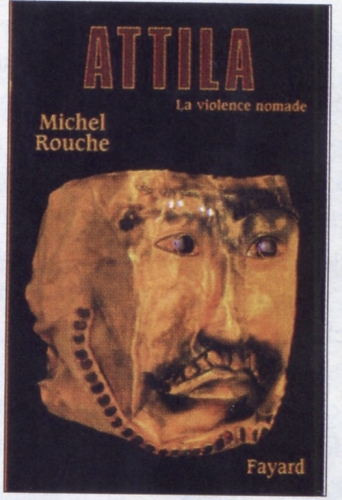 Dans une biographie de haute volée, Michel Rouche nous fait revivre l'affrontement entre deux civilisations un empire romain décadent et un peuple nomade dirigé par un certain Attila.
Dans une biographie de haute volée, Michel Rouche nous fait revivre l'affrontement entre deux civilisations un empire romain décadent et un peuple nomade dirigé par un certain Attila.
Attila ? Le nom fait frémir et nous renvoie aux incursions barbares décrites dans les manuels scolaires de la Troisième République, qui sacrifia au romantisme et, tout particulièrement, à celui de la défaite. La Petite Histoire de France de Bainville n'est d'ailleurs pas exempte des clichés du temps : « Ce fut une époque sombre et désolée où personne n’était sûr de retrouver sa maison ni de garder la vie sauve. De ces invasions, la plus terrible fut celle des Huns (…) Avec leur peau noire et leurs grandes oreilles, ils ressemblaient à des diables ou à des ogres. Ils ne faisaient même pas cuire leur viande et la mangeaient crue après l'avoir écrasée sous leur selle. On appelait Attila, leur roi, le « fléau de Dieu ». Et l'on disait que l'herbe ne poussait plus où il avait passé. »
Michel Rouche, l'un de nos plus grands médiévistes, s'emploie à revoir ces vieux poncifs dans une biographie remarquable consacrée à la violence nomade, dont la figure la plus marquante fut sans conteste celle d'Attila. De prime abord, il est assez surprenant de découvrir l'abondance des sources sur le sujet. Certes, les textes d'époque proviennent exclusivement de l'autre camp, celui des Romains, mais l’archéologie offre aussi de belles surprises. Elle comble les lacunes des interprétations et renvoie à des réalités plus prosaïques sûrement, complexes sans aucun doute. Il ne s'agit cependant en aucun cas de réhabiliter une civilisation qui sacrifiait les hommes aux divinités, pratiquait le cannibalisme, buvait dans le crâne de l'ennemi le sang de ce dernier, ou se mutilait le visage à la mort de son chef. Rouche nous invite simplement à éviter les anachronismes : « L'histoire est fille du présent, disait Lucien Febvre, et par conséquent, l'anachronisme grossier menace la connaissance du passé. »
De fait, le médiéviste offre à ses lecteurs un travail admirablement juste, dans lequel chaque affirmation est pesée. Son style, tout en finesse, est propre à ces auteurs qui scrutent la période dite de la fin de l'Antiquité et du haut Moyen-Âge, évoluant parfois dans des zones d'incertitude, où néanmoins la logique éclaire de manière incontestable la connaissance des peuples et des hommes.
L'épouvantail des Romains
Michel Rouche décrit tout d'abord ces peuples, nomades et barbares, longtemps amalgamés les uns aux autres : « Il y a finalement un peuple nomade qui évolue, peut se passer de roi, se déplace, avec ses troupeaux, fait la guerre avec ses chefs de clan, disparaît, réapparaît sous un autre nom, progresse grâce aux nouveaux venus qui fusionnent avec lui. » Ce monde est en opposition avec le monde sédentaire romain qui, par sa « richesse et son mode de vie […] ne peut qu'attirer le cultivateur semi-itinérant dont la terre est épuisée au bout de cinq ans et le nomade dont le cheptel devient étique ou épuisé. » Les Huns ont une richesse mobilière, quand les Romains s'attachent, eux, à la propriété foncière. L'étonnant reste toutefois la perméabilité des deux mondes. Les Romains savent franchir le Rubicon et s'intégrer dans le monde hunnique, tout comme certains Huns ou barbares n’ont aucun scrupule à opter pour un mode de vie sédentaire. Aetius, le « dernier des Romains », constitue l'archétype du transfuge. Fils d'un barbare à la solde de l'Empire, il est envoyé à la cour d'Alaric, roi des Wisigoths, puis à celle de Ruga, roi des Huns, où il fera la connaissance d'Attila. Mais il n'est pas le seul. Certains Romains n'hésitent pas à fuir une justice impériale au sein de laquelle règnent les delatores et autres « sycophantes », tandis que d'autres tentent simplement de se soustraire à l'impôt. Aujourd'hui, nous appelons cela de l'évasion fiscale…
La compréhension de l'empire d'Attila est indissociable de l'appréciation des bouleversements internes qui touchèrent la société occidentale romaine et, dans une moindre mesure, l'Orient. Aussi, accuser Attila d'être à l'origine de la chute de l'Empire semble abusif : « Attila, explique Rouche, n'a pas fait tomber Rome, mais la peur de l'avenir, peur de voir l'homme libre disparaître aux mains des barbares, a été renforcée par son unique succès, la terreur. […] Attila n'est pas le tombeur de Rome, mais son semeur de panique, son épouvantail permanent. » Reste la question des motivations du chef hun. Souhaitait-il prendre la place de l'empereur en s'incarnant dans la réalité politique impériale, coquille vide qu'il eût été facile d'occuper ? Souhaitait-il, en conséquence, maintenir l'Empire et perpétuer une civilisation ? Rien n'est moins sûr. Attila, certes politique et stratège, bien loin des images caricaturales, semble avoir toutefois cultivé un complexe de supériorité, négligeant l'édifice culturel, politique et religieux d'un empire pluri-centenaire.
Michel Rouche. Attila, la violence nomade Fayard. 510 pages. 26€
Christophe Mahieu monde&vie 21 septembre 2009 n°8l6