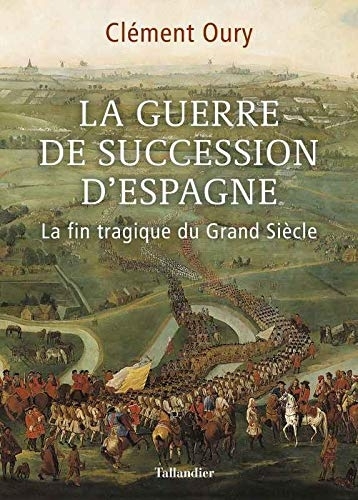
Deux guerres d’ampleur mondiale ont marqué l’histoire du XXe siècle quand bien même l’épicentre se trouvait en Europe. Cette « guerre civile européenne de trente ans » se manifestait aussi par des fronts en Afrique (Tanganyika avec Paul Emil von Lettow–Vorbeck entre 1914 et 1918, Afrika Korps en Afrique du Nord de 1941 à 1943), en Asie, en Océanie (Guerre du Pacifique de 1941 à 1945 ou les occupations japonaises, australiennes, britanniques et étatsuniennes des possessions allemandes du Pacifique dès 1914…) et sur toutes les mers de la planète.
Or, ce n’est pas la première fois que les puissances européennes se combattent partout sur terre et en haute-mer. La Guerre de Succession d’Espagne se déroule au début du XVIIIe siècle sur plusieurs fronts et suscite des batailles navales. « C’est l’ensemble du continent qui devient un champ de bataille entre deux grands blocs, la “ Grande Alliance de La Haye ” et les Bourbons. On se bat en Italie, dans les Pays-Bas, sur le Rhin, on se bat bientôt en Hongrie, en Bavière et dans la Péninsule ibérique; on se bat aussi sur les mers, de la côte du Brésil jusqu’au Spitzberg; on se bat dans les Caraïbes, en Floride et au Québec, dans un conflit qui tend à s’élargir à l’espace du globe », écrit Clément Oury dans un livre qui fait date.
Diplômé de l’École des Chartes et docteur en histoire de l’université Paris – Sorbonne, l’auteur réalise avec La Guerre de Succession d’Espagne. La fin tragique du Grand Siècle la première synthèse en français de ce conflit continental majeur. Avec un réel talent d’écriture, il intègre dans son travail aussi bien l’« histoire – bataille » que l’approche méthodologique de l’« école des Annales », des considérations géo-stratégiques que l’étude de l’équipement, du matériel et de l’état d’esprit des combattants. Il se penche même sur l’opinion publique et sur ce qu’on appellera plus tard la « propagande ». Il en profite pour réviser le concept de « stratégie de cabinet ». Il s’intéresse, à la suite d’André Corvisier, à l’agencement des armées et des marines de guerre. Il se penche sur le moral des soldats et démontre le grand rôle de l’intendance militaire. Il distingue enfin les fantassins des « vieux corps » des « régiments de nouvelle levée ».
Incertitudes dynastiques
« La monarchie espagnole est le géant des cent cinquante premières années de l’époque moderne. » Charles II de Habsbourg règne sur un ensemble disparate (Pays-Bas « belgiques », Milan et Naples, possessions d’Amérique, Philippines, comptoirs africains) dont il est le seul élément d’unité. Or, le 1er novembre 1700 s’éteint le roi d’Espagne, le dernier représentant de la branche madrilène des Habsbourg. Frappé par la consanguinité de ses ascendants, son père étant l’oncle-cousin de sa mère… et malgré deux mariages consécutifs, le monarque reste stérile, ce qui inquiète toutes les cours d’Europe d’autant que depuis les abdications de Charles Quint en 1555, Habsbourg d’Espagne et Habsbourg d’Autriche s’épaulent mutuellement contre les menaces anglaise, réformée, française et ottomane. La complexité des règles successorales des Espagnes attise la revendication de quelques candidats soutenus à Madrid où se forment des coteries. L’ambassadeur de France, le marquis d’Harcourt, anime le «parti français». La reine Marie-Anne de Neubourg dirige le « parti allemand » favorable au fils de l’Électeur de Bavière. Le « parti autrichien » considère le second garçon de l’empereur Léopold, l’archiduc Charles, comme l’unique vrai successeur de son oncle. Ces trois tendances recherchent l’appui du « parti castillan » du cardinal Portocarrero.
L’ouverture du testament de Charles II d’Espagne surprend tout le monde. « Charles désigna le candidat Bourbon, Philippe d’Anjou, comme son héritier légitime et universel. La France avait beau avoir été l’ennemi qui, depuis des décennies, s’emparait régulièrement de quelques joyaux de la Couronne, elle était en 1700, aux yeux des Espagnols, la seule puissance suffisamment forte pour protéger leur empire. » Convoquant en urgence le Conseil d’en-haut qui se tient dans les appartements de Madame de Maintenon et après deux journées de vives discussions au cours desquelles le Grand Dauphin d’habitude effacé intervient en faveur de son deuxième fils, Louis XIV accepte la succession. Il rend publique sa décision, le 16 novembre 1700, devant des courtisans stupéfaits. Philippe d’Anjou devient Philippe V d’Espagne. Le « Roi-Soleil » se doute que son choix risque de déclencher une guerre. Nul ne sait pas encore que « la Guerre de Succession d’Espagne est le plus long conflit du règne de Louis XIV, le plus long également du XVIIIe siècle ».
Louis XIV « n’est plus un conquérant orgueilleux et implacable : c’est un vieillard inquiet, soucieux de conserver ses frontières et sensible à l’accablement de son peuple. La guerre ne vise plus à des conquêtes destinées à consolider le “ pré carré ”, mais s’attache à défendre le territoire d’un autre pays, l’Espagne ». Ce conflit sera, « pour le royaume de France, une épreuve terrible, la pire sans doute de l’Ancien Régime ». En effet, « le testament de Charles II représente, au sein de l’ordre européen qui s’est installé à l’issue de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, un bouleversement politique majeur. Pourtant, un rééquilibrage s’opère à une vitesse surprenante. Face à la France et à l’Espagne, un bloc disparate mais soudé d’États européens se constitue en dix-huit mois ».
L’affrontement de deux blocs
Contre le nouveau bloc dynastique de la France et de l’Espagne dont les peuples accueillent avec joie leur nouveau souverain, ce qu’on appelle bientôt les « Deux-Couronnes » bourboniennes auxquelles se rallient les Électeurs de Bavière et de Cologne, Clément Oury mentionne la « Grande Alliance » (Maison d’Autriche, Provinces-Unies, Angleterre). Ces trois États parviennent « à regrouper autour d’eux la majorité des puissances moyennes ou mineures de l’Europe du Nord et de l’Empire » dont le Brandebourg – Prusse, le Hanovre, la Savoie et le Portugal. Les États alliés sont en périphérie par rapport au nouvel ensemble franco-espagnol. « De même que la position centrale de la France par rapport aux possessions espagnoles offre un avantage indéniable en matière de répartition et de coordination des forces, la concentration du pouvoir à Versailles permet des prises de décision rapides et cohérentes. » L’auteur montre bien par ailleurs que « Louis XIV comme ses conseillers appartenaient à l’école “réaliste” en matière de relations internationales, celle qui cherchait à identifier les “intérêts des États”. Selon cette approche, les monarchies ou les républiques d’Europe devaient poursuivre des objectifs rationnels, c’est-à-dire ceux de leur survie et de leur agrandissement. Les décisions des souverains, comme les déclarations de guerre ou les alliances entre États, étaient le fruit de calculs froids. Elles devaient s’entendre en termes de sécurité des frontières et d’accroissement territorial ».
Du côté de la « Grande Alliance de La Haye » apparaît vite un incontestable triumvirat : le duc anglais de Marlborough, ancêtre du criminel de guerre Winston Churchill, le prince Eugène de Savoie pour les Habsbourg, et le Grand Pensionnaire des Provinces-Unies Heinsius. Quand ils n’arrivent pas à se rencontrer, ils s’échangent une intense correspondance épistolaire. Une cohérence dans le commandement s’établit, car « il s’agissait en fait de la conjonction de leurs poids politique, diplomatique et (pour les deux premiers) militaires ». Chacun doit toutefois garder à l’esprit les intérêts spécifiques de leur État respectif. Heinsius négocie sans cesse avec les États-Généraux bataves. À Vienne, face à la « Vieille Cour » dont la priorité est la défense de l’Italie et une faction rivale dite « allemande » qui, pacifiste, cherche à défendre les rives du Rhin, le prince Eugène et les jeunes archiducs Joseph et Charles appartiennent au parti de la « Jeune Cour » qui, « lui-même traversé par des tensions internes, était réformateur et belliqueux. Il prônait une lutte résolue contre la France pour obtenir l’intégralité de la monarchie espagnole au profit des Habsbourg ». Proche des whigs bellicistes, Marlborough fait face à l’hostilité des tories proto-jacobites assez méfiants par ailleurs envers l’éventuelle accession sur le trône anglais de la Maison de Hanovre. Publiciste tory, Jonathan Swift publie de nombreux pamphlets contre la majorité whig à la Chambre des Communes. Ces rivalités intestines se répercutent avec plus de violence ailleurs en Europe. Territoire espagnol, le royaume de Naples voit se déchirer les « Blancs », partisans de Philippe V, et les « Noirs », soutiens de l’archiduc Charles. « Dans les Pays-Bas s’affrontent le parti des “ carabiniers ”, pro-Bourbon, et celui des “ cuirassiers ” pro-Habsbourg. »
Clément Oury va jusqu’à se demander si la Guerre de Succession d’Espagne ne favorise pas « une conscience nationale en germe » tant sont nombreux les libelles et les pamphlets. En raison de la profusion des gazettes qui n’hésitent pas à déformer les nouvelles, l’auteur y observe la formation d’« une société d’information ». Les guerres incessantes de Louis XIV, les ravages du Palatinat en 1674 et en 1689, l’annexion de territoires au mépris des coutumes et la révocation en 1685 de l’édit de Nantes rendent les peuples européens gallophobes. Le royaume de France connaît lui aussi en proie à des « cabales ». « Les cabales sont […] des réseaux d’influence peu structurés, aux limites floues, et qui regroupent des personnages d’importance se soutenant mutuellement pour s’assurer de conquérir les meilleures places au sommet de l’État, en écartant leurs adversaires. » Les trois principales qui polarisent les rapports de force sont la « cabale des Seigneurs », conservatrice, aristocratique et militaire, autour de Madame de Maintenon, la « cabale de Meudon » autour du Grand Dauphin et de son demi-frère, le duc légitimé de Maine, et la « cabale des Ministres », réformatrice et dévote, avec le duc de Berry et, de façon indirecte, le duc d’Orléans.
Pourquoi donc les Espagnols, ennemis des Français depuis le début du XVIe siècle, acceptent-ils un monarque français ? Clément Oury ne l’évoque pas, mais l’abrogation de l’édit de Nantes a satisfait l’Espagne. En outre, « en appelant le petit-fils de Louis XIV, les élites ibériques reconnaissaient la puissance du modèle administratif et militaire français, dont la solidité semblait seule à même de garantir l’intégrité de la monarchie ». Or s’affrontent dans les Espagnes et leur outre-mer deux visions contradictoires de l’État. « Le modèle de l’absolutisme Bourbon, centralisateur et unificateur, s’oppose au gouvernement par conseil, plus fédéraliste, prôné par l’opposant Habsbourg. » Il faut en effet savoir que « la Castille était sous la dépendance du roi et de son administration, mais ce n’était pas le cas de la couronne d’Aragon, elle-même constituée du royaume d’Aragon (autour de Saragosse), de la Catalogne et de la région de Valence. Dans ces trois provinces, des libertés constitutionnelles, les fueros, restreignaient les compétences administratives et fiscales du Roi Catholique ».
Dualité espagnole intrinsèque
Élevé à Versailles dans une étiquette absolutiste, Philippe V cherche à centraliser ou pour le moins à uniformiser cette entité politique hétérogène si bien que la Catalogne et ses « miquelets » se rallient à l’archiduc autrichien qui assume ouvertement ses prétentions. « Le 12 septembre 1703, à Vienne, l’archiduc Charles, le fils de Léopold, se fit couronner roi d’Espagne sous le nom de Charles III. » En revanche, dès 1706, la Castille démontre son entière loyauté à Philippe V.
Le prétendant Habsbourg défend pour sa part la polysynodie en vigueur à Madrid. Ce système institutionnel se comprend à l’aune de conseils techniques comme le Conseil d’État ou le Conseil de guerre, ou géographiques tels le Conseil de Castille, le Conseil d’Aragon, le Conseil d’Italie et le Conseil des Indes. Les Castillans se méfient beaucoup de cet archiduc ambitieux qui semble « s’appuyer sur les forces centrifuges de la monarchie ou sur ses ennemis traditionnels : Catalans et Portugais. Enfin, comment croire qu’un Roi Catholique puisse être soutenu avec autant d’ardeur par tous les États protestants d’Europe, Angleterre et Hollande en tête ? » Toutefois agissent dans toutes les terres hispaniques, ses partisans. Ce sont les tout premiers « carlistes » qu’on appelle aussi les « austrophiles » ou les « austriacistes ». « Ce mouvement de soutien à l’archiduc [...] s’appuyait moins sur la personne du souverain que sur la tradition de délibération et de fédéralisme qu’il incarnait. » Il est patent qu’« en Catalogne même, le parti austraciste s’appuyait sur trois piliers : les vigatans, sa branche militaire, une milice encadrée par de petits nobles locaux qui avaient mené la résistance contre la France durant le conflit précédent; la bourgeoisie commerciale de Barcelone, qui rêvait de faire de la Catalogne la “ Hollande de la Méditerranée ”; et le bas clergé, surtout les ordres mendiants ».
À suivre