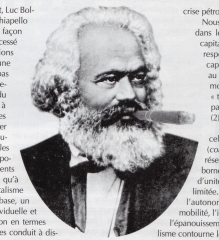
La valorisation boursière des titres Internet a suscité une sorte de folie, dont témoigne la multiplication des « start up ». Là encore, le modèle retenu est celui de l'économie virtuelle et de la fuite en avant. « Des sociétés qui n'ont jamais réalisé de profits et ne sont guère près d'y parvenir sont évaluées à des chiffres représentant plusieurs siècles de chiffres d'affaires » (14). Les désillusions sont bien entendu au rendez-vous. Fin mars 2000, à la Bourse de New York, 700 milliards de dollars (deux fois le montant de la dette extérieure des pays africains) se sont envolés en fumée en l'espace de 24 heures. Quelques jours plus tard, l'effondrement du Nasdaq (le marché électronique où sont cotées les valeurs de la haute technologie) se traduisait par une nouvelle perte de 800 milliards de dollars.
En permettant à toute activité de devenir immédiatement transnationale, quel que soit l'endroit de la planète où elle se trouve, Internet n'en a pas moins valeur de symbole. L'un des traits caractéristiques du nouveau capitalisme est en effet l'abolition de la distance et du temps. L'argent circule en temps zéro d'un bout à l'autre de la planète, et cette mobilité, contrastant avec la lourdeur des bureaucraties étatiques, dont elle accentue l'impuissance et accélère l'obsolescence, se retrouve à tous les niveaux entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, les multinationales et les pays, les marchés financiers et les entreprises. La mobilité (le « différentiel de déplacement ») tend à être érigée en norme absolue, les impératifs de rentabilité commandant les déplacements des hommes et les délocalisations d'entreprises. « On a mis une technologue du XXIe siècle au service d'une idéologie du XIXe siècle », écrit Jack Dion (15). Le capitalisme est plus que jamais nomade.
Le rapport de domination devient de plus en plus abstrait et impalpable
Le premier capitalisme était déjà un capitalisme « sauvage », mais il comprenait aussi un élément de sécurité lié à la diffusion de la morale bourgeoise et de ses valeurs-clés (famille, patrimoine, épargne, charité patronale). Cet élément de sécurité s'est trouvé renforcé dans le deuxième capitalisme, avec le compromis fordiste et l'avènement de l'État-Providence : l'activité patronale y était encadrée par des dispositifs réglementaires, des législations fiscales, une législation sur le travail acquise souvent par la lutte, des structures sociales, des traditions culturelles, etc. Ces deux capitalismes étaient en outre fondés sur des rapports hiérarchiques de domination à l'intérieur desquels une certaine contestation restait possible. Bernard Perret observe à ce propos que « l'organisation hiérarchisée donne paradoxalement davantage de prise à l'élaboration démocratique et à la consolidation des régulations non marchandes. D'un mot : c'est précisément parce que la domination de l'argent s'y manifestait de manière explicite comme un rapport de domination entre des personnes que l'entreprise fordiste a pu composer la scène centrale des combats pour la démocratie sociale » (16).
C'est tout cela qui a volé en éclats avec le capitalisme du troisième âge. Retrouvant son appétit des origines, mais avec des moyens surmultipliés, celui-ci tend à faire disparaître tout système de sécurité, l'idée de base étant que, dans une économie où la concurrence prend le pas sur les organisations et les institutions, le social ne doit surtout pas venir perturber le jeu du marché.
Du fait de la déréglementation, les salariés voient disparaître les uns après les autres, sous les gouvernements de gauche comme de droite, les avantages et les droits acquis par des décennies de combat syndical. Parallèlement, le caractère informationnel du néocapitalisme (on produit toujours plus de biens et de services avec toujours moins d'hommes) fait que la croissance devient « riche en chômage » (Alain Lebaude), tandis que la flexibilité se traduit surtout par la dévalorisation de la notion de statut et que se développent la précarité et l'exclusion.
Le chômage, de conjoncturel, tend à devenir structurel. D'une part, on assiste au déclin tendanciel des emplois agricoles et industriels, auquel s'ajoutent les contraintes budgétaires qui pèsent sur la création d'emplois publics et les limites inhérentes au développement d'emplois dans le tertiaire marchand. D'autre part, le mouvement de recherche de la main-d'œuvre se délocalise de plus en plus hors des territoires nationaux. Enfin, et surtout, les grandes entreprises industrielles, non seulement ne sont plus créatrices d'emplois, mais cherchent au contraire à augmenter leur productivité en en supprimant.
L'influence croissante que les fonds de pension exercent sur les critères de gestion des entreprises joue bien entendu son rôle. « Les seuls impératifs qui comptent pour eux sont l'augmentation de la rentabilité des fonds propres et la maximisation de la valeur actionnariat. L'objectif prioritaire n'est plus, comme dans la période fordiste antérieure, d'assurer la croissance de l'industrie, mais de réaliser des gains de productivité. Si nécessaire, en fermant des unités de production jugées insuffisamment rentables ou, plus exactement, ne satisfaisant pas aux normes très élevées de rentabilité imposées par les investisseurs. Dans ce nouveau régime, la taille de l'entreprise et l'emploi deviennent des variables d'ajustement » (17).
Une entreprise avait naguère tendance à embaucher quand elle faisait du profit. C'est même ainsi qu'on justifiait ce profit : plus les entreprises se porteraient bien, moins il y aurait de chômage. C'est aujourd'hui l'inverse. La décision de Michelin annonçant simultanément la suppression de 7 500 emplois et une hausse de 22 % de ses bénéfices est révélatrice la nouvelle est accueillie avec une faveur immédiate par les marchés. De même, lorsque le gouvernement de Lionel Jospin entérine en juin 1997 la fermeture de l'usine Renault de Vilvorde, les fonds d'investissement américains présents à hauteur de 5 % dans le capital de la firme, applaudissent des deux mains. Le chômage devient ainsi facteur de profit, au moins à court terme (car on ne tient pas compte des conséquences sur la consommation). Dans un tel contexte, la croissance en emplois s'explique essentiellement par le développement du temps partiel et celui des emplois courts ou précaires. En d'autres termes plus la société va mal, plus les profits augmentent.
Les sous-qualifiés ne sont plus exploités, mais exclus
La conviction des économistes libéraux étant que la société de marché est le meilleur système qu'on puisse concevoir, l'objectif est de privilégier les réformes structurelles qui accroissent les incitations au travail et, simultanément, de réduire les revenus de la non-activité, c'est-à-dire ceux qui sont distribués par le système de protection sociale. D'un côté, on crée un chômage structurel, de l'autre on fait de moins en moins pour les chômeurs.
L'exclusion qui en résulte diffère fondamentalement du sort des travailleurs dont le capitalisme se bornait autrefois à exploiter la force de travail. L'émergence du monde des réseaux s'accompagne de nouvelles formes d'aliénation fondées sur les différentiels d'aptitudes, mais aussi de mobilité et de capacité d'adaptation. Compte tenu des profils requis dans les secteurs en voie d'expansion (intelligence abstraite et compétence technicienne), les sous-qualifiés deviennent de plus en plus inemployables, et donc inutiles. Ils ne sont donc plus exploités, mais exclus. « Dans la topique du réseau, écrivent Boltanski et Chiapello, la notion même de bien commun est problématique parce que, l'appartenance ou la non-appartenance au réseau restant largement indéterminée, on ignore entre qui un "bien" pourrait être mis en "commun" et aussi, par là même, entre qui une balance de justice pourrait être établie » (18). Dans le monde des réseaux, la justice sociale n'a en fait tout simplement plus de sens. Ceux qui passent entre les mailles sont définitivement exclus. Bernard Perret parle très justement d'une société élective et volatile, « fondée sur l'évitement de ce qui dérange et, pour cette raison, génératrice d'exclusion ».
Pour masquer cette dérive, les tenants de la « nouvelle économie » font valoir l'importance désormais décisive de la création de profit pour l'actionnaire (share holder value). « Longtemps, remarque Jacques Julliard, l'identification de la direction de l'entreprise avec le capital de celle-ci a été total. Ainsi, dans le système français classique, la figure du PDG, à la fois président du conseil d'administration et directeur de l'entreprise, assurait parfaitement cette identification de l'actionnariat et du patronat. Aujourd'hui, la tendance à l'autonomisation du capital, encouragée par le poids croissant des fonds de pension, place celui-ci en contrôleur exigeant de la rentabilité de l'entreprise » (19).
De fait, les actionnaires ont de plus en plus d'importance dans le système. Ce sont eux désormais, et non plus les chefs d'entreprise ou le patronat, qui réclament fusions et licenciements pour faire monter leurs dividendes. On l'a bien vu en France, où ce sont finalement les actionnaires qui ont arbitré la bataille boursière entre la BNP la Société générale et Paribas, tandis que le ministère des Finances était réduit au rôle de spectateur. L'actionnariat est donc présenté comme la recette miracle tant par les tenants du « capitalisme populaire » que par les libéraux, qui vont jusqu'à expliquer très sérieusement qu'il permet de réaliser le vieux rêve socialiste d'appropriation des entreprises par les travailleurs (20).
Le résultat est en fait de placer les salariés-actionnaires dans une situation de « double lien » quasi schizophrénique. D'une part, en tant qu'actionnaires, ils ont paradoxalement intérêt à s'affranchir de la « dure discipline du capitalisme », en l'occurrence du caractère éminemment risqué de toute activité visant à recueillir rapidement un profit, alors même qu'ils renforcent cette discipline en se portant acquéreurs d'actions. D'autre part, leurs intérêts de salariés s'opposent directement à leurs intérêts de porteurs d'actions, puisqu'en tant qu'actionnaires leurs bénéfices dépendent étroitement de la réussite de politiques sociales qui leur sont hostiles en tant que salariés. « Ces salariés-rentiers sont ainsi doublement perdants, constate Dominique Plihon : comme salariés, ils supportent les conséquences de la "flexibilité" exigée par la recherche effrénée du profit maximal immédiat; en tant qu'épargnants, ils assument en première ligne les risques liés à l'instabilité des marchés financiers » (21). L'essentiel du capital restant concentré entre un nombre de mains très limité, l'actionnariat des salariés, en l'absence de toute redéfinition de leurs pouvoirs réels au sein des entreprises, ne représente finalement qu'un simple surplus pour le capitalisme patrimonial individuel.
Du capitalisme salarial au capitalisme patrimonial
La substitution de ce capitalisme patrimonial, où les dividendes attribués aux actionnaires jouent un rôle majeur, à l'ancien capitalisme salarial accentue évidemment les inégalités, car la répartition des patrimoines est toujours plus dispersée que celle des revenus. Le système des stock-options, dont font usage les sociétés à croissance rapide pour rémunérer leurs dirigeants, permet parallèlement à certains de ces derniers de se constituer des fortunes colossales. Le capital reste toujours mieux rémunéré que le travail, le fait que les placements boursiers rapportent beaucoup plus que la croissance réelle signifiant tout simplement que la part du produit annuel qui ne provient pas de ces placements (essentiellement les salaires) diminue. C'est ainsi tout le visage de la société qui se modifie peu à peu. Autrefois, les bénéfices enregistrés par les gagnants profitaient encore quelque peu aux perdants, situés tout en bas de la pyramide sociale. Ce n'est plus le cas. L'extension du chômage marque la fin de l'époque où ceux qui entraient dans la classe moyenne (et leurs descendants) avaient l'assurance de ne pas retomber en milieu prolétaire. Tandis que les libéraux répètent imperturbablement que le libre-échange est « un jeu gagnant pour tous » (Alain Madelin), c'est le modèle de la « société en sablier » qui s'impose progressivement des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus démunis et tenus à l'écart, et une classe moyenne qui se rétrécit au milieu.
À suivre