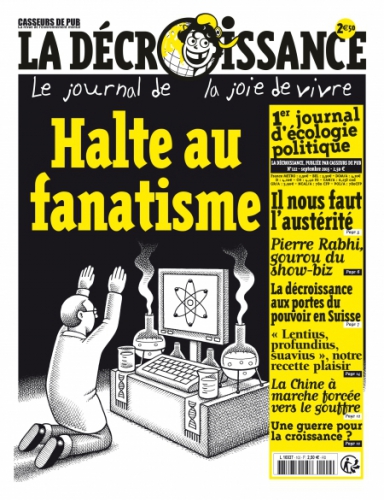Le silence assourdissant des maisons princières aux jours de l'assaut des frontières européennes, ainsi qu'au spectacle de cette guerre non déclarée d'une rive à l'autre de la Méditerranée qu'est l'offensive du fondamentalisme musulman, m'a conduit à douter de leur perception des enjeux. Quel est leur degré de perception des réalités ? Ma langue au chat. Quel devrait-il être ? C'est déjà plus facile.
Contre la Cour - Billet didactique offensif
Il y a quatre choses pour soutenir un monde : La connaissance du Sage, la justice du Grand, les prières du Pieux, le courage du Brave. Mais tout cela n'est rien sans celui qui gouverne et connaît l'art de gouverner (Frank Herbert, in Dune). C'est le pentagone du pouvoir.
Cet art de gouverner s'apprend jeune. Il doit pénétrer le prince au fur et à mesure de sa croissance. C'est son sang, son âme, sa "spécialité". Les enfants des dynasties régnantes sont éduqués au berceau pour y atteindre - enfin, dès l'âge de raison. En dehors du cursus d'appropriation des connaissances, le plus difficile pour eux est d'apprendre à convaincre plutôt qu'à obliger. Aiguiser l'analyse et le jugement réclame des connaissances fouillées, mais d'abord la formation d'un caractère "intellectuel" affirmé, en plus d'un tempérament persuasif et serein. Le nerf du prince n'est pas celui du commun.
Les enfants des dynasties ambitieuses qui ne règnent pas doivent être mis au travail comme les autres, sinon on peut retrouver en eux le jour venu, les mêmes travers que l'on reproche aux dirigeants de rencontre que la République puise dans le vivier des arrivistes : boulimie sexuelle, comportement de parvenus ridicules, goinfrerie gratuite, caporalisme du commandement et in fine tyrannie ; toutes choses impossibles chez une famille régnante même depuis peu, qui entendrait poursuivre.
Nous devons constater, sans nous en affliger, que les prétendants que promènent ci et là les actualités royalistes ne sont pas prédisposés à la mise sur orbite d'un vrai chef d'Etat ; soit qu'ils jugent utopique une quelconque confrontation de leurs capacités à l'emploi éventuel qui les guette, soit que ces mêmes capacités ne suffisent pas à les porter au niveau requis et qu'ils en soient conscients. D'aucuns peuvent aussi se laisser tromper par le niveau parfois exécrable de chefs sélectionnés par le système démocratique. Sont-ce les princes les plus inquiets de ce hiatus ? peut-être plus que la cour qui ne rêve que de promulguer avertissements et conseils ! Les "dresseurs de prétendants", selon l'heureuse formule d'Yves-Marie Adeline, se renouvellent sans cesse à mesure de l'usure du précédent, vaincus par l'inertie du champion. La chambrière de Royal-Artillerie n'est pas loin non plus de glisser des mains du Piéton.
Mais hors de la pépinière des conseillers avoués, le doute fuse et la proportion très grande de militants royalistes rangés des voitures - comme l'avait mesuré le sondage¹ SYLM pour les Premières Assises Royalistes - ne s'explique que par la révélation de l'inanité d'un combat dont l'urgence n'est pas partagée en haut lieu. L'infanterie se laisse décimer en formation tant que le capitaine est devant, l'épée au ciel.
Sans déroger au respect que méritent les princes sincères, on peut faire une simulation de niveau et laisser à chacun le soin de mesurer l'écart à l'existant. Nous avertissons le lecteur que la description d'emploi contenue dans les lignes qui suivent ne visent en rien à copier les gouvernements d'Ancien régime, mais cherche à cerner les qualités utiles pour faire de la politique exécutive à haute fréquence. Dans notre monde, la prise de décisions irrévocables est quotidienne pour l'Exécutif. Cette aptitude dépasse la formation classique d'un élève appliqué. Il y faut la race : on ne peut que partir d'un tempérament favorable et forger le caractère qui y commandera. Sans ce préalable, il est vain de "cotiser".
Comme nous le disions dans un billet irrévérencieux au mois de mars, L'âme des princes « la destinée du prince oblige à monter le niveau le plus haut possible pendant la période de sa formation - on en jugera par les diplômes obtenus - et à forger un caractère résilient. Outre les nécessaires humanités et mathématiques, il tombe sous le sens que des études de droit public, de finances publiques et de commerce international, clôturées par un passage dans une académie militaire, soient le minimum syndical pour qui s'apprêterait à nous gouverner aujourd'hui ». Ceci étant acquis, il reste la pratique des codes sans laquelle le prince accédant resterait dépendant de son entourage. C'est exactement l'objet de cet article.
Gouverner au plus près du vent oblige à bien connaitre les codes de communication et de transaction des hommes qui comptent. Sans en rechercher l'expertise, le prince doit être familier de la langue des grandes corporations sociales qui pèseront le plus lourdement sur ses décisions. Cet apprentissage ne peut être obtenu autrement qu'en travaillant le temps nécessaire à cette acquisition dans chacune de ces grandes corporations. Cette accoutumance "technique" est indispensable pour comprendre les débats du futur Conseil et provoquer sans délai les synthèses attendues. Le monde du XXI° siècle ne nous laisse plus le loisir d'interminables exégèses, il faut "réagir". Pour ce faire, faut-il aussi comprendre l'événement dans l'essentiel sans le filtre du chargé d'affaires. Les anciens rois nous avaient habitués à cette prescience.
Quelles sont donc ces corporations que la culture générale de l'honnête homme ne suffit pas à connaître ? Il y en a heureusement peu, mais ce sont des spécialités contiguës au pouvoir ; à notre avis, les voici toutes, je crois :
* Finances internationales immergées, marchés denrées et matières
* Droit international appliqué
* Infra-stratégies, art de la guerre
* Physique sociale du comportement des masses
* Géographie humaine de l'Afrique noire et haïkous
En quelques paragraphes pourquoi :
Ces spécialités ne sont pas enseignées pour elles-mêmes, sauf à dériver d'enseignements magistraux plus globaux, et il vaut mieux qu'il en soit ainsi car le monde universitaire est trop confiné et lent pour les pratiquer ensuite². Elles s'apprennent en s'investissant dans le milieu considéré, pas forcément longtemps. Il y a d'autres spécialités secondaires dans ce cas, mais elles ne sont pas contiguës au pouvoir et ne nous intéressent pas ici. Exemple : affrètement, conduite d'une opération amphibie, cyber-attaque,... le cas de l'espionnage se discuterait :)
#1. Les finances immergées et les marchés denrées-matières sont des spécialités dont la compréhension n'est accessible que par les back-offices des banques ou par les salles de marché des maisons de trading. Leur influence est considérable sur les paramètres politiques, certains disent que l'essentiel du pouvoir y gît.
#2. Sauf à passer par un cursus juridique classique de droit public, la connaissance des réalités pratiques du droit de force inter-nations est indispensable. Il est aujourd'hui des cours internationales qui brassent ces problèmes quotidiennement.
#3. Pour la stratégie, on a envie de pousser à l'étude des Sun Tzu et Clausewitz - ce qui ne serait aucunement perdre son temps - mais ce sont les infra-stratégies actuelles qui comptent dans le débat et leur approche n'est pas si aisée. Peu de cénacles s'en occupent et les pénétrer demande beaucoup d'habileté ou de relations. Avec les secondes cela reste possible.
#4. La sociologie des foules est une base d'apprentissage politique qui fut travaillée par de grands penseurs, mais la nouvelle société de communication actuelle en demande la révision complète pour ne pas dire la reconstruction. Les foules réagissent au smartphone. Le meilleur stage ne peut être fait ailleurs que dans un grand service de sûreté nationale ou chez... Facebook.
#5. Pourquoi l'Afrique noire ? Parce que c'est notre premier défi européen. Nous en économisons ici la description que chacun anticipe déjà. Le prince en formation ne pourra faire autrement que de passer du temps dans plusieurs ONG/agences mouillées sur le terrain. Vacances exotiques en perspective sur trois ou quatre ans. Et les haïkous ?
C'est le comte Herman Van Rompuy qui m'a demandé d'ajouter cet art tout en finesse qui ne sera jamais enseigné à la fac à peine d'en mourir. Ils lui permirent de meubler les séances interminables du Conseil européen. Royal-Artillerie vous offre le sien à la fin du billet.
À la fin du cycle des spécialités, viendra le temps des synthèses. En situation d'accéder, le prince devrait avoir achevé la connaissance intime de son pays en faisant l'inventaire des dépendances incontournables, des contraintes indesserrables que sa géographie et le monde lui appliquent. Il serait dommage à ce moment d'affaiblir sa réflexion de l'incorporation de coutumes apprises de l'ancien temps puisque l'époque du royalisme pouet-pouet sera achevée à la veille de l'accession.
Les atouts du pays qui restent nombreux à ce jour seront mis à l'actif du bilan. Contraintes et dépendances au passif. Afin que le déséquilibre du bilan national soit gérable, il conviendra de combattre l'effet des dépendances et contraintes et de magnifier les atouts. Par l'optimisation des déséquilibres se terminera l'apprentissage de "l'art de gouverner" laissant place dès lors à l'accumulation de l'expérience.
A la table du nouveau gouvernement on ne devrait gérer que le domaine régalien - il serait sage précaution que de laisser la société à ses disputes démocratiques. Au Conseil de demain, ils seront cinq. Comme un poing fermé, ce Conseil des ministres sera puissant et réactif. Ainsi que l'expliquait Jean-Claude Martinez à la conférence du Centre d'Etudes Historiques sur le Maroc : un pays se gouverne avec une demi-douzaine de "patrons". Faut-il encore les avoir ! C'était l'effectif de la vieille monarchie et Napoléon n'en prit pas beaucoup plus. L'Allemagne (5+9), la Suisse (7) s'y tiennent presque. Les cabinets pléthoriques de la République française sont ridicules, et l'émiettement partisan du pouvoir ajoute l'inefficacité au grotesque ! Ne changeons pas en pire et retenons-nous, messeigneurs, de récompenser ducs et marquis, vicomtes et barons.
Que vienne ce temps avant que le pays n'expire. Il aura alors achevé sa révolution à l'extrême limite de la période autorisée pour sa survie. Deux siècles et demi pour lui faire faire 360 degrés. Au roi, et vite !
Vexilla regis prodeunt, y a plus qu'à !
Note d'ordre
À quoi sert ce billet, en suite de quelques autres attachés à la formation du prince ? L'audience modeste du blogue laisse répondre : "à rien". Mais le Web est vaste comme l'océan où on laisse des bouteilles. Si quelque impétrant ramasse celle-ci sur la grève de nos regrets, elle voudra lui dire que nous prenons au sérieux le retour d'une monarchie en France et qu'il ne faut pas jouer avec notre espérance. A se dire "dynaste" comme on l'entend partout dans les maisons princières, il sied de se préparer à toute éventualité de restauration ou instauration pour la conduire au succès, et cela commence par sa propre formation et celle de ses héritiers.
Les princes d'aujourd'hui en situation d'accéder ne sont pas vraiment formés à l'emploi³. Etudes très moyennes, profession sans profession, inaptitude à bâtir un corpus doctrinal personnel, communication terne, confort de l'historicisation de toute apparition publique, revendication répétitive de droits hérités qui sont en fait perdus, le tout signalant une inaptitude alarmante. Le syndrome du bouchon de liège plombé par l'hameçon.
Si leurs enfants ne sont pas mieux formés à terme, alors nous saurons que les princes en vue n'y croient pas plus que n'y croient nos adversaires républicains et qu'ils jouent avec un mouvement de sympathie populaire qui les flatte et leur coûte si peu. C'est pour cela que j'observerai avec une grande curiosité les progrès que feront Eugénie, Gaston, Louis, Alphonse, Antoinette, Louise-Marguerite et quelques autres... en souhaitant de tout cœur que cette nouvelle génération s'investisse avec courage dans le grand projet en s'organisant entre eux pour le réussir.
A défaut de quoi, le pronostic historique demeure qu'ils devront s'effacer tous un jour pour laisser passer du sang neuf, car il est une certitude inflexible : le plus beau pays du monde ne pourra rester longtemps sans maître.
(1) 61% selon le Livre Blanc de 2009
(2) La lexicisation du transport maritime mondial entreprise soit par l'ONU soit par l'université française dans les années 80 sont des exemples aboutis d'obsolescence instantanée. Deux mois de travail chez un transitaire hongkongais valent deux ans de cours et durent plus longtemps.
(3) Sauf un.
http://royalartillerie.blogspot.fr/