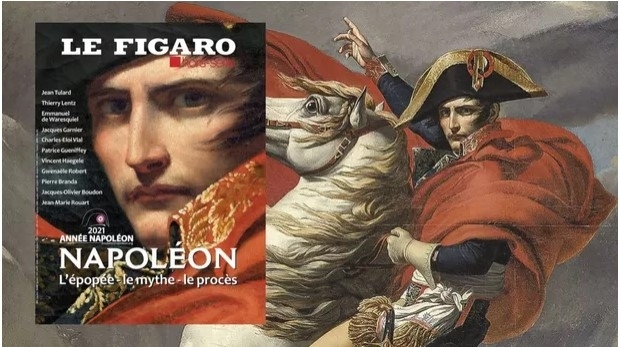
© Rmn - Grand Palais (château de Versailles) / Franck Raux / SP.
Le bicentenaire de la mort de Napoléon est l’occasion d’une campagne de dénigrement de l’Empereur. Pour Michel De Jaeghere, directeur du Figaro Hors-Série, qui consacre un sublime numéro au conquérant, Napoléon est attaqué car il incarne tout ce que ses adversaires détestent: la France.
Chateaubriand, retour d’exil, avait écrit que Bonaparte avait été «marqué de loin» par la Providence «pour l’accomplissement de ses desseins prodigieux». On était en 1803 et le Concordat avait, de fait, dopé les ventes du Génie du christianisme, dont on publiait la deuxième édition. L’écrivain en était vite revenu, comparant dès 1807 dans le Mercure de France l’Empereur à Néron et dénonçant, derrière «le tyran déifié (…), l’histrion, l’incendiaire et le parricide». Il avait quitté entre-temps la Carrière. Il n’espérait plus jouer de rôle politique sous l’Empire et vivait le parfait amour avec Natalie de Noailles, beauté ensorcelante issue d’un milieu royaliste où l’on espérait encore une chute rapide du régime: sous la forme d’un coup d’audace, l’article avait eu quelque chose d’un serment d’amour. Ecrit au lendemain d’Eylau, où les armes avaient paru, soudain, contraires aux espérances françaises, il avait été publié après la victoire de Friedland, à la veille de l’apogée de Tilsit. «L’acte de courage devenait un suicide», écrit André Maurois. Le contretemps avait valu à Chateaubriand les foudres du maître, et plusieurs années de relégation à la Vallée-aux-Loups.
Le 4 avril 1814, alors que depuis cinq jours Paris a capitulé devant les troupes alliées, et tandis que le tsar, vainqueur, hésite encore sur le gouvernement auquel il va confier la France, Chateaubriand fait paraître De Buonaparte et des Bourbons. La brochure a été écrite dans l’urgence et la fièvre. L’écrivain en avait, pendant sa rédaction, caché chaque nuit sous son oreiller le manuscrit, laissant deux pistolets chargés auprès de son lit. Plaidoyer pour le retour de la branche aînée des Bourbons sur le trône de leurs pères, elle accable un «Buonaparte» désormais désigné comme un fléau du Ciel avec toute la violence et l’excès d’une œuvre de combat. L’Empereur déchu n’avait été, à la lire, qu’un étranger sans parole et sans lois, qui avait semé le crime et l’oppression dans le sillage de la plus tatillonne des dictatures policières, livré le pays au pillage afin de financer une administration tracassière, poursuivi des conquêtes inutiles au fil desquelles il avait mis la jeunesse de France en coupe, épuisant son armée dans l’absurde guerre d’Espagne et la désastreuse campagne de Russie, au terme de laquelle il avait lui-même abandonné ses hommes à la défaite et à la mort.
Le libelle n’était pas, à vrai dire, le premier du genre. D’autres avaient, dès 1813, commencé à paraître sous le manteau. Ils dénonçaient l’Ogre qui avait fait périr plus d’un million de soldats et réclamait chaque année, comme Moloch, sa ration de chair fraîche ; l’Antéchrist qui avait emprisonné le pape et détrôné les rois. De 1814 à 1821, les pamphlets se multiplièrent. Jean Tulard en a recensé plus de cinq cents (L’Anti-Napoléon, 1964). Ils se proposaient de dissiper les images glorieuses imprimées aux esprits par quinze ans de propagande, en même temps que de désarmer les nostalgies que pouvait faire naître le souvenir de l’épopée, par comparaison au spectacle d’un roi podagre, régnant sur une France diminuée. L’euthanasie des pestiférés de Jaffa, le départ clandestin d’Egypte, les violences antiparlementaires du 19 brumaire et l’abandon de la Grande Armée lors de la retraite de Russie offraient les thèmes autour desquels s’ordonnaient mille et une variations. Les ultras ne pardonnaient pas à Napoléon d’avoir retardé une Restauration qui aurait pu survenir, sans lui, dès octobre 1795 ; qui avait été à deux doigts de se faire en 1799, dix ans à peine après la prise de la Bastille. Les libéraux lui reprochaient d’avoir détourné le cours de la Révolution pour installer son pouvoir personnel. Mme de Staël et Benjamin Constant regrettaient qu’il n’ait pas mieux suivi les leçons du salon de Coppet, et respecté les libertés modernes.
Un demi-siècle passe. Pour son Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, appelé à devenir la bible des instituteurs de la IIIe République, Pierre Larousse consacre en 1867 et 1874 deux articles distincts à Bonaparte et à Napoléon (ils ont chacun la taille d’un livre). Le premier avait porté «le nom le plus grand, le plus glorieux, le plus éclatant de l’histoire». Mais il était «mort au château de Saint-Cloud, près de Paris, le 18 brumaire». L’autre était un général factieux, un usurpateur et un parvenu, étranger à la France «par la race et par les idées», fossoyeur d’une Révolution dont il avait étouffé «les principes et les résultats (…) dans des vues de grandeur personnelle et d’intérêt privé», méprisant pour un peuple qu’il n’appréciait que pour sa «force brute, dans la mesure où il pouvait l’exploiter pour ses tueries». Son règne avait été une «réaction haineuse» imitée du «césarisme byzantin».
A l’autre extrémité du spectre politique, Jacques Bainville rouvrit le dossier en 1931, avec une biographie qui, plus qu’un récit de la vie de l’Empereur (celle de l’homme privé avait été, déjà, détaillée dans les livres de Frédéric Masson ; celle de l’homme public, racontée dans l’Histoire du Consulat et de l’Empire d’Adolphe Thiers), se voulait réflexion sur le sens de son aventure. Son analyse était plus subtile. Elle était à peine moins sévère: Napoléon avait poursuivi, à ses yeux, une ambition dont il n’avait pas les moyens. Faire accepter à l’Angleterre, à l’Autriche et à la Prusse l’annexion de la Belgique et l’hégémonie française sur l’Europe aurait pu être l’œuvre d’une dynastie. Elle demandait des siècles, une continuité, une stabilité, du temps dont, faute de légitimité, Napoléon était dépourvu. Il s’était efforcé de l’imposer à la hussarde, déployant les ressources de tout son génie pour surmonter la précarité de victoires encore et toujours à refaire. Il s’était heurté aux lois inexorables de l’histoire, et il avait fini par laisser la France, exsangue, plus petite qu’il ne l’avait reçue. «Sauf pour la gloire, sauf pour l’“art”, concluait-il, il eût probablement mieux valu qu’il n’eût pas existé.»
Publiant en 1937 Jeanne d’Arc, Louis XIV, Napoléon, Charles Maurras y reprit à son compte les analyses de son ami Bainville en s’efforçant de traiter Bonaparte «de sang-froid». Rendant hommage à «l’épée fulgurante» qui avait porté l’art militaire français à l’«incandescence», il reprochait au souverain d’avoir miné l’Europe de l’ordre et de l’équilibre en y infusant le principe des nationalités, qu’il jugeait appelé à rendre les nations, «déesses d’un monde nouveau», insatiables. Simplifiant au cœur du continent le chaos germanique, Napoléon avait en outre ouvert la voie dangereuse de l’unité de l’Allemagne. Il pouvait bien avoir abaissé et démembré la Prusse: réveillant, par son humiliation même, le sentiment national allemand, il avait, avec la confédération du Rhin, offert pour l’avenir aux Hohenzollern un formidable champ d’expansion. Son œuvre intérieure avait, dans le même temps, avalisé la destruction révolutionnaire des corps intermédiaires au nom d’un égalitarisme qui laissait désormais l’individu-nain en tête à tête avec l’Etat-géant.
Le réquisitoire comportait, cependant, cet étrange codicille, qui en dit long sur le regret d’avoir dû, par raison raisonnante, refuser de céder à l’enchantement: «Il y a l’homme, disait le maréchal Lyautey! On ne cite pas de créature plus émouvante. L’admiration ne tarit pas. Mémoire immense, génie de l’organisation, flamme de rêve, psychologie aiguë, puissance de travail, étendue et ressort de la volonté, le sujet est inépuisable, et l’épuiserait-on, il resterait le charme: le romantique charme d’une carrière unique par l’abrupte sauvagerie du point de départ, le vertige de l’apogée, l’éloignement du point de chute. (…) Le tout oblige à répéter:“Encore une fois, je le trouve grand!”»
Le bicentenaire de la mort de Napoléon est commémoré en 2021 par l’organisation d’une splendide rétrospective de sa vie et de son œuvre à la Grande Halle de La Villette, en même temps que par une superbe exposition sur ses derniers instants au musée de l’Armée («Napoléon n’est plus»). Par le nombre des publications, colloques, conférences, expositions parisiennes et provinciales qu’a coordonnés à cette occasion la Fondation Napoléon, on mesure que, cinquante-deux ans après le lancement des festivités qui avaient célébré, en 1969, l’anniversaire de sa naissance, la ferveur n’est pas retombée en France.
Ce même bicentenaire est marqué pourtant, dans la presse et le monde politique, par la reprise du procès dont Napoléon est l’inusable prévenu, et qui semble ne jamais devoir se conclure. Les chefs d’accusation ont cependant changé de nature. Napoléon n’est plus menacé par le feu croisé des jacobins et des ultras, des libéraux, des contre-révolutionnaires et des républicains. On ne lui demande plus compte de l’équilibre européen non plus que du respect des libertés individuelles. Foin de ces vieilleries! Victime de l’intersectionnalité des luttes, il doit désormais répondre d’accusations relatives au nouvel ordre moral qui fait chaque jour sentir son emprise de manière un peu plus étouffante. Napoléon n’avait-il pas traité les femmes, dans le Code civil, en mineures? Ne s’était-il pas lui-même comporté parfois comme un soudard avec certaines d’entre elles? N’avait-il pas négligé d’abolir l’esclavage en Martinique, lorsqu’il avait recouvré en 1802 la souveraineté sur l’île, où il avait été maintenu par les Anglais depuis 1794? Pis encore, cédant aux incitations du Sénat conservateur, aux pressions des planteurs, ne l’avait-il pas rétabli en Guadeloupe au prétexte que son abolition avait ruiné l’île? N’y eut-il pas là chez lui une manifestation typique du «racisme systémique» de cet Occident que des populations du monde entier s’efforcent par tous les moyens de rejoindre alors même qu’on paraît ne jamais devoir clore la liste de ses crimes?
Napoléon fut, pour le meilleur et pour le pire, un homme blanc ; il n’était pas vegan, il ne triait pas ses déchets. Il est trop tard pour lui en faire grief (nul ne propose encore que soient réexhumées ses cendres et qu’elles soient jetées, en signe d’exécration, à la fosse commune: cela viendra peut-être). Mais il reste loisible aux spécialistes du harcèlement démocratique de tenter de nous interdire de nous pencher sur son souvenir sans faire au préalable repentance. Nous en avons, depuis vingt ans, tellement pris l’habitude! Cela ne serait, après tout, qu’une fois de plus.
Notre réponse aura pourtant, ici, quelque chose de plus décisif. On pourrait certes tenter de faire valoir que Napoléon fut homme de son temps, qu’engagé dans le maelström politique il avait accepté de s’y compromettre, et de faire, ici ou là, des choix discutables, des erreurs de jugement, des fautes, mais qu’il s’était efforcé d’étreindre son époque avec une énergie sans pareille, et avait fait briller, dans le brouhaha d’une France à peine sortie de la commotion révolutionnaire, des éclairs de génie. Ce serait en quelque sorte plaider les circonstances atténuantes. Mais ces arguments seraient en réalité irrecevables pour ses adversaires, et il est temps peut-être d’adopter contre l’indigénisme, la cancel culture et leurs produits dérivés ce que Jacques Vergès appelait «la défense de rupture». Car les animateurs de cette campagne se moquent bien au fond de Napoléon, des femmes et de l’esclavage. S’ils entendent substituer, à Rouen, la statue de Gisèle Halimi à celle de l’Empereur parce qu’elle fut militante de la cause féministe et avocate du FLN, c’est bien parce que l’histoire de l’Empire les indiffère. Ce qu’ils veulent, c’est nous imposer les canons de leur nouvelle morale en décrétant ce qui a droit ou non à notre admiration. Ce qui les indispose, chez Napoléon, ce ne sont pas les faiblesses réelles ou supposées de son règne, c’est d’avoir illustré de manière éclatante ce «monde d’avant» dont ils entendent nous faire honte afin de désarmer en nous le désir de rester ce que nous sommes. Ce qu’ils lui reprochent, c’est en définitive cela même que lui reconnaissait Maurras, pourtant adversaire de sa cause: d’avoir été «grand», à l’image de l’histoire et de la civilisation dont il a été, un instant, le porte-parole et l’incarnation. La réponse que nous ferons à ses accusateurs dépassera dès lors le cadre d’une controverse savante: elle témoignera de notre volonté de poursuivre l’aventure, ou de notre résignation à sortir, confus, de l’histoire.
Michel De Jaeghere est directeur du Figaro Hors-Série et du Figaro Histoire.
Cet éditorial est extrait du nouveau Figaro Hors-Série.
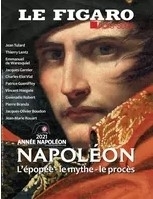
«Napoléon. L’épopée - le mythe - le procès», 162 pages, 12,90 €, disponible en kiosque et sur le Figaro Store.
Source : https://www.lefigaro.fr/vox/