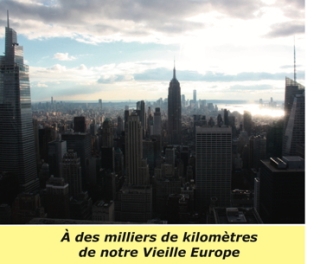
Quelques jours de quasi-vacances, sans ordinateur, à des milliers de kilomètres de notre vieille Europe, suivis hélas d'un rhume de la pire espèce carabinée, ont contribué à paralyser la plume de votre chroniqueur.
Avant d'évoquer, à nouveau et très vite, notre atterrissage dans les marécages de la politique française, qu'on lui permette de retracer ses récentes impressions new-yorkaises. En dépit des évolutions du monde, à 47 ans d'un premier voyage professionnel, n'ont pu vraiment changer, ni ses convictions, ni sa perception de la politique occidentale. N'oublions jamais du reste que l'immense métropole mondiale, fascinante à bien des égards, entre Manhattan et Brooklyn ne représente ni les États-Unis dans leur ensemble, ni leur industrie, ni le peuple nord-américain, ni son mode de vie, lequel la plupart du temps s'en écartent.
Certes l'accumulation financière colossale, certes aussi l'architecture prodigieusement verticale, et quelques autres extravagances, nous semblent caractéristiques du monde américain. Elles y trouvent leurs expressions d'avant-garde les plus outrancières. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour le savoir : nous sommes tellement envahis par les productions cinématographiques et télévisuelles américaines que même les couleurs si particulières des arbres à l'automne ne nous surprennent plus. Content quand même de revoir, de toute façon, les gentils écureuils espiègles de Central Park…
Demeurons donc, un instant encore, dans le registre positif. La magnifique Frick Collection présentait un ensemble d'œuvres admirablement rassemblées des plus belles périodes de la peinture européenne, flamande, allemande, italienne, française, anglaise. De telles acquisitions ne pouvaient se concevoir sans une indiscutable intelligence artistique servie par l'immense fortune d'un industriel de l'acier. Depuis la disparition de Henry Clay Frick en 1919, sa fondation et sa famille ont maintenu sa quête. C'est bien grâce à lui, et à ses choix perspicaces, que nous pouvons admirer en ce lieu aussi bien le portrait de Thomas More par Holbein, de sublimes Van Dyck, un autoportrait de Murillo, le Saint Jérôme du Greco, un délicieux Greuze et une très belle salle dédiée à Fragonard. Tout cela nous ramenait dans la culture européenne.
Et puis le Musée Métropolitain nous attendait, franchement impressionnant. Il s'agit certainement de l'homologue de notre Louvre. Il présente, jusqu'à la fin janvier une exposition consacrée au Surréalisme. À partir de février celle-ci se transportera à la Tate Modern de Londres. Était mise en vedette une huile de 1937 signée de mon père Mayo, Antoine Malliarakis, qui pourtant lui-même ne cachait pas sa distance vis-à-vis du mouvement révolutionnaire d'André Breton qu'il décrivait comme une secte. Je m'efforcerai de revenir sur le sujet qui s'éloigne de notre propos.
Le vrai sujet me semble qu'on présente cette ville et ce pays comme les beaux modèle d'un flux migratoire réussi, au nom de la doctrine dite de l'immigration choisie.
Quand nous entendons ce slogan, posons-nous la question "choisie, oui, mais choisie par qui ?"
Une observation à l'œil nu, d'ordre anthropologique, ne pouvait, en effet manquer de nous frapper. En 1924, une loi Johnson-Reed avait été promulguée par le président républicain Coolidge. Elle représentait le triomphe d'une vague de restriction de l'immigration contrôlée par l'État fédéral américain. Cette tendance avait commencé à se développer dès le XIXe siècle.
Ainsi, dès 1882, celui-ci avait tenté d'interdire purement et simplement l'entrée sur le sol américain des ressortissants chinois. Pas la peine de mettre en place un savant appareil scientifique de recensement pour prendre acte de l'échec de ce dispositif raciste anti-asiatique. Sous l'appellation de "Latinos" par ailleurs, les "Gringos" anglophones nord-américains voient progressivement s'accroître le nombre des originaires de l'Amérique centrale, hispanophones, aimables serveurs dans les restaurants, femmes de ménages dans les hôtels etc.
Bien plus, soulignons que la loi Johnson de 1924 se donnait pour but assez explicite : non seulement de privilégier la venue des WASP, "blancs, anglo-saxons et protestants" ; mais même celle des Européens du nord, supposés "grands, dolichocéphales, blonds" conformément à la doctrine de Vacher de Lapouge et aux mots d'ordre du Ku Klux Klan auquel Johnson passait pour affilié.
Or, un siècle plus tard, il se révèle exactement le contraire. La ville de New York, hier encore, n'était considérée comme cosmopolite qu'en vertu du nombre de descendants d'Irlandais, de Juifs, de Grecs et d'Italiens, – les Afro-Américains étant concentrés à Harlem. Toutes ces communautés votent en général pour les démocrates. Aujourd'hui, la ville est clairement passée, sans retour probablement, au stade suivant de la bigarrure multicommunautaire. L'assimilation, la fusion dans ce qu'on appelait autrefois "melting pot", le creuset, a définitivement cédé la place à ce qu'on désigne comme "salad bowl", le "saladier". Mais après avoir élu en 2008 leur premier président noir, les Américains ont voté en 2016 en faveur de celui qui représentait le rejet de cette évolution. Et, depuis, le pays semble coupé en deux, comme il l'avait été, il y a 150 ans.
Avant même de retrouver la politique française et européenne, nous pourrions tirer de l'expérience américaine une double leçon : le jeu de la fixation par l'État de quotas d'immigration est un jeu dangereux, contre-productif, voué à l'échec ; demander une procédure référendaire – pour ou contre quoi ? – "sur l'immigration" serait encore plus périlleux.
JG Malliarakis