
[Ci-dessus : Gustave Thibon vers la fin de sa vie. Ses entretiens avec Philippe Barthelet révèlent la finesse d'une pensée souvent mal comprise, et parfois détournée, ainsi qu'une âme éprise de poésie. Le philosophe cite avec une intense jubilation les vers des poètes qui, depuis sa jeunesse, n'ont cessé de le hanter]
Recension : Philippe Barthelet, Entretiens avec Gustave Thibon, Rocher, 240 p.
Décédé au début de l'année 2001 à un âge “jüngerien” (il était né en 1903), Gustave Thibon reste, en dépit d'une œuvre étalée sur six décennies et de plusieurs émissions de télévision qui lui ont été consacrées, un auteur mal connu. Non au sens où son œuvre n'aurait touché qu'un public confidentiel, mais parce qu'elle a été reçue et commentée surtout dans des milieux assurément incapables d'en faire ressortir la richesse et la subtilité. Je veux évidemment parler de certaines franges assez rances du “national-catholicisme à la française”, qui eussent bien volontiers limité le “métaphysicien poète” au paysan ardéchois chantre de la fameuse “terre qui ne ment pas”.
Il admirait Céline et Federico Garda Lorca
Aussi la réédition de ses entretiens avec Philippe Barthelet — grand connaisseur de l'homme et de l'œuvre, dont les questions ne négligent quasiment aucun aspect de la réflexion de Thibon — vient-elle à point nommé pour restituer la complexité d'une formation et d'une pensée, taillant en pièces, au passage, a priori et jugements intéressés. C'est le cas du prétendu “maurrassisme” de Thibon. Celui-ci ne connut d'ailleurs que tardivement le “maître de Martigues”, à Lyon, pendant la guerre : « Il a dit lui-même, non comme un regret mais comme un fait, que Maurras n'avait compté en rien dans sa formation littéraire et intellectuelle », répondait récemment Philippe Barthelet à la revue Contrelittérature (n°8, hiver 2002) [propos recueillis par L. Schang ; questionnaire reproduit dans ce billet du blog stalker]. Ces entretiens montrent bien que Thibon, qui n'était pas nationaliste, ne partageait en rien la germanophobie souvent grotesque de Maurras. Thibon a d'abord subi l'influence du néo-thomisme de Maritain, puis celle d'un certain existentialisme chrétien (Gabriel Marcel), l'autre foyer de sa pensée étant constitué par les romantiques allemands. D'où son premier et remarquable essai (1934) [1], consacré à Ludwig Klages, fondateur, dit-il, d'une « métaphysique générale qui rend cohérent ce qui, chez les romantiques allemands, est donné […] à l'état de fragments ou d'étoiles filantes » [2]. Ses goûts mêmes en littérature l'éloignent de Maurras : imagine-t-on celui-ci prendre la défense de Hugo [3] — « niagaresque », certes, mais avec « beaucoup d'eau sous l'écume » —, qualifier Céline de « plus grand prosateur du siècle » et affirmer, à propos de Mea culpa [pamphlet de 1936], que « Guénon, dans un autre style, n'a pas dit mieux » ? Quant à Garcia Lorca, il est pour Thibon « la poésie même » et incarne « la pure magie de l'évocation ».
Quand viendront les nouveaux fils d'Antigone
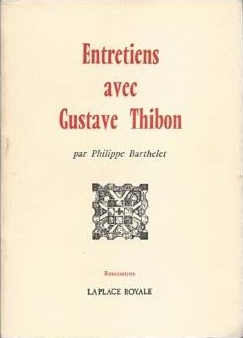 [Ci-contre : couverture de la première édition, éd. La Place Royale, 1988]
[Ci-contre : couverture de la première édition, éd. La Place Royale, 1988]
Mais au-delà du cas Maurras et de la lourde hypothèque de « l’Église de l'ordre » [4], ce qui ressort très nettement de ces entretiens (parus en novembre 2001, ils ont déjà fait l'objet d'une réimpression), c'est l'opposition viscérale de Thibon au social, « lieu du diable », puisque — conviction aussi forte chez lui que chez Simone Weil [5] — « le pharisaïsme est consubstantiel à la cité terrestre ». Thibon plaçait ses espoirs dans les nouveaux fils d'Antigone, dans l'esprit de résistance au Gros Animal, l'essentiel étant que « le cuir de ce Gros Animal ménage assez de pores pour que l'on puisse respirer un autre air à travers lui ». Cet air, cette béance, c'est la part d'indétermination et d'insatisfaction en l'homme, ce qui fait de lui, être de transition, un pèlerin, homo viator en quête du mystère de sa condition. Thibon, ou le refus si peu conservateur de s'installer dans la pesanteur de tout ce qui est “mondain”, pour mieux accueillir, à l'écart, le nectar de la grâce. Le “philosophe-paysan” n'est décidément pas fait pour les gens épais.
Philippe Baillet, éléments n°104, 2002.
notes en sus :
1. La Science du caractère : L’œuvre de Ludwig Klages, G. Thibon, Desclée de Brower & Cie, 1933. — La science du caractère est une œuvre de jeunesse de Gustave Thibon. Converti de fraîche date au catholicisme, encore sous l'influence directe du philosophe Jacques Maritain, Thibon, au moment où il écrit ce livre, vient de découvrir dans l'enthousiasme les thèses thomistes et aristotéliciennes sur l'union substantielle de l'âme et du corps. Son adhésion à cette conception de l'homme l'aide à se libérer à la fois du dualisme cartésien et du mécanisme-matérialisme ambiant dont la pensée de Freud est imprégnée. Le terrain, nouveau pour lui, sur lequel il a pris pied, l'aide à comprendre et à juger une œuvre «intempestive» et pourtant très importante dans le monde germanique dans les années 1930, celle de Ludwig Klages. (présentation par J. Dufresne d'un extrait de texte de Klages) — Thibon a rendu aux philosophes français un service réel en leur faisant connaître la caractérologie de Ludwig Klages. Science à base expérimentale et à structure spéculative, où la connaissance intuitive et la réflexion abstraite jouent leur rôle, la caractérologie s'efforce à définir la particularité distinctive d'un être ; de quel secours elle peut être pour la psychologie rationnelle on le devine, et, en quelques pages nerveuses qui terminent la première partie de son exposé, M. Thibon définit avec bonheur les points de contact et aussi les divergences inévitables de l'anthropologie de Klages et de saint Thomas. Le même esprit de large sympathie et de critique judicieuse anime la deuxième partie de ce livre, consacrée à la métaphysique klagesienne : on y surprend un enthousiasme lyrique pour Klages — l'homme le plus génial de notre époque (p. 92) ; mais l'Auteur sera le premier à comprendre que l'on ne partage point cette sensation de charme et de ravissement pour les « analyses tout imprégnées du lyrisme abyssal des grands romantiques germains » (p. 130) que nous a laissées Klages. Toutefois, l'enthousiasme ne porte point tort à la raison, et la critique de Klages par M. Thibon est solide et irréprochable. Dans une troisième partie, nous trouvons un exposé des travaux de M. Prinzhorn, très utiles pour les éducateurs. Klages était loin d'être un chrétien ; sa pensée est même un naturalisme authentique : M. Thibon, dont on connaît le pur thomisme, a fait entre la mystique klagesienne et la mystique chrétienne une comparaison qui conclut à un « abîme assez vaste ·» pour devoir être souligné. En définitive, quoiqu'en ait dit une plume très autorisée, mais aussi trop sévère et trop nerveuse, le livre de M. Thibon est très sain ; et il souligne, dans un cas pratique plein d’intérêt, ce merveilleux pouvoir qui caractérise le thomisme. (JM, Revue thomiste, 1936)
2. Pourtant, les deux pensées qui l'ont le plus marqué, celle de Klages, dans la première partie de sa vie, et celle de Simone Weil dans la seconde, sont l'une et l'autre fortement empreintes de dualisme. « Le dualisme de Klages, confiera-t-il à Philippe Barthelet, a toujours été ma grande tentation. Et si je n'y ai jamais complètement cédé c'est en raison de l'impossibilité radicale de tout dualisme : les pères de l'Église l'ont surabondamment démontré, saint Augustin en particulier, en reniant l'hérésie manichéenne. Et saint Thomas après eux : non videntur litigare quae nihil habent commune (les choses qui n'ont rien en commun ne se battent pas entre elles). La lutte suppose en effet une parenté entre les êtres, une même origine, sans quoi ils coexisteraient dans des mondes différents et sans rencontre possible. Corollaire du vieux principe pythagoricien : seul le semblable peut connaître le semblable » (p. 36). [source note]
3. Son titre L'ignorance étoilée (1974) est emprunté à La légende des siècles : « Vous m'offrez de ramper ver de terre savant ; / Eh bien, non. J'aime mieux l'ignorance étoilée / De Platon, de Pindare, âme et clarté d'Élée, / Et de ce Dante errant qui baisse factieux / Son œil farouche où tremble une lueur des cieux. / L'homme est par eux aussi lumineux qu'il puisse être » (v. 144-149). Comme le note A. Vaillant sur ce passage : « Nous touchons là au cœur de de l'utopie hugolienne, utopie morale aussi bien qu'esthétique. D'une part, le poète qui marche concilie l'exigence de vérité et le désir de beauté, dont il réalise la synthèse dans la figure de Dieu. D'autre part, il faut à cette union miraculeuse de l'effusion sensible et de l'inquiétude philosophique un mode d'expression littéraire : c'est le mètre » (La crise de la littérature : romantisme et modernité, Ellug, 2005, p. 183)
4. Autrement dit l'Église Romaine, par opposition à la « démocratie religieuse » prônée par le Sillon. Il ne s'agit en rien de papisme mais de restaurer l'Église de France comme facteur d'ordre sur le plan civilisationnel en lui donnant une position sociopolitique privilégiée, indépendamment du degré d'appartenance à l'Église de la population dans son ensemble. La primauté maurrassienne du politique (sur l'économique) est d'un autre ordre que la « primauté du spirituel » que lui oppose Maritain. Quid de la question sociale ? Pol Vandromme, auteur de Maurras, l'Église de l'ordre (Centurion, 1965) subsume la polémique en rappelant que l'Église de l'Ordre est aussi l'Église de la Justice, et l'Église du temps, l'Église de la continuité.
5. Chez S. Weil, « La hantise du social peut alors bien s'éclairer par des traits de caractère personnel ou l'influence d'une formation intellectuelle [la peur du social ne vient pas d'un “tempérament très individualiste. J'ai peur pour la raison contraire. (…) Je suis par disposition naturelle extrêmement influençable à l'excès, et surtout aux choses collectives” (Attente de Dieu)], mais les analyses psychologisantes n'ont pas à prendre le pas sur l'essentiel, qui est l'exigence de ne pas confondre l'amour surnaturel avec un sentiment social : “les sentiments sociaux ont aujourd'hui une telle emprise (…) que je crois bon que quelques brebis demeurent hors du bercail pour témoigner que l'amour du Christ est tout essentiellement autre chose” (Attente de Dieu) », E. Gabellieri, Être et don : Simone Weil et la philosophie, Éd. de l'Institut Supérieur de Philosophie Louvain-la-Neuve / Éd. Peeters (diffusion Vrin), 2003, p. 419.