Note de lecture de Bernard Mazin, essayiste.
♦ L’ouvrage de Chantal Delsol a déjà été présenté sous la plume de Pierre Le Vigan qui, au moment où j’écris ces lignes, revient opportunément sur le sujet à propos d’un autre livre plus ancien, Eloge du populisme, de Vincent Coussedière. Le phénomène du populisme étant au cœur des débats politiques, et étant en passe d’y demeurer bien ancré dans les prochaines années, il ne me paraît pas inutile de se pencher à nouveau sur l’analyse de Chantal Delsol, que l’on peut ranger dans la catégorie de la « philosophie appliquée » et qui frappe le lecteur par sa pertinence et sa mesure.
« Je ne connais pas de plus grande brutalité, dans nos démocraties, que celle utilisée contre les courants populistes. La violence qui leur est réservée excède toute borne. Ils sont devenus les ennemis majuscules d’un régime qui prétend n’en pas avoir. Si cela était possible, leurs partisans seraient cloués sur les portes des granges. »
Pourquoi tant de haine ?
Le sous-titre du livre, Les demeurés de l’Histoire, peut sembler relever de la provocation, mais l’auteur s’en explique dès le début de son propos. Elle rappelle que dans la philosophie de l’Antiquité grecque, il existe une quasi-constante : l’opposition entre les « quelques-uns » et les « nombreux ». Les premiers ont la faculté de rechercher ce qui est commun à tous, le logos, c’est-à-dire le discours universel ; les « nombreux » sont au contraire des idiotès, c’est-à-dire ceux qui ne voient que ce qui est particulier et qui le considèrent comme la Vérité. Cette réflexion ne distingue pas la philosophie de la politique, puisque l’aspiration à l’universel et l’aspiration au bien de la cité se confondent. Tout au plus existe-t-il un début d’interrogation sur la démagogie.
A beaucoup d’égards, l’on peut considérer que les actuelles attaques contre les populistes trouvent leur origine dans Platon :
« L’identification de la multiplicité avec la médiocrité, son identification avec le chaos, traduisent un élitisme qui repousse toute tentative, ou espoir, de tenir compte de l’expression populaire. […] Cette vision de Platon est annonciatrice des points de vue actuels sur le populisme : aujourd’hui, si l’opinion du peuple ne correspond pas avec le discours des droits de l’homme envisagés d’une manière spécifique, cette opinion est identifiée à une dispersion de caprices et de passions, et celui qui lui prête attention, à un démagogue. »
Malgré tout, la véritable histoire du populisme coïncide avec celle de la démocratie représentative, et ce n’est guère que depuis une vingtaine d’années que le qualificatif de populiste est devenu un gros mot, et même une injure. « Je ne connais pas de plus grande brutalité, dans nos démocraties, écrit Chantal Delsol, que celle utilisée contre les courants populistes. La violence qui leur est réservée excède toute borne. Ils sont devenus les ennemis majuscules d’un régime qui prétend n’en pas avoir. Si cela était possible, leurs partisans seraient cloués sur les portes des granges. » Comment en est-on arrivé là en si peu de temps ?
L’auteur en voit la cause dans l’important changement qui s’est produit depuis la fin des Trente Glorieuses : la désaffection du peuple à l’égard de l’idéologie émancipatrice des Lumières. Celle-ci trouve une certaine généalogie dans la conception platonicienne : convergence entre le logos philosophique universaliste et la finalité politique ; méfiance à l’égard des masses incapables de saisir le Bien commun, qui conduit corrélativement à la confiscation de l’expression du peuple des idiotès par une « élite » autoproclamée. Mais cette homothétie n’est qu’apparente : alors que la raison, le logos, était pour les Grecs « une vérité encore introuvée et probablement introuvable », la Raison cartésienne qui inspire les philosophes du XVIIIe siècle est devenue celle « qui éteint au fur et à mesure qu’elle avance les ténèbres de l’ignorance, et désigne les vérités illuminées que tous doivent dès lors accepter pour telles. »
Il faudrait de plus longs développements pour préciser l’articulation entre les Lumières et la pensée économique libérale, qui fusionnent sous nos yeux dans le melting pot de l’idéologie libérale-libertaire. Mais ce sont là des concepts bien connus des familiers de Polémia, et l’auteur ne manque pas de les résumer, faisant référence à des penseurs tels que Christopher Lasch (1) ou Jean-Claude Michéa (2).
Quoi qu’il en soit, le résultat est que « aujourd’hui, une vérité morale unique impose à la politique ses finalités, jugeant idiots ceux qui voudraient défendre des particularités face à cet universel imposé. »
Le populisme se loge ainsi dans les interstices d’une démocratie qui déçoit le peuple, qui « n’a pas été à la hauteur des espérances de ceux qui le veillaient amoureusement. C’est du moins ainsi que l’élite a compris les choses. En réalité, elle avait nourri des illusions : non pas sur les capacités du peuple, mais sur la vérité de ses propres doctrines. Mais elle l’ignore. Elle voit un peuple qui fait défection. Qui trahit. Qui refuse d’agréer avec reconnaissance une nouvelle vie qu’on lui confectionne. Qui reproche à l’idéologie de lui confisquer ses aspirations légitimes. C’est là le début de l’histoire du populisme. »
Précisant son propos, Chantal Delsol nous conduit à travers différentes étapes de ce processus de diabolisation des populistes : ces étapes procèdent parfois d’une réflexion théorique élaborée. Il en va ainsi de la démarche léniniste de différenciation entre « spontanéité » et « conscience », qui conduit à résoudre le problème en l’éliminant, au besoin physiquement. Mais bien plus souvent – et l’exemple des grangers américains illustre bien ce cas de figure – c’est un processus de récupération qui est mis en œuvre. « D’abord, les élans populistes développent des idées dont personne ne veut mais qui sont portées par une partie de la population. Ensuite, les partis officiels n’aiment pas voir les plébéiens réclamer leur part du pouvoir et préfèrent donc adopter une partie de leur programme pour faire taire leurs velléités de participation au gouvernement. »
De nos jours en France, on retrouve cette même cohabitation des deux attitudes : celle de l’élite de gauche, qui procède de la réflexion de Lénine en niant la légitimité de la réalité et en assimilant le pragmatisme populiste à du nihilisme, puisqu’il n’y a aucun concept là-dessous ; celle d’une frange des soi-disant Républicains, Sarkozy en tête, qui s’évertuent à courir derrière le FN pour essayer de rallier les voix de droite. On peut constater tous les jours le sort de ces deux stratégies, face au mur de la réalité.
De quoi le populisme est-il le nom ?
L’auteur énumère ce qui fait la spécificité du discours et des programmes populistes :
la critique de l’individualisme, qui rompt le lien social et les solidarités ;
la critique des excès de l’Etat-providence, d’autant plus accentuée que ces excès bénéficient à des clientèles non reconnues comme faisant partie de la communauté du « vivre ensemble » ;
la défense de l’identité de la nation ou des groupes d’appartenance ; de là procèdent l’euroscepticisme, le refus de la mondialisation, la volonté de réduire l’immigration, l’hostilité à l’égard de l’empire américain ;
l’aspiration à la moralisation de la vie politique (lutte contre la corruption) et des mœurs (contre la morale dominante des droits de l’homme, de la victimisation systématique et de la transgression) ;
sur la forme, le recours à une parole libérée – qui ose « dire tout haut ce que les gens pensent tout bas » – et le « refus du mensonge et de la sophistication élitaires», qui ne sont autres que la novlangue utilisée par la super-classe mondiale.
On voit avec ce rapide survol que le populisme, contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire, n’est réductible ni à un mouvement contre la démocratie, ni à une forme de démagogie, ni à une dimension protestataire. Il est en outre autonome par rapport au débat sur le libéralisme économique. Il est en fait une réaction à la tendance post-moderne « à la dé-différenciation, au mélange, à l’effacement des caractéristiques. La mondialisation est applaudie lorsqu’elle permet la « culture-métis », elle est vilipendée quand elle produit la concurrence, c’est-à-dire quand elle valorise les singularités. »
Le populisme, rempart contre les conceptualisations universalistes
Le populiste se dresse contre la dogmatique universaliste dominante. Il représente l’enracinement contre l’idéologie de l’émancipation, celle de « l’homme détaché de ses racines temporelles et spatiales, et des obligations communautaires [qui] vit dans un monde ouvert, traversant les frontières aussi bien que transgressant les limites dont il ne reconnaît plus la légitimité ».
Revenant à l’histoire des idées, Chantal Delsol rappelle que depuis les Lumières, l’idée d’émancipation se présente comme « une idéologie, un système conceptuel complet, historiquement triomphant et, par la force de son argument historique, déblayant tout sur son passage ». Mais alors qu’au XIXe siècle de nombreux courants de pensée ont tenté de critiquer ces conceptualisations émancipatrices, au XXe siècle « ces arguments se sont pratiquement tus, comme si l’évidence de l’émancipation avait fini par épuiser tous ses adversaires ».
Cet étouffoir est partiellement la conséquence des excès des totalitarismes nazi et fasciste, qui bien que n’étant pas populistes stricto sensu, permettent aux idéologues de l’émancipation, aujourd’hui encore, de disqualifier leurs adversaires par la reductio ad Hitlerum et la pratique de l’amalgame à sens unique.
Mais cette référence n’explique pas tout : est aussi et surtout à l’œuvre dans l’idéologie dominante l’idée du progrès continu, rejetant dans les ténèbres de l’obscurantisme tout ce qui vient du passé, de l’histoire, de la tradition, des modes de vie, en bref tout ce qui fait l’enracinement. Dès lors, cette idéologie « qui se croit et se veut désormais seule au monde, considère que toute critique extérieure, plaidant pour un monde disparu et privé de justification, vaut pour une apostasie ». Et c’est ce qui conduit les tenants de cette idéologie à assimiler les populistes à des « demeurés de l’Histoire », qui continuent de cultiver une nostalgie pour un retour sur le passé dépourvu de pertinence et entravant la marche en avant vers la « mondialisation heureuse » que l’on nous promet pour demain, mais qui est en passe de rejoindre les « lendemains qui chantent » au magasin des illusions perdues.
Le monde réel, planche de salut du populisme
L’objectif de l’auteur n’est pas de prédire l’avenir des mouvements populistes. Elle ne cache pas, et nous serons d’accord avec elle sur ce point, la puissance des moyens dont dispose la super-classe mondiale pour imposer l’idéologie cosmopolite, l’individualisme débridé et le déracinement érigé en principe moteur du progrès illimité.
Pourtant, on peut trouver en filigrane de l’ouvrage de nombreuses raisons d’espérer. L’utopie de l’émancipation totale est en effet un colosse aux pieds d’argile, pour plusieurs raisons :
• Tout d’abord, Chantal Delsol remarque que les populistes ne cherchent pas à sortir du champ de la démocratie, mais au contraire à y entrer, car ils souffrent précisément de n’être pas entendus, alors que leurs idées sont sinon majoritaires, au moins dignes d’être prises en compte. Jean-Claude Michéa décrit ainsi l’instrumentalisation du terme « populisme » par l’idéologie libérale-libertaire : « Si le mot “démocratie” doit être, à présent, affecté à la seule définition du libéralisme, il faut nécessairement un terme nouveau pour désigner ce “gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple” où chacun voyait encore, il y a peu, l’essence même de la démocratie. Ce nouveau terme, choisi par les ateliers sémantiques, sera celui de “populisme”. Il suffit alors d’assimiler le populisme (au mépris de toute connaissance historique élémentaire) à une variante perverse du fascisme classique, pour que tous les effets désirables s’enchaînent avec une facilité déconcertante. Si l’idée vous vient, par exemple, que le Peuple devrait être consulté sur tel ou tel problème qui engage son destin, ou bien si vous estimez que les revenus des grands prédateurs du monde des affaires sont réellement indécents, quelque chose en vous doit vous avertir immédiatement que vous êtes en train de basculer dans le “populisme” le plus trouble, et par conséquent que la “Bête immonde” approche de vous à grands pas. »(3). Dont acte. On remarquera simplement que ce tour de passe-passe a longtemps fonctionné, mais que ses promoteurs sont de plus en plus comme ces prestidigitateurs qui ne veulent pas se rendre compte que leurs trucs ont été dévoilés, et ne comprennent pas pourquoi ils se produisent devant des salles vides.
• D’une manière plus générale, il est permis de penser que la montée des populismes a de beaux jours devant elle, car le « déni de réalité » dans lequel cantonnent les élites dirigeantes est de plus en plus visible, et d’autant moins bien accepté que ces élites se gardent de mettre en pratique pour elles-mêmes les préceptes qu’elles imposent au peuple. Chantal Delsol résume ainsi la situation : « L’élite défend une idéologie qu’elle concrétise à travers des mesures politiques au fil des ans. Cette idéologie s’avère, sur bien des points, plus destructrice que bénéfique pour la vie quotidienne de ceux qui la subissent. Et pourtant il faut bien la défendre, puisqu’elle est une dogmatique. On impose donc au peuple de supporter les sujétions idéologiques, pendant que l’élite, plus informée et surtout plus puissante, crée des systèmes à la fois humains et performants. » On n’en finirait pas d’illustrer cette schizophrénie et cette hypocrisie des classes dominantes, qui évacuent vers les humbles et les sans grade les dégâts de la mondialisation (insécurité, chômage, immigration, école publique en perdition, etc.), et qui en réservent les effets positifs aux « heureux du monde », soit à eux-mêmes.
• Mais il ne suffit pas d’attendre passivement que l’idéologie dominante s’écrase contre le mur de la réalité. Les mouvements populistes ont souvent tendance à camper sur des positions défensives, et se contentent d’engranger des succès électoraux qui ne sont dus que très partiellement à leur action propre, et bien plus souvent aux événements extérieurs, ou à l’incurie et à la perte de crédibilité des autres forces politiques en présence. Ces mouvements sont aussi parfois tentés de jouer à contre-emploi, ou de manier la démagogie, espérant ainsi gagner quelques électeurs. Ces stratégies sont suicidaires et démontrent l’incapacité des dirigeants de ces formations à déceler la contradiction qu’il y a à utiliser pour leur propre profit des instruments dont ils critiquent l’usage par leurs adversaires, et alors même qu’ils passent leur temps à répéter que le peuple n’est pas dupe ! Certes, il ne s’agit pas de substituer une dogmatique populiste à la dogmatique dominante. Mais si l’on entend que les partis populistes ne soient pas qu’un feu de paille vite étouffé par les extincteurs du cosmopolitisme mais offrent une véritable réponse au cri de souffrance des peuples européens, il est nécessaire d’articuler un corpus d’idées cohérent, qui manque cruellement à certains d’entre eux.
• Un autre élément joue en revanche en faveur de la montée du populisme : les excès de la politique de stigmatisation et de diabolisation menée par les idéologues de l’émancipation contre tout ce qui n’entre pas dans leurs vues. Le populiste sera ainsi qualifié de « violent », « brutal », « bête », « replié sur lui-même », « rance », « moisi », « frustré », sans parler de tous les qualificatifs en « -phobe » … Le problème que ne semblent pas voir les utilisateurs de ces adjectifs fleuris est qu’ils ne visent pas essentiellement des individus, mais des opinions portées par des groupes de taille très importante, voire majoritaires. Venant d’élites ultra-minoritaires et qui plus est largement déconsidérées, il est inéluctable que ces mises au pilori soient perçues comme une forme de mépris, ou de haine du peuple. Et ce ne sont pas les incantations de nos dirigeants qui y changeront grand-chose.
De plus en plus, l’idée fait son chemin, aidée par le spectacle du monde, que les Lumières nous conduisent dans les ténèbres et que l’obscurantisme a changé de camp. C’est tout à l’honneur d’auteurs comme Chantal Delsol, et d’autres de plus en plus nombreux, d’oser sortir des catacombes où les reléguait la pensée dominante, et d’exprimer à voix haute de fortes convictions. Ce sont eux, plus que les stratèges des formations politiques, qui contribueront probablement au nécessaire aggiornamento de la pensée populiste. Je tirerai de Populisme / Les demeurés de l’Histoire, une dernière citation qui me paraît en peu de mots résumer tout le livre : « L’accusation injurieuse de populisme pourrait bien être la dernière défense par laquelle l’idéologie de la Raison, menacée dans sa légitimité, tente sa sauvegarde. »
Bernard Mazin, 20/6/2015
Chantal Delsol, Populisme / Les demeurés de l’Histoire, Ed. du Rocher, janvier 2015, 267 p.
Notes :
Cf. notamment Christopher Lasch, La Révolte des élites et la Trahison de la démocratie, Ed. Champs-Flammarion, 2007.
Cf. notamment Jean-Claude Michéa, Les mystères de la gauche, Ed. Climats, 2013.
Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal, Ed. Champs-Flammarion, 2010, p. 84.
Voir aussi :
« Populisme : les demeurés de l’histoire » de Chantal Delsol
Note de lecture de Pierre Le Vigan
« L’éloge du populisme » de Vincent Coussedière
Note de lecture de Pierre Le Vigan
« Populisme, mouvements dissidents : le grand basculement qui vient »
de Jean-Yves Le Gallou
http://www.polemia.com/populisme-les-demeures-de-lhistoire-de-chantal-delsol-2/


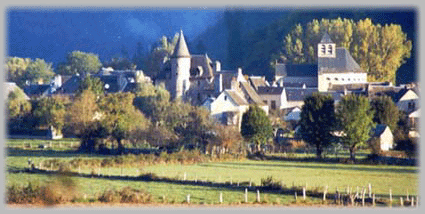


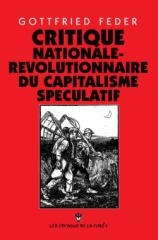 "La source principale d'où le culte de Mammon tire sa force est l'afflux sans fin de biens acquis sans effort qui résulte de l'intérêt." Gottfried Feder
"La source principale d'où le culte de Mammon tire sa force est l'afflux sans fin de biens acquis sans effort qui résulte de l'intérêt." Gottfried Feder