Les mots « occultisme » et « nazisme » sont souvent associés dans une littérature marginale occultisante et/ou extrémiste de droite dont il est possible d’établir une typologie sommaire : 1) celle condamnant l’occultisme, vu comme une manifestation du Diable, et qui fait l’amalgame avec le nazisme ; 2) celle, partisane de la théorie du complot, percevant le nazisme comme une émanation de société(s) secrète(s) ; 3) celle exonérant le nazisme au nom du combat contre les sociétés secrètes (anti-judéo-maçonnisme) ; 4) enfin, celle des adeptes stricto sensu de l’« occultisme nazi ». Pour les auteurs de ces textes, il existe donc une lecture « occulte » du nazisme, qui fait de Hitler au choix ou simultanément un médium, un agent de forces occultes, un initié aux doctrines occultistes, une personne en contact avec des voyants, des astrologues ou avec des moines tibétains, etc., de la politique raciale nazie une politique magique, ouvertement occultiste, et de la SS un ordre chevaleresque païen qui aurait collectionné les objets mystiques comme le Graal.

Manipulations de symboles
Les éléments constitutifs du mythe occultiste du nazisme sont à chercher dans des faits historiques largement sur-interprétés, comme les spéculations sur les rapports entre les nazis et la Société Thulé, assimilée à une société secrète aux objectifs racialo-occultistes, ou sur le sens de l’utilisation faite par les nazis du svastika inversé, sens supposé maléfique, voire dans l’intérêt de certains dignitaires nazis, notamment Hess, Himmler et Hitler, pour l’occultisme et l’ésotérisme, en particulier pour les runes, les symboles religieux, la réincarnation, l’Atlantide, l’Hyperborée, l’astrologie, etc. Ainsi, les nazis utilisèrent des symboles occultistes marqués comme le svastika, qui a été utilisé par les occultistes et les francs-maçons dès le XVIIIe siècle. Mais il se retrouvait également au début du XXe siècle dans toute une littérature aryaniste, pseudo-scientifique et occultisante traitant la préhistoire germanique dont les principaux représentants étaient Guido von List et Jörg Lanz von Liebenfels, références de certains dignitaires nazis.
Enfin, les derniers éléments « occultes » sont à chercher au sein de la SS, à son utilisation de symboles issus de l’antiquité germano-scandinave, en particulier les runes. Himmler désirait recréer une pseudo-culture germanique primitive, nordiciste, à partir d’un passé mal compris interprété par le prisme de l’occultisme völkisch afin de justifier ses prétentions à une nouvelle domination du monde. Pour cela, il créa en 1935 un institut de recherche, dépendant de la SS, l’Ahnenerbe Institut (« héritage des ancêtres »), qui associait scientifiques de renom et auteurs völkisch, recherches archéologiques scientifiques et spéculations aryanistes. Il nomma aussi à des grades élevés de nombreux occultistes, néo-païens et racistes, les aryosophes. Certains, comme Karl Maria Wiligut ou Otto Rahn, jouèrent un rôle important, dans l’élaboration après guerre du mythe de l’« occultisme nazi ». C’est Wiligut qui conçut dès 1931 le dessin des bagues runiques à tête de mort et qui élabora, plus tard, des rituels SS « païens », notamment de mariage et d’enterrement afin de donner à l’idéologie SS un aristocratisme mâtiné d’antiquité nordique. Ces idées seront reprises sans recul après guerre, par ses détracteurs comme par ses partisans, donnant corps à un nordicisme occultisant.
Une interprétation ancienne, au succès récent
Cependant, les spéculations occultistes sur le sens du racisme nazi sont apparues dès l’avènement de ce régime. À l’origine, cet amalgame a été le fait de milieux catholiques hostiles au nazisme, voire d’opposants au régime comme l’ancien nazi Hermann Rauschning. Après la Seconde Guerre mondiale, ce thème a été repris et diffusé auprès du grand public, en 1960, par le best-seller de Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le matin des magiciens, puis par leurs épigones, adeptes d’une interprétation occultiste de l’histoire, l’« histoire mystérieuse ». Depuis cette époque, ce thème a largement dépassé le cercle restreint des spéculations occultistes pour se diffuser dans la culture de masse contemporaine : littérature populaire, bandes dessinées, jeux vidéo, jeux de rôle, voire le cinéma avec les premier et troisième opus de la série des Indiana Jones (Les Aventuriers de l’Arche perdue – 1981 – et La dernière croisade –1989) dans lesquels le héros se trouve confronté à des scientifiques SS partis à la recherche de l’Arche d’Alliance puis du Graal.
Parallèlement à ces canaux de diffusion, profitant de ce succès éditorial, l’« occultisme nazi » a été repris et largement propagé par certains milieux néo-nazis, très hétérodoxes, composés d’anciens SS et d’occultistes néo-nazis comme Savitri Devi, qui fit de Hitler un avatar d’une divinité indienne, et Miguel Serrano, à l’origine de la théorie de la fuite de Hitler en soucoupe volante. Dès les années 1950, ces auteurs ont cherché à utiliser stratégiquement le thème de l’« occultisme nazi ». Ceux-ci suivent trois buts :
1) en faisant une apologie plus ou moins détournée du national-socialisme, notamment en entérinant l’idée que la SS était un ordre chevaleresque néo-païen occultiste, une élite raciale et intellectuelle ;
2) en produisant un travail de révisionnisme, voire de négationnisme, en montrant la validité globale de l’idéologie nazie, du nordicisme et de la mystique de la race.Selon les partisans de cette doctrine, les Aryens sont d’origine hyperboréenne. Race primordiale, supérieure intellectuellement et racialement, les Aryens, fuyant le cercle polaire, auraient transmis leur sagesse aux autres peuples. Ces auteurs dénient donc la faculté de fonder des civilisations aux peuples non-blancs ;
3) enfin en réécrivant l’histoire, le nazisme et les dignitaires nazis subissant un processus de « mythologisation ». Les personnages, les faits historiques disparaissent au profit d’une image mythique et le nazisme se « folklorise » : la politique génocidaire nazie reste globalement condamnée, bien que largement euphémisée mais devient un élément important de la politique magique nazie, tandis que les nazis deviennent des personnes spirituellement intéressantes.
En dépit des démonstrations des partisans ou des détracteurs de l’« occultisme nazi », le nazisme ne fut pas un mouvement occulte. Les nazis étant le produit de leur époque, très sensible à l’occultisme, leur intérêt pour l’occultisme aryanisant apparaît donc moins comme un facteur d’influence que comme un symptôme précurseur du nazisme. Mais, à décharge, il faut reconnaître que Himmler a tout fait pour entretenir ce mythe.
Après un vif intérêt durant les décennies 1960 et 1970, et après s’être diffusée dans la culture populaire, cette littérature a décliné dans les années 1980 pour réapparaître sur Internet au début des années 2000. Cela peut s’expliquer par l’ensemble des éléments structuraux et historiques qui ont été précédemment soulignés, mais aussi par le fait que les sociétés occidentales sont avides de révélations « occultisantes ».
Stéphane François
Fragments sur les temps présents :: lien
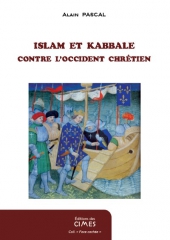 Le catholique Alain Pascal s’est fait connaître dans les années 90 et 2000 par une série d’articles (dans le Libre Journal de Serge de Beketch) et d’ouvrages originaux, s’évertuant à dévoiler la face cachée de grands phénomènes historiques.
Le catholique Alain Pascal s’est fait connaître dans les années 90 et 2000 par une série d’articles (dans le Libre Journal de Serge de Beketch) et d’ouvrages originaux, s’évertuant à dévoiler la face cachée de grands phénomènes historiques.