culture et histoire - Page 1357
-
Fraction - L'obéissance
-
Les Brigandes - Antifa (nouvelle version après censure)
-
Knut Hamsun : entre modernité et tradition
Knut Hamsun est un aventurier qui a parcouru les styles, les genres et les époques. Génie aujourd’hui infréquentable et oublié, le Norvégien a laissé au monde littéraire une œuvre dense comme une forêt du Nord, tour à tour obscure et enchanteresse. Conteur moderne, il s’est attaché à fuir les carcans de la littérature de son époque, et ceci en travaillant à la fois la psychologie de ses personnages et la langue à la manière d’un orfèvre.
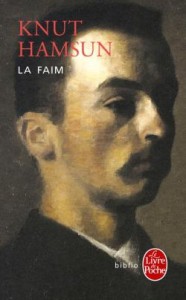
Si l’écrivain scandinave Martin Nag qualifie Knut Hamsun de « Dostoïevski norvégien », c’est sans doute parce qu’il a été très influencé par le réalisme de l’auteur des Possédés(précisons que le réalisme russe n’est pas celui de la tradition française) et ce, même si son parcours littéraire l’a entraîné bien plus loin. C’est au travers d’un article paru en 1890 dans la revue Samtiden, intitulé De la vie inconsciente de l’âme, que Knut Hamsun révèle son projet littéraire. Dans ce pendant théorique de La Faim (1890), roman majeur, l’auteur montre la liaison qu’il entend opérer, tout du moins de façon inconsciente, entre l’individualisme de Nietzsche (quoiqu’il ne l’ait ni lu, ni rencontré) et la modernité de Franz Kafka. Hamsun s’est imprégné de philosophie nietzschéenne grâce à l’influence de Georg Brandes, qui donne à partir de 1888 une série de conférences sur l’auteur du Gai Savoir en Scandinavie. Une mentalité qui se retrouve dans Ciel sombre, ultime chapitre du dernier ouvrage que consacre Hamsun à son voyage en Amérique. Moquant allègrement ses prédécesseurs, et notamment Guy de Maupassant, il s’attache à explorer les tréfonds de l’âme humaine, à commencer par la sienne. C’est ainsi que la Faimprend la forme d’un roman quasi autobiographique. Knut Hamsun fait du personnage principal, un anonyme, un urbain moderne, sans visage, sans racines, preuve de sa volonté de rompre avec les anciens codes du réalisme et du naturalisme du XIXe siècle déclinant. Naturalisme qui s’attachait davantage à décrire avec minutie les lieux, les personnages et les objets, dans l’objectif de retranscrire fidèlement la « nature ».
Knut Hamsun et la modernité de la langue
Bien plus qu’un roman social traitant de la misère et de l’errance d’un homme dans une capitale européenne qui lui est totalement inconnue, La Faim est un roman psychologique qui met son narrateur en face d’un alter-ego, compagne ambiguë, qu’il entretient pour cultiver l’inspiration nécessaire à son travail littéraire : « J’avais remarqué très nettement que si je jeûnais pendant une période assez longue, c’était comme si mon cerveau coulait tout doucement de ma tête et la laissait vide. » Ce personnage parcourt le roman en équilibre, entre moments de génie et d’éclat, entre tortures physiques et mentales. Il écrit ainsi : « Dieu avait fourré son doigt dans le réseau de mes nerfs et discrètement, en passant, il avait un peu embrouillé les fils… » Ce personnage ambivalent permet à Hamsun d’évoquer ses propres névroses et d’annoncer un autre objectif de sa vie : l’esthétique de la langue. Il n’aura de cesse de la travailler, parfois avec fièvre. Kristofer Janson, poète et prêtre qui a connu Hamsun, dit ne connaître « personne aussi maladivement obsédé par l’esthétique verbale que lui […]. Il pouvait sauter de joie et se gorger toute une journée de l’originalité d’un adjectif descriptif lu dans un livre ou qu’il avait trouvé lui-même ». Dans La Faim, le personnage entretient un rapport imprévisible et tumultueux à l’écriture : « On aurait dit qu’une veine avait éclaté en moi, les mots se suivent, s’organisent en ensembles, constituent des situations ; les scènes s’accumulent, actions et répliques s’amoncellent dans mon cerveau et je suis saisi d’un merveilleux bien-être. J’écris comme un possédé, je remplis page sur page sans un instant de répit. […] Cela continue à faire irruption en moi, je suis tout plein de mon sujet et chacun des mots que j’écris m’est comme dicté. » Son premier roman inaugure donc un travail sur l’esthétique de la langue. Auparavant, Hamsun parlait un norvégien encore « bâtard », paysan, et assez éloigné du norvégien bourgeois de la capitale. C’est probablement ce à quoi il pensait en écrivant dans un article de 1888 : « Le langage doit couvrir toutes les gammes de la musique. Le poète doit toujours, dans toutes les situations, trouver le mot qui vibre, qui me parle, qui peut blesser mon âme jusqu’au sanglot par sa précision. Le verbe peut se métamorphoser en couleur, en son, en odeur ; c’est à l’artiste de l’employer pour faire mouche […] Il faut se rouler dans les mots, s’en repaître ; il faut connaître la force directe, mais aussi secrète du Verbe […] Il existe des cordes à haute et basse résonance, et il existe des harmoniques… »
Lire la suite sur PHILITT -
Méridien Zéro #239: "Quelle armée française dans un monde globalisé ?"
Ce vendredi soir, Méridien Zéro a l'honneur de recevoir le colonel (ER) Jacques Hogard, officier de la Légion étrangère, nommé lieutenant-colonel en 1993 à l'âge de 37 ans et commandant du groupement de Légion Étrangère lors de l'opération Turquoise au Rwanda en 1994. À ce titre, il est membre fondateur de l'association France-Turquoise, dont la raison d'être est la défense de la vérité sur l'action de la France au Rwanda. Après cette opération, il est engagé en Macédoine et au Kosovo comme commandant du groupement interarmées des forces spéciales. Il est largement revenu sur ces événements dans son ouvrage L'Europe est morte à Pristina (2014). Le colonel a pris sa retraite anticipée en 2000. Nous évoquerons avec lui la situation de l'armée française et les enjeux qu'elle doit affronter dans le contexte qui est le nôtre.
A la barre et à la technique, Eugène Krampon et Wilsdorf.

-
Frédéric Lordon : Valeur travail, capitalisme et angle Alpha
À travers une vidéo exploratoire de la pensée de Frédéric Lordon, Usul nous offre l’occasion de revenir sur la « valeur travail » omniprésente dans les discours politiques et sur les conflits d’intérêts qui séparent travailleurs et patrons.
Avez-vous déjà entendu parler de l’angle Alpha ? Cette théorie développée par M. Lordon décrit l’angle Alpha comme étant l’écart entre le désir maître (celui de l’employeur) qui a enrôlé des puissances d’agir (les employés) au service des objectifs de l’entreprise et les désirs de ces mêmes employés.
Il en résulte un écart de volontés, une zone d’incertitude, cause de dissonance pour le travailleur. Compliqué ? L’angle alpha, c’est un peu votre personnalité dissidente, votre faculté à dire « non » lorsque vous ne désirez pas étouffer vos désirs personnels au profit de désirs autres que les vôtres, le plus souvent à des fins marchandes.
Moins politique que philosophique, cette vidéo d’Usul tente, grâce aux thèses de Frédéric Lordon, de nous montrer de quelle manière les grandes entreprises nous saisissent, nous investissent et nous façonnent. Pour se faire, Usul analyse les propos tenus lors d’une émission tournée il y a quelques années alors que Frédéric Lordon était l’invité de Judith Bernard, venu pour parler du travail et du capitalisme d’un point de vue Spinoziste.
-
La pédagogie Montessori
France 2 s’est intéressé à la pédagogie Montessori :
-
"Les monarchies offrent un regard différent sur le mode de gouvernement."
" Les monarchies offrent un regard différent sur le mode de gouvernement. En Europe, les citoyens sont de plus en plus méfiants à l’égard du politique qui apparaît comme un monde tourné sur lui-même, sclérosé. La monarchie est le symbole de la continuité de la nation et du pouvoir. Elle joue un rôle rassurant en période de crise, comme en Belgique où pendant deux ans, le pays a été sans gouvernement. Elle peut incarner la résistance, comme en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ou être un relais vers la naissance de la démocratie comme en Espagne en 1975. La monarchie est un atout : elle offre un niveau supplémentaire d’organisation constitutionnelle qui permet un rapport plus serein au pouvoir. " (source DNA / photo Europe1)
M. Vincent Meylan, Chef du service Royautés à Point de vue,
dans Les dernières nouvelles d’Alsace
http://www.actionfrancaise.net/craf/?Les-monarchies-offrent-un-regard
-
Fraction - Lobotomie - Le son d'histoire
-
La mort du roi et les secrets de Saint Fargeau (Marion Sigaut)
-
Références et thèmes des droites radicales au XXe siècle (Europe/Amériques)
dir., Références et thèmes des droites radicales au XXe siècle (Europe/Amériques), Peter Lang, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2015, 368 p.
Présentation de l’éditeur : Après avoir abordé les droites radicales européennes et américaines au vingtième siècle sous l’angle des doctrinaires, des vulgarisateurs et des passeurs puis analysé l’internationalisation de leurs supports et de leurs vecteurs, l’objet de ce troisième volume du projet de recherche IDREA (Internationalisation des droites radicales – Europe/Amériques) a été d’étudier le caractère fédérateur d’un certain nombre de références et de thèmes.
Réunissant une douzaine de chercheurs français, européens, comme américains du Nord et du Sud, issus de différentes disciplines, l’ouvrage s’attache à privilégier la mise en exergue de références et de thèmes transversaux au sein des droites radicales européennes et américaines depuis les lendemains du second conflit mondial.
Cinq entrées sont proposées : Figures de chefs, Mémoire(s) et histoire(s) des régimes et des combats perdus, Antisémitisme et anticapitalisme, Conservatisme, radicalités et anticommunisme, L’Occident en questions.L'ouvrage 
Sommaire
– Olivier Dard : Présentation générale
– Francis Balace : La pourpre où dorment nos chefs morts …
– Christoph Brüll : Léon Degrelle comme référence des droites radicales allemandes après 1945
– Miguel Angel Perfecto : La mémoire imposée du franquisme. Le mythe de José Antonio Primo de Rivera et l’école nationale-catholique
– Pauline Picco : Les référents politiques et intellectuels de l’extrême droite italienne : un panthéon mythique (1950-1970)
– Nicolas Lebourg/Jonathan Preda : Le front de l’Est et l’extrême droite radicale française: propagande collaborationniste, lieu de mémoire et fabrique idéologique
– Ana Isabel Sardinha Desvignes : L’Empire colonial portugais et ses mythologies : du sébastianisme messianique au lusotrpicalisme
– Humberto Cucchetti : Droites radicales et péronisme : un mélange de traditions anticapitalistes?
– Valérie Igounet : Le négationnisme : l’expression d’un nouvel antisémitisme contemporain, international et protéiforme (1948-2013)
– Michel Grunewald : Merkur (1947-1952)
– Romain Huret : Aux origines du conservatisme contemporain aux EtatsUnis. Classes moyennes, mobilisations antifiscales et défense des valeurs américaines (1945-1964)
– Michel Bock/Hugues Théorêt : Le communisme et la guerre froide dans le Canada français d’après-guerre
– Riccardo Marchi : La défense de l’Occident : la dernière tranchée pour l’extrême droite européenne des années de guerre froide
– Olivier Dard : De la « Défense de l’Occident » à l’« Occident comme déclin ».