Editorial du n°39 de la revue  Synthèse nationale
Synthèse nationale
Nous l’avons rappelé à maintes reprises dans cette revue, le choix est le suivant : soit on se soumet à la volonté des castes dirigeantes actuelles et on accepte comme une fatalité que la nation française et l’identité européenne se diluent dans un vaste magma aux dimensions planétaires dans lequel l’homme ne serait plus qu’un consommateur déraciné juste bon à enrichir les comptes des groupes financiers dont les sièges sont le plus souvent établis outre-Atlantique, soit on refuse.
Si vous acceptez, c’est simple. Vous vous contentez du prêt à penser ressassé à longueur de journée dans les médias ou à l’école où l’on vous explique que le monde doit être unifié, pacifié, métissé et asexué ; que vous devez consommer tel ou tel produit, vous habiller avec telle ou telle marque et admirer tel ou tel spectacle ; que vous devez voter pour tel ou tel parti à condition bien sûr que ceux-ci disent à peu près tous la même chose. Bref, votre vie sera parfaitement programmée et encadrée et gare aux dérapages...
En acceptant cette logique de soumission, vous vous contenterez d’être l’égal des autres, de faire la même chose qu’eux, de vivre comme eux, de raisonner comme eux... Mais c’est tellement plus confortable de penser et consommer comme tout le monde puisque, ainsi, personne ne viendra vous contredire.
Mais, il y a un envers à cette médaille. En renonçant à toutes critiques du Système, vous êtes condamnés à accepter docilement toutes ses folies.
Ne vous plaignez pas
Lorsqu’une assemblée d’actionnaires avides ou un aéropages de hauts-fonctionnaires apatrides décident, au nom du profit immédiat, d’éliminer un secteur entier de l’économie d’un pays, engendrant ainsi des milliers de chômeurs en plus avec tous les drames que cela peut entrainer, il ne faut pas se plaindre…
Lorsqu’un gouvernement, composé de gens qui pour certains d’entre eux ont acquis la nationalité française depuis peu, décide, sans se soucier un instant des multiples agressions dont sont victimes quotidiennement des dizaines de milliers de Français de souches, de débloquer des sommes ahurissantes pour combattre un racisme et un antisémitisme fantasmé et cela afin que les juifs et les musulmans puissent vivre tranquilles en France, il ne faut pas se plaindre…
Lorsque des technocrates peu scrupuleux décident de souiller définitivement une grande partie de nos magnifiques paysages en implantant un peu partout d’horribles éoliennes dont l’utilité et la productivité énergétique restent à prouver, il ne faut pas se plaindre…
Si vous regardez de plus près ce qui vous sont proposés, vous vous rendez vite compte que les produits qu’on vous invite à consommer proviennent presque toujours des mêmes multinationales, que les partis pour lesquels il est de bon ton de voter défendent pratiquement la même politique, que les livres qui jouissent d’une promotion médiatique vont toujours dans le sens des idées à l’endroit, que toutes les chaines de télévision et toutes les radios divulguent le même message… La société de consommation d’aujourd’hui a, finalement, exactement les mêmes caractéristiques que les dictatures marxistes d’hier. Les dazibaos ont été remplacés par le journal de 20 h et les défilés du 1er mai par les marches blanches incontournables après chaque fait divers où l’émotionnel est de rigueur. Il n’y a finalement que l’emballage qui a changé. Le Système est prêt à tout pour imposer sa conception globalisée du monde.
Pour notre part, nous refusons cette réduction uniformisée et aseptisée de l’Humanité. Et, ces temps derniers, nous avons l’impression d’être de plus en plus nombreux dans ce cas.
Les symptômes de la rébellion
En effet, en France et un peu partout en Europe les symptômes de la rébellion se multiplient. Ceux-ci prennent des formes multiples et diverses. Que ce soit dans les rues, avec les manifs contre l’immigration en Allemagne ou en Italie qui rassemblent des foules impressionnantes, ou dans les urnes, avec les résultats jamais égalés ici et là des formations nationales ou prétendues telles. On assiste à une prise de conscience des Européens de la nécessité de reprendre en main leur destin contre la volonté d’un Système qui repose sur la pensée unique. Cela porte un nom, ça s’appelle « la dissidence » !
Cette dissidence, depuis des décennies, nous autres nationalistes et identitaires la souhaitons et la préparons.
Nous la souhaitons car nous avons toujours refusé de nous soumettre au mondialisme assassin des nations et des identités. Nous ne voulons pas voir nos peuples d’Europe disparaître dans ce grand brassage que l’écrivain Renaud Camus a appelé si justement « le grand remplacement ». Et lorsque nous disons cela, c’est sans aucun mépris pour les autres peuples qui eux-mêmes, par voie de conséquences, seraient aussi amenés à subir le même triste sort.
Nous la préparons car nous savons que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Face à la tyrannie sournoise du pouvoir, face à son arsenal répressif, face à ces moyens colossaux et à sa panoplie de mensonges, nos modestes revues, nos mouvements souvent éphémères, nos groupes de camarades ne représentaient pas grand-chose. Et pourtant leur travail de fourmi commence à avoir des résultats. A force de répéter inlassablement la vérité, celle-ci finit par être écoutée. Maintenant, elle doit être entendue. La paupérisation galopante, l’intensification des flux migratoires, le développement de l’insécurité, l’implantation en profondeur sur notre terre de l’islam, la disparition progressive de ce qui faisait la spécificité de la France… tout cela, nous l’avions annoncé depuis longtemps. Les événements nous donnent chaque jour de plus en plus raison.
Faire l’Europe pour refaire la France
Depuis sa création, en novembre 2006, Synthèse nationale a toujours combattu pour la renaissance d’une France française dans une Europe européenne. Nous voulons une Europe dégagée de l’influence économique et politique des lobbys mondialistes, une Europe qui renoue avec ses traditions et son identité, une Europe qui retrouve sa force, sa vitalité et sa place majeure par rapport aux autres blocs existants ou émergeants. Revendiquer aujourd’hui un tel projet peut sembler totalement chimérique… Et pourtant, lorsqu’en 1974 Alexandre Soljenitsyne se battait pour la chute de l’Union soviétique et la renaissance de la Vieille Russie, beaucoup le prenait pour un illuminé. On connaît la suite…
Soljenitsyne était un dissident. Nous sommes des dissidents. Pour sauver notre nation et notre civilisation la dissidence est un devoir. La dissidence finit toujours par l’emporter. Le combat continue.
notes
Roland Hélie est Directeur de Synthèse nationale
Synthese nationale :: lien
http://www.voxnr.com/cc/dh_autres/EuFEVkkyuuVjMbBjXx.shtml
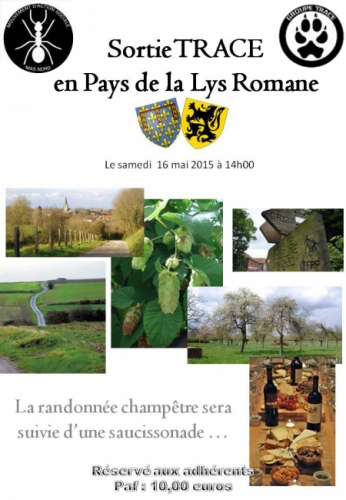
 Synthèse nationale
Synthèse nationale
 Ce dimanche 10 mai à Paris, plusieurs milliers de patriotes sont venus honorer sainte Jeanne d’Arc, le jour de sa fête.
Ce dimanche 10 mai à Paris, plusieurs milliers de patriotes sont venus honorer sainte Jeanne d’Arc, le jour de sa fête.
