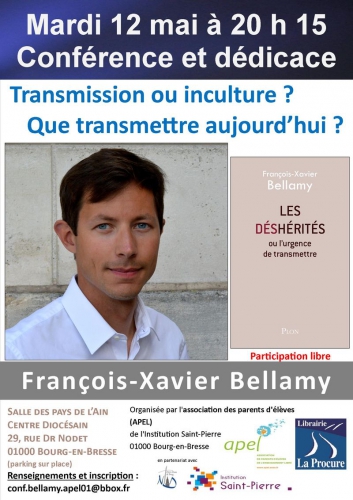Polémiste, écrivain politique, critique littéraire, Maurice Bardèche (1907 – 1998) a été tout cela. Son image reste sulfureuse. Elle l’est même beaucoup plus que dans les années 1950, preuve que nous avons fait un grand pas vers le schématisme, l’intolérance et l’inculture. Philippe Junod, aidé de sa femme, a voulu mieux faire connaître celui qui fut le beau-frère et l’ami de Robert Brasillach mais qui avait, bien entendu, son tempérament, ses goûts et son histoire propres. Le pari de mieux connaître Bardèche est tenu dans le cadre des Cahiers des Amis de Robert Brasillach.
Officiellement apolitique jusqu’en 1945, ses activités hors enseignement n’allèrent guère au-delà, sous l’Occupation, d’essayer de sauver Jean Cavaillès. Plus handicapé qu’aidé par ses liens familiaux trop voyants, il passe de maître de conférence à la Sorbonne à professeur à l’Université de Lille où il n’avait aucune attache.
Ce qu’il ressort des études consacrées à Bardèche, est l’unité de sa vision des choses, du politique au littéraire. Cela ne veut évidemment pas dire que l’on soit obligé d’être « fasciste » pour, en même temps, lui reconnaître d’avoir beaucoup apporté à la connaissance de Balzac ou de Proust. Mais il faut reconnaître que ce qu’il appelle « fascisme » est en fait quelque chose qui va au-delà d’un épisode historique, aussi important qu’il ait été (et sachant qu’il fut définitivement clos en 1945). Au-delà : c’est-à-dire une critique de la domination de l’économie sur nos vies, et une critique de la domestication de l’homme par le monde moderne.
Bardèche était non pas un homme de concepts mais un homme de principes. Il été pionnier en maints domaines dans une large mouvance intellectuelle : la critique de la « conscience universelle », c’est-à-dire l’appareil idéologique du nouvel ordre mondial américain, le refus de l’uniformisation planétaire par le règne des marchands, le souci de la liberté des peuples et de la continuité de ceux-ci qui doivent rester fidèles à leurs instincts (thèse assez rousseauiste), l’appel à l’indépendance de l’Europe. Pour des raisons parfaitement évidentes, il était conscient de ne pouvoir être à la bonne distance pour juger de l’action du général de Gaulle. Aussi demandait-il des avis autour de lui. Il faisait partie de ceux qui, à tort ou à raison (je m’interroge moi-même), ne prenait pas au sérieux la troisième voie gaullienne.
De la création du modeste Mouvement social européen, qui n’était certes pas un mouvement de masse, à novembre 1982, date de la parution du dernier numéro de sa revue Défense de l’Occident (elle accueillit quelques uns de mes premiers articles), fondée trente ans plus tôt, Bardèche a été le principal « doctrinaire » (mais on hésite à employer ce terme un peu trop sec et désincarné) mais plus encore le principal écrivain du nationalisme européen. Il a permis à beaucoup de ceux qui l’ont lu d’aller au-delà, ou ailleurs, preuve que c’était avant tout un homme libre, un rebelle non aligné.
Les témoignages regroupés dans le Cahier des A.R.B., souvent chaleureux, mais aussi bien sûr parfois critiques, aident à mieux connaître celui que l’on veut réduire à des caricatures, tant notre époque aime les idées simples, et fausses de préférence. Ce sont les idées les plus confortables, et notre époque aime son petit confort. Un excellent libraire, bibliophile de province, juif, et parfaitement (sic) de gauche me disait, à propos de la biographie de Balzac par Bardèche (Julliard, 1980) : « Il faut reconnaître que c’est quand même la meilleure des études parue sur Balzac ».
Pierre Le Vigan
• Cahiers des amis de Robert Brasillach, « Maurice Bardèche l’insoumis », n° 51 – 52, courriel : brasillach@europe.ch
• D’abord mis en ligne sur Métamag, le 20 mars 2015.
http://www.europemaxima.com/