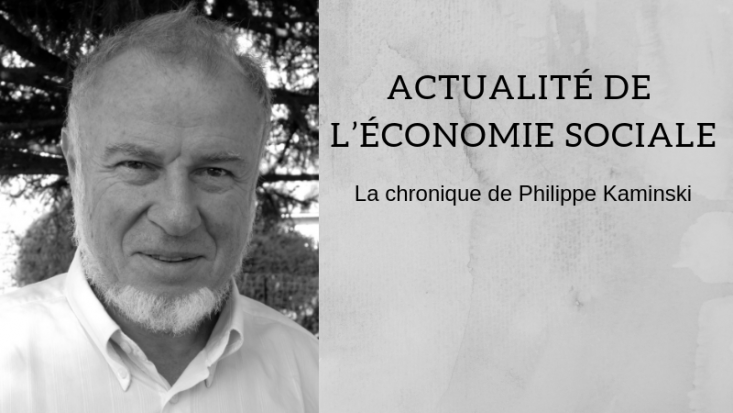
Comment sortir du dualisme castrateur entre un État devant lequel on se prosterne et un Marché, qui certes peut être parfois bénéfique mais qui serait toujours dangereux ? Telle est la réflexion entamée par Philippe Kaminski depuis deux semaines. Aujourd’hui, retour sur une « Troisième voie » esquissée au lendemain des événements de Mai 1968.
Actualités de l’économie sociale
Co-fondateur avec Charles Gide en 1921 de la Revue des études coopératives, de nos jours connue sous le nom de RECMA, Bernard Lavergne est aujourd’hui bien oublié. Et il ne faut hélas guère compter sur votre serviteur pour vous le faire mieux connaître. Je n’ai en effet trouvé que fort peu de références tant sur sa vie que sur son œuvre. Sa notice Wikipédia est quasiment vide, ce qui laisse entendre que personne ne s’est senti assez motivé, ou assez autorisé, pour l’alimenter.
Il est mort en 1975, dans sa 91e année. Aucun des dirigeants ou des connaisseurs du paysage coopératif français qui l’ont fréquenté et que j’ai pu rencontrer par la suite n’est encore de ce monde et ne peut donc m’éclairer. En 1921, Bernard Lavergne a 37 ans, alors que son maître Charles Gide en a le double. Il a soutenu sa thèse en 1908, sur le Régime coopératif, et publia ensuite de nombreux ouvrages sur le même thème, en plus de sa direction de la Revue ; pourquoi donc cite-t-on toujours autant Gide, et jamais Lavergne ? Peut-être l’an prochain, à l’occasion du centenaire de la RECMA, se trouvera-t-il un chercheur un peu curieux pour se pencher sur la question.
À vrai dire, ce n’est pas Lavergne qui m’intéressait, c’était Mai 1968. Je cherchais ce qu’avaient pu écrire à l’époque les représentants, non de l’Économie Sociale qui n’allait re-naître que dix ans plus tard, mais de ses composantes, et en particulier du mouvement coopératif. Et je suis tombé sur un article de Lavergne, qui vaut la peine d’être exhumé et commenté à la lumière des enjeux actuels.
Il ne s’agit que d’un point de vue, un seul. D’autres, plus ou moins contingents, plus ou moins prospectifs, pourront être collectés, au hasard des bulletins des fédérations ou des publications des mutuelles, et lui être opposés. Je ne veux donc pas en tirer de conclusion générale.
Bernard Lavergne écrit à l’automne 1968, alors que la France reprend son souffle et que l’économie repart vigoureusement. Il écrit dans sa revue, c’est à dire qu’aucun comité de lecture ne s’est mis en travers de lui pour le forcer à arrondir ses angles ou à se sortir de ses anciennes marottes. Il a 84 ans passés, et je ne sais s’il est perçu par son entourage comme un Sage respecté ou comme un vieux radoteur. Son texte tient en tous cas de ces deux réalités.
Lavergne place résolument ce qu’il nomme le socialisme coopératif, et que je traduis d’emblée par Économie Sociale, dans la position d’une Troisième Voie :
« [Il nous faut…] briser le dilemme qui consiste à dire : ou le capitalisme privé avec sa haute productivité, mais son injuste répartition du revenu national, ou le socialisme d’État avec sa lourdeur bureaucratique et son improductivité, mais son équité dans la répartition du revenu national. Un troisième type économique tout à fait original existe : le socialisme coopératif , qui possède la productivité de l’ordre capitaliste et autant d’équité sociale, sinon plus, que le socialisme d’État. »
Autre intuition juste, qui n’allait pas de soi : Lavergne tire comme principale leçon des événements de mai-juin que l’on a assisté à la naissance d’un courant durable d’idées s’opposant à la « société de consommation ». Certes, ces termes ont été souvent mis en avant par les mouvements contestataires, mais d’autres l’ont été tout autant. Et on aurait pu s’attendre, compte tenu des rapports équivoques que le monde coopératif était alors contraint d’entretenir avec l’Union Soviétique, que Lavergne s’attardât davantage sur les accords de Grenelle (ce n’était pas rien !) ou sur la question gauchiste.
Mais ces deux lignes directrices porteuses d’avenir sont contrebalancées par des archaïsmes qui font frissonner. Bernard Lavergne fut dans le civil un universitaire, professeur d’économie. Or les thèses économiques qu’il développe ne semblent guère avoir évolué depuis les leçons de Charles Gide qu’il suivait soixante ans auparavant. Lavergne constate l’emprise croissante de l’État, mais il feint de n’avoir jamais entendu parler de Keynes, ni du planisme, ni de la comptabilité nationale. Il constate le progrès technique, mais il le voit comme on le voyait avant Schumpeter. Il parle du travail comme on en parlait avant Ford, de la consommation comme on en parlait avant la publicité, et surtout de l’industrie comme on la décrivait avant Léontief. C’en est déstabilisant :
« Nos pouvoirs publics fixent souverainement le destin de nos entreprises capitalistes, le montant de leurs gains et de leurs pertes. C’est par pieuse habitude […] qu’on dira […] que nos sociétés sont à économie dirigée, alors qu’elles sont déjà plus qu’à moitié socialisées. Cette mutation est une grande nouveauté car, au siècle précédent, si faible était l’emprise de l’État et si stable était le niveau des prix que les gains et les pertes des entrepreneurs ne dépendait que de leur habileté ou de leur incapacité à gérer leurs entreprises. Voici que tout a changé. Les fluctuations des prix sont devenues si amples que […] gagner ou perdre de l’argent est maintenant plus fonction des décisions étatiques et de la conjoncture que du mérite intrinsèque des entrepreneurs. Gains et pertes ont été socialisés, et les chefs d’entreprise ne sont plus que des gérants d’affaires pour le compte de la puissance publique. Cette socialisation, camouflée mais réelle, des grandes industries, s’observe dans la France gaulliste comme en Allemagne et en Italie. »
Lavergne appelle dès lors « régies d’État » l’ensemble des entreprises françaises en qui il ne voit que des clones de Renault, et affirme que ce système ne pourra être en mesure de répondre aux aspirations des étudiants de 1968 qu’il résume en trois chapitres : diminuer la durée du travail, assurer aux individus plus de liberté effective dans leur vie de tous les jours, enfin réduire l’éventail des inégalités de revenus. Reprenant à son compte ces revendications, il admet qu’elles ne permettront qu’une croissance faible et suggère que l’hédonisme et la liberté de conscience puissent compenser une limitation de fait de la quête de biens matériels, cette « société de consommation » à peine née et qu’il faut déjà combattre.
Tout ceci participe certes de la confusion des esprits qui était commune à l’époque. On ne peut exiger de chacun clairvoyance et prémonition. Mais on attend de Lavergne, cinquante ans après, non pas d’avoir esquissé un projet de société qui nous séduise, mais de préciser ce qu’il entendait par socialisme coopératif et de nous expliquer comment ça pourrait marcher. Et sur ce point, il se montre parfois convaincant, mais le plus souvent décevant.
Aux régies d’État, Lavergne oppose les « régies coopératives » dont il voit un modèle dans le Crédit communal de Belgique. Cette institution créée en 1860 fonctionnait comme une coopérative de crédit, autrement dit une banque, dont les sociétaires sont des collectivités locales, une formule hybride qui subsista jusqu’à sa fusion en 1996 avec le Crédit Local français pour former le conglomérat financier Dexia. L’aventure tourna court, car ni la tradition coopérative belge, ni les habitudes prises en France au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations n’empêchèrent Dexia de se plonger avec délectation dans la spéculation financière et boursière la plus effrénée, comme si les nouveaux venus dans ce monde douteux avaient tenu à prouver qu’ils pouvaient d’emblée se porter au niveau de cynisme des Lehmann Brothers et autres Goldman Sachs. De malversation en malversation, Dexia fut acculé à une faillite retentissante en 2011, que les États français et belge durent éteindre en urgence avec les milliards des contribuables des deux pays.
Pendant toute sa vie, Lavergne avait fait l’éloge du Crédit Communal de Belgique, dont la longue et sage histoire ne mérite certes pas d’être ternie par la lamentable déconfiture de Dexia. Il n’en demeure pas moins que ce modèle ne saurait se prévaloir d’un caractère universel. Tout au plus se rapproche-t-il des puissantes régies municipales germaniques, qui certes polarisent une part non négligeable de l’économie allemande, mais qui ont sans doute aussi contribué à ce que l’idée d’Économie Sociale n’y ait toujours pas pénétré. Par ce tropisme, Lavergne se rapproche plus d’Edgar Milhaud, père du concept d’économie collective, que de Charles Gide (et je m’amuse à constater que sur ces trois personnages, deux sont nés à Nîmes, et le troisième à Uzès).
Ceci dit, on voit mal comment une transposition de ce système coopératif de communes aurait pu s’acclimater en France et surtout y devenir assez puissante pour constituer la colonne vertébrale d’une Troisième Voie crédible et conquérante. Lavergne pouvait bien se persuader que c’est par un semblable truchement que s’établira de proche en proche un transfert des pouvoirs aux citoyens consommateurs pour former un jour la République coopérative, cette Jérusalem terrestre qu’il appelle de ses vœux ; plus il vieillira, et moins ces élucubrations auront de crédit. En 1968, il n’en restait plus rien.
Aujourd’hui, l’intérêt porté aux « territoires » peut redonner une chance à cette idée, à condition de tout reprendre à zéro. Il ne s’agira ni des grandes villes, ni même des moyennes, mais de cette France interstitielle, périphérique, qui se sent déclassée, et où les municipalités élues ont vu leurs principaux pouvoirs transférés aux EPCI (communautés de communes). L’espace y est libre pour l’organisation de solidarités économiques de proximité, l’Économie Sociale y est présente, c’est même là qu’elle est le plus innovante, le plus dynamique. Sans parler de réhabilitation, certains combats de Bernard Lavergne pourraient y trouver comme un parfum de précurseur.
Lire les dernières chroniques de Philippe Kaminski
– Est-ce le temps de sortir de l’emprise de l’État ?
– Coronavirus : rien ne sera plus jamais comme avant… Vraiment ?
– Longue vie aux tisserands coopérateurs de Waraniéré !
* Spécialiste de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France, le statisticien Philippe Kaminski a notamment présidé l’ADDES et assume aujourd’hui la fonction de représentant en Europe du Réseau de l’Économie Sociale et Solidaire de Côte-d’Ivoire (RIESS). Il tient depuis septembre 2018 une chronique libre et hebdomadaire dans Profession Spectacle, sur les sujets d’actualité de son choix, afin d’ouvrir les lecteurs à une compréhension plus vaste des implications de l’ESS dans la vie quotidienne.