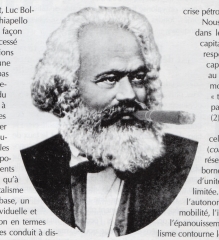
40 % du capital des grandes entreprises françaises sont détenus par des fonds étrangers
Révélatrice est à cet égard la pénétration de la capitalisation boursière française par les investisseurs étrangers, au premier rang desquels figurent justement les grands fonds de pension anglo-saxons. La France détient en ce domaine un record mondial. La part des grands investisseurs internationaux dans le capital des sociétés françaises atteint en effet aujourd'hui près de 40 %, contre 16 % en Angleterre, 10 % en Allemagne et 7 % aux États-Unis. En 1998, les investissements nets des non-résidents en actions françaises se sont élevés à 70 milliards de F, contre seulement 6 milliards aux résidents ! En outre, depuis une décision prise en 1993 par Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget, ces fonds non résidents sont exonérés de toute imposition sur les dividendes français qu'ils encaissent. Il en résulte un différentiel de contrainte, et donc de rendement, dont la conséquence logique, compte tenu des moyens dont disposent les « zinzins », pourrait être le rachat progressif de la majorité des titres des sociétés françaises par des investisseurs étrangers. La récente dégringolade d'Alcatel suite à la décision d'un fonds américain de vendre la moitié des actions qu'il détenait dans son capital illustre les dangers d'une telle dépendance, qui ne cesse de croître (5).
« Par ce biais, remarque Laurent Joffrin, le modèle libéral se répand sans tambour ni trompettes, par le simple jeu de la pression financière. Contraintes d'assurer à ces actionnaires sans pitié une "création de valeur" (un profit, en langage courant) léonine, les groupes nationaux reportent les sacrifices sur leurs salariés la stagnation des salaires français va remplir les poches des retraités d'outre-Atlantique ».
Le « capitalisme rhénan » naguère décrit par Michel Albert (6) perd ainsi constamment du terrain devant le capitalisme financier, qui ébranle ses fondements. Ce capitalisme « rhénan », fondé sur le système bancaire et les conglomérats industriels, se voulait encore soucieux d'un minimum de cohésion sociale. Mais les difficultés économiques traversées depuis dix ans par l'Allemagne (et le Japon) ont renforcé l'idée que le modèle anglo-saxon est voué à s'imposer partout. La convergence des modèles économiques est d'ailleurs l'un des grands postulats de la « nouvelle économie ». La méthode employée consiste à appliquer aux États-nations la même grille de lecture que celle appliquée aux firmes pour évaluer la compétitivité.
En réalité, comme l'exemple américain constitue la référence de base de la « nouvelle économie », cette prétendue convergence des systèmes économiques convergence faisant abstraction des particularités culturelles, sociales ou institutionnelles de chaque pays et interprétant comme « retard » tout problème dérivant d'une situation locale résulte simplement du fait que tous les pays sont classés en fonction de leur écart par rapport aux États-Unis, « pays jeune qui a éradiqué toutes les formes de socialisation antérieures et qui est donc la terre du sujet marchand par excellence », comme le note Robert Boyer, qui ajoute « On compare à cette société, figure emblématique du capitalisme, toutes les autres sociétés pour les découvrir "archaïques" ou "émergentes ". En d'autres termes, la plupart des analystes américains vont appliquer aux autres économies les outils conceptuels utilisés pour analyser la société américaine en supposant qu'ils sont nécessaires et suffisants » (7). On perd ainsi de vue que c'est plutôt le système américain qui est exceptionnel par rapport à la diversité des situations existantes.
Les investisseurs institutionnels imposent leurs critères de rentabilité
La première exigence des investisseurs institutionnels est évidemment la déréglementation. On sait qu'au cœur du credo libéral, on trouve la croyance dans l'existence d'un processus d'ajustement naturel (autorégulateur) qui permettrait au marché d'atteindre une situation optimale à condition de n'être entravé par rien ce qui n'empêche d'ailleurs pas les partisans du marché de se convertir discrètement à l'interventionnisme chaque fois qu'ils peuvent y trouver leur avantage (8). La déréglementation consiste donc à supprimer tout ce qui est susceptible de perturber les ajustements propres au « mécanisme du marché » et, subsidiairement, à attribuer tous les effets négatifs que l'on peut constater à la malignité des hommes (« rigidité des salaires », dette des administrations publiques, « obstacles » culturels, etc.), plutôt qu' au marché lui-même.
Composante essentielle de la conception libérale de l'économie, la déréglementation n'a cessé de s'étendre depuis les années quatre-vingt à partir des expériences anglaise et américaine. Un tournant capital été pris en 1986, lorsque Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont convaincu leurs partenaires au sein du G7 d'accepter le principe d'une déréglementation financière. Les États ont accepté parce que cette déréglementation leur permettait de financer leur dette publique par la « titrisation », ce qui veut dire en clair que la dette des États pouvait être transformée en titres négociables vendus en Bourse.
Un vaste mouvement de « désintermédiation » financière s'est alors engagé, permettant notamment aux grandes entreprises de se financer directement sur les marchés financiers, ce qui a entraîné une diminution du rôle des banques. Or, les banques jouent traditionnellement un rôle d'écran entre les entreprises et les épargnants, en permettant une certaine « mutuellisation » des risques et en absorbant une partie des chocs conjoncturels, générateurs de décalage entre l'épargne et l'investissement. La disparition de cet écran fait que l'épargnant individuel doit désormais supporter seul la qualité du risque de ses placements sur les marchés financiers, ce qui augmente sa vulnérabilité. Parallèlement, de nouveaux instruments financiers ont été créés, tels les marchés à terme et de devises.
Cette libéralisation des marchés financiers a été l'un des moteurs essentiels de la mondialisation. Comme la déréglementation et les privatisations, elle participe d'une même tendance le passage d'une liquidité bancaire à une liquidité purement financière, c'est-à-dire que les instruments financiers ne cessent de gagner en liquidité au point de pouvoir être utilisés eux-mêmes comme instruments monétaires (9).
Sous prétexte de dérégulation et de meilleure efficacité, le nouveau capitalisme réclame donc de façon statutaire une liberté de manœuvre totale, en arguant que toute restriction apportée à cette liberté se traduirait par une moindre efficacité. Il s'affranchit ainsi de toute règle, hors celle du profit immédiat.
Résultat, alors qu'en Europe, les grands raids boursiers étaient naguère rarissimes, les fusions-participations se multiplient depuis 1998-99 à un rythme encore jamais vu (10). Certes, on avait déjà enregistré entre 1885 et 1913 un mouvement de concentration des entreprises, mais les dimensions n'étaient pas les mêmes. De plus, il y a un siècle, les fusions étaient offensives et servaient à conquérir de nouvelles parts de marché, alors que les deux tiers des fusions actuelles sont principalement défensives. Une autre caractéristique de ces opérations est qu'elles se font le plus souvent « en papier », c'est-à-dire par des offres publiques d'échanges qui profitent aux actionnaires des sociétés-cibles, mais augmentent encore le volume de la « bulle » spéculative.
Le prix de rachat d'une multinationale équivaut au budget annuel de la France
Ces rapprochements mettent en jeu des sommes colossales. Le rachat du groupe allemand Mannesmann par le Britannique Vodaphone a représenté à lui seul une opération de 148 milliards de dollars (l'équivalent de 1 200 milliards de F presque autant que le budget de la France!). En 1998, Exxon a absorbé Mobil pour 86 milliards de dollars, Travelers Group la Citycorp pour 73,6 milliards de dollars, Bell Atlantic GTE pour 71,3 milliards de dollars, AT&T Media One pour 63,1 milliards de dollars, Total Fina Elf Aquitaine pour 58,8 milliards de dollars. En janvier 2000, le rachat de Time Warner, numéro un mondial de la communication, par AOL, premier fournisseur mondial d'accès à Internet, a créé un groupe pesant quelque 300 milliards de dollars.
À l'échelle mondiale, ces opérations de concentrations ou de fusions-acquisitions ont représenté en 1999 un montant de 3 160 milliards de dollars. Quant aux sommes brassées au cours de la dernière décennie, elles se sont élevées à 20 000 milliards de dollars, soit deux fois et demi le produit intérieur brut des États-Unis.
Censé favoriser la diversité et la qualité, le principe de concurrence aboutit ainsi à la constitution d'immenses cartels ou monopoles, disposant de plus de pouvoir que bien des États. À l'heure actuelle, les 200 plus importantes firmes transnationales (dont 91 ont leur siège aux États-Unis) font annuellement un chiffre d'affaires de 7 000 milliards de dollars, chiffre supérieur au montant du PIB des 150 pays non membres de l'OCDE. Dans la plupart des secteurs, en particulier dans le domaine de la culture et de la communication, cette évolution engendre l'homogénéisation de l'offre (chaque firme cherche à faire mieux, mais à faire mieux la même chose) et sur la « sélection inverse », c'est-à-dire sur des situations où les solutions sélectionnées se révèlent désavantageuses pour les agents (11).
On comprend alors que le véritable rôle des « zinzins » est de restructurer le capitalisme mondial. Comme l'écrit Dominique Plihon, « en achetant et vendant leurs participations, les fonds de pension font circuler le capital et accélèrent l'évolution vers une nouvelle configuration caractérisée par la prise de contrôle du capital productif par les investisseurs et, simultanément, par la création d'une classe de rentiers au sein même du salariat » (12).
On est en fait passé du commerce des matières premières au commerce des produits industriels, puis du commerce des produits industriels au commerce des produits financiers. Cette évolution est aujourd'hui portée par la croyance en un nouveau type de croissance durable liée à l'essor des « technologies nouvelles » médias, Internet, téléphonie mobile, etc. De même que le développement du premier capitalisme avait été favorisé par la machine à vapeur et les chemins de fer, le nouveau capitalisme doit l'essentiel de sa fortune à l'explosion des technologies de la communication, l'ordinateur, premier outil créé par l'homme ayant vocation à remplacer le cerveau humain, se caractérisant par le transport instantané de données immatérielles et permettant la prolifération à l'infini des réseaux. Symbole Canal Plus représente aujourd'hui une capitalisation supérieure à celles de Peugeot, Renault et Michelin réunis.
Les « start-up » d'Internet, eldorado de la nouvelle économie ?
Lancé sur le marché privé par le Pentagone à la fin des années quatre-vingt, le réseau Internet s'est en effet révélé un formidable outil. D'ici moins de trois ans, le nombre d'utilisateurs devrait avoir dépassé le demi-milliard de connectés (dont dix millions en France). Le commerce électronique (« trading on Une », publicité, bourse en direct) devrait alors atteindre les 80 milliards de dollars par an.
Début mars 2000, la simple évocation de l'introduction en Bourse d'une filiale Internet de France Télécom a permis à cet opérateur téléphonique de gagner 295 milliards de F en une seule journée, phénomène encore jamais enregistré sur la place de Paris. France Télécom atteignait ainsi une capitalisation boursière de 1 470 milliards de F soit encore une fois l'équivalent du budget de la France. Le soir même de son introduction à la Bourse de New York, le fabricant d'ordinateurs de poche américain Palm Pilot voyait au même moment sa valeur dépasser 53 milliards de dollars, plus que celle de General Motors, premier constructeur automobile mondial ! Ignacio Ramonet rappelle de son côté qu'« un épargnant ayant simplement investi le jour de leur introduction en Bourse 1 000 dollars dans des actions de chacun des cinq grands d'Internet (AOL, Yahoo!, Amazon, At Home, eBay) aurait gagné, dès le 9 avril 1999, un million de dollars » (13)!
À suivre