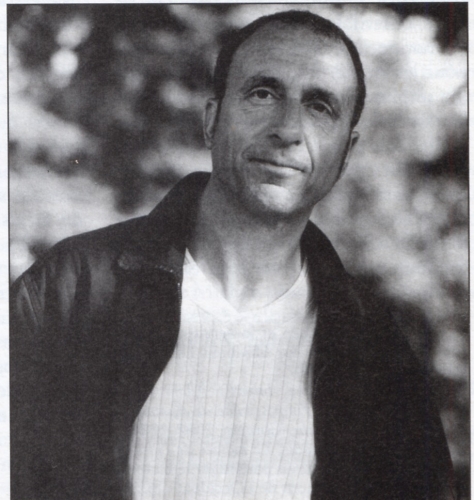
La «libération des moeurs » est devenue synonyme «d'avancée du droit» dans une surenchère incessante dont Philippe Muray sut tenir la chronique bouffonne avec une appétence et un humour auxquels Michéa n'est pas resté indifférent. Au final, qu'en résulte-t-il ? Outre la multiplication des «victimes» et leur inexorable concurrence, c'est l'inflation de la chicane et, à terme, l'abolition des libertés. En effet, écrit Michéa, « comme n'importe quelle prise de position politique, religieuse ou morale suppose, si elle est cohérente, la critique des positions adverses, elle sera toujours, en droit, suspecte de nourrir une "phobie" (consciente ou inconsciente) à leur endroit. La "phobophobie" libérale (c'est à dire la "phobie" de tous les propos susceptibles de "nuire à autrui" en osant contredire son point de vue ou critiquer ses manières d'être) ne peut donc aboutir - à travers la multiplication des lois instituant le "délit d'opinion" et sous la menace permanente de procès en diffamation - qu'à la disparition progressive de tout débat politique "sérieux" et, à terme, à l'extinction graduelle de la liberté d'expression elle-même, quelle qu'ait été, au départ, l'intention des pouvoirs libéraux ».
Des alliages provisoires
Dans son précédent livre(2), Jean-Claude Michéa reconnaissait volontiers l'indéniable réussite d'un système qui s'est imposé à la presque totalité des hommes. Il reprenait cependant une intuition de Marcel Mauss développée par Cornélius Castoriadis et suggérant que l'utilitarisme ne pouvait pas être la cause principale de ces succès. Castoriadis écrit en effet ceci : « Le capitalisme n'a pu fonctionner que parce qu'il a hérité d'une série de types anthropologiques qu'il n'a pas pu créer lui-même : des juges incorruptibles, des fonctionnaires intègres et wébériens, des éducateurs qui se consacrent à leur vocation, des ouvriers qui ont un minimum de conscience professionnelle, etc. Ces types ne surgissent pas et ne peuvent pas surgir d'eux mêmes, ils ont été créés dans des périodes historiques antérieures, par référence à des valeurs alors consacrées et incontestables : l'honnêteté, le service de l'État, la transmission du savoir, la belle ouvrage, etc. Or nous vivons dans des sociétés où ces valeurs sont, de notoriété publique, devenues dérisoires, où seule comptent la quantité d'argent que vous avez empochée, peu importe comment, ou le nombre de fois où vous êtes apparu à la télévision »(3). D'où l'analyse de Michéa, qui soutient que c'est parce que les conditions de l'égoïsme libéral n'étaient pas encore réalisées que le marché a pu conserver, un temps, équilibre et efficacité. Tout comme le mécanisme de la pendule est stabilisé par l'inertie du balancier, la dynamique du libéralisme fut longtemps canalisée par le stock de valeurs et à d’habitus constitué dans les sociétés «disciplinaires» antérieures et que lui même est par nature incapable d'édifier. Ce stock une fois épuisé, l'échange marchand ne connaît plus de frein et sombre dans l’hubris.
Le raisonnement de Castoriadis montre que le libéralisme n'est historiquement viable que si les communautés où son règne est expérimenté sont, sociétalement, suffisamment solides et vivantes pour en contenir les aspects dévastateurs. Cette solidité tient autant à l'enracinement des systèmes de limitations culturelles et symboliques depuis longtemps intériorisés qu'aux régulations politiques d'un État qui ne s'était pas encore résolu à n'être qu'une structure d'accompagnement «facilitatrice» des «lois du marché». C'est ce qui explique, par exemple, que dans la France des années soixante (la France du général de Gaulle) la «croissance» connaisse un rythme soutenu et génère une augmentation réelle et générale du bien-être alors que, entre autres données sociologiques très parlantes, le taux de délinquance demeurait à son plancher. La prégnance des anciens modèles comportementaux était encore dominante, et c'est sur cette base qu'ont pu s'accomplir les «Trente Glorieuses». Dans les années suivantes, quand s'estompe la préoccupation du collectif et que triomphent les ego «émancipés», promus tant par les doctrinaires libertaires que par les slogans publicitaires, tous ces anticorps commencent à se dissoudre(4).
La période actuelle constitue pour Michéa l'aboutissement ultime d'une logique libérale désormais sans ailleurs et donc livrée à sa propre démonie. D'un côté, l'extension indéfinie de la sphère marchande et, de l'autre la multiplication des conflits nés du relativisme moral. Autant de luttes qui se traduisent par de nouvelles contraintes et l'établissement d'une société de surveillance aux mailles sans cesse plus serrées.
Contre le style libéral
Le refus radical que nourrit Jean-Claude Michéa à l'encontre du libéralisme peut sembler, à première vue, épouser des passions françaises assez largement partagées. Il n'en est rien cependant, puisque son refus est justement «radical» tandis que la majorité de nos contemporains, quelles que soient les préventions qu'ils affichent, continuent, imperturbablement, de se mouvoir politiquement dans le référentiel droite-gauche et adoptent, volens nolens, des modes de vie qui les inscrivent dans la dynamique du libéralisme triomphant. Plus que des adhésions formelles, ce sont des styles de vie que le libéralisme requiert et ce consentement, massivement fabriqué par l'industrie de la persuasion, lui est plus précieux que les connivences idéologiques proclamées à grand renfort de tambours. De ce point de vue, c'est une banale évidence, les dissidents ne sont pas légion.
En se définissant, à la suite d'Orwell, comme «anarchiste tory», Jean-Claude Michéa se situe d'emblée au delà des polarités conformes, polarités caduques que d'innombrables faussaires maintiennent, consciemment ou par paresse, sous perfusion constante afin de différer l'irruption de nouveaux clivages. L'oxymore orwellien a le grand mérite de suggérer un positionnement qui renvoie les «affrontements» mis en scène par le système à leur nature publicitaire (et par conséquent, mystificatrice et anesthésiante) et à leur vérité impolitique(5).
Dans ces conditions, il va de soi que Michéa se veuille réfractaire à une «gauche» qu'il étrille autant que possible. S'il n'est pas «de gauche», il se réclame, en revanche, du socialisme inaugural et sait fort bien, comme l'a établi Marc Crapez(6) que ce socialisme français s'est fondu dans la «gauche» pour s'y abolir à la fin du XIXe siècle. Ce qui distinguait ce socialisme «utopique» (syntagme dépréciatif que lui accolèrent les tenants du «matérialisme dialectique» était un double refus de l'Ancien Régime et de la modernité bourgeoise. Spontanément opposés à cette modernité bourgeoise, les socialistes de cette époque affirmaient le primat du social et refusaient d'envisager l'individu comme une monade détachée du corps organique de la communauté. C'est aussi pourquoi, contre Marx et ses épigones, ils se refusaient à définir l'économie comme étant toujours et partout déterminante «en dernière instance». Quoiqu'ils n'aient jamais conceptualisé ce qui leur paraissait comme une évidence, ils pensaient l'économie comme une réalité incorporée («encastrée» selon l'expression de Polanyi) dans la texture sociale, toujours prééminente. Opposés tout aussi bien à l'Ancien Régime, ils ne rêvaient pas de «contre-révolution» et ne cherchaient pas à se réfugier dans l'utopie d'une restauration de la transcendance comme point d'appui de l'ordre social. Suffisamment «modernes» pour se défier de l'hétéronomie des sociétés antérieures, ils affirmaient le principe d'autonomie selon lequel les citoyens seuls ont mission de penser, sans le secours abusif du ciel, les formes d'un «être-ensemble» qui respecte l'héritage sans jamais se laisser envoûter par ses sortilèges.
De la philia des Anciens à la commondecency des prolétaires londoniens qui inspirèrent Orwell, il y a un fil d'Ariane et comme un réservoir inexploré de valeurs. C'est dans ce trésor que Jean-Claude Michéa nous propose de puiser les armes théoriques du combat nécessaire contre l'horreur libérale.
Pierre BÉRARD éléments N°128 Printemps 2008
1). «Jean-Claude Michéa et la servitude libérale», propos recueillis par Elisabeth Lévy, in Le Point, 6 septembre 2007
2). Jean-Claude Michéa, Impasse Adam Smith. Brèves remarques sur l'impossibilité de dépasser le capitalisme sur sa gauche, Climats, 2002, 185 p.
3). Cornélius Castoriadis, La montée de l'insignifiance, Seuil, 1996. Cf. en particulier le chapitre intitulé «Le délabrement de l'Occident», p. 68.
4). Jean-Claude Michéa ne se prive pas de dénoncer l'imposture de Mai 68. Cet épisode constitue selon lui un moment clef pour avoir « fait table rase » des derniers obstacles à la marchandisation généralisée. Principale victime de cette «terrible confusion», le peuple, qui n'aura connu d'autre changement que le « remplacement du vieux despotisme de l'avenue Foch par la tyrannie, indéniablement plus décorative, de la place des Vosges et du Marais ».
5). Selon Carl Schmitt, cité par Michéa p. 16-17 il n'y a pas de politique libérale suigeneris, mais seulement une critique libérale de la politique.
6). Marc Crapez, Naissance de la gauche, suivi de Précis d'une droite dominée, Michalon, 1998.
Jean-Claude Michéa, L’empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, Flammarion, 2007, 19 €.