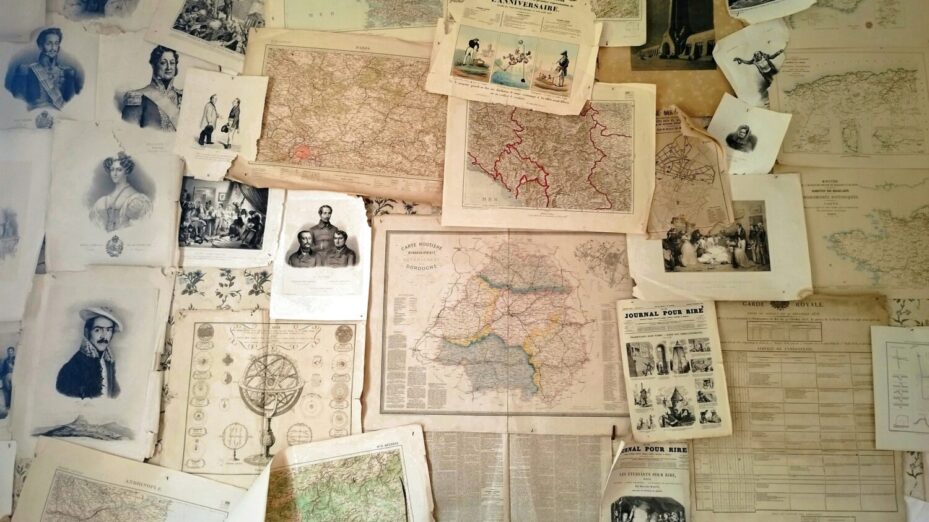La découverte de la grotte
Selon le quotidien allemand Bild, c’est en 1980 que des archéologues mirent au jour, dans la Lichtensteinhöhle, une grotte proche de Förste, plus de 4.200 fragments d’os humains soigneusement déposés, représentant une soixantaine d’individus. Ces derniers, allant de l’enfant au vieillard, furent inhumés aux alentours de 1.000 av. J.-C., période charnière de la fin de l’âge du bronze en Europe.
Dans la cavité, parmi les vestiges humains, furent également retrouvés des objets comme des bijoux en bronze, des éclats de céramique, des os d’animaux, des graines de fleurs ou encore des restes de vêtements témoignant de rites funéraires complexes et codifiés. L’existence de foyers à l’intérieur de la grotte renforce également l’hypothèse selon laquelle des rituels de deuil ou d’enterrement s’y déroulaient.
Le docteur Brigitte Moritz, du Centre d'exploration des grottes à Bad Grund, explique ainsi : « Les morts ont d’abord été enterrés ailleurs, puis leurs os ont été déplacés ici plus tard. Une deuxième inhumation, un voyage vers l’au-delà. »
La grotte s’inscrit dans un massif calcaire dont la composition géologique est favorable à l’exploitation d’un véritable trésor pour l’époque de l’âge du bronze : le sel. Cet « or blanc », extrait des entrailles de la Terre, était dissous dans l’eau puis porté à ébullition dans de petites cuves en argile ; l’évaporation permettait ainsi la création d’un sel purifié, moulé ensuite en « pains » et prêt à être transporté. Ces blocs alimentaient ensuite un vaste réseau d’échanges couvrant l’Europe centrale, berceau de la culture celtique qui apparaît vers 1.200 av. J.-C. via la culture de Hallstatt. L’exploitation du sel gemme constituait ainsi, déjà, une activité majeure dans les Carpates, les Alpes orientales autrichiennes, en Galicie et dans toute la zone hallstattienne, où ce précieux minerai était un véritable moteur économique.
Analyses scientifiques et lien ADN
En 2007, des chercheurs de l’université de Göttingen purent extraire et déchiffrer de l’ADN ancien parmi les ossements découverts. Afin de réussir à établir un bilan de leur analyse, un test de salive fut proposé aux résidents de Förste. Parmi environ 120 volontaires figurèrent ainsi Manfred Huchthausen. Neuf mois après les tests, ce dernier « reçut un courrier du préfet ». Il était écrit : « Vous faites partie de ceux de la grotte. »
Cet ancien professeur de lycée professionnel croyait initialement à une erreur, mais les résultats ne trompaient pas : le lien génétique était direct et incontestable, preuve que sa lignée est restée sur place sans interruption connue depuis trois millénaires, sur ces terres où, selon ses mots, « mes ancêtres enterraient et honoraient leurs morts ». Grâce à la science, les chercheurs ont pu également déterminer certaines caractéristiques physiques des individus de l’époque comme leur taille, leur couleur de cheveux et même des yeux. Ces derniers seraient même similaires à ceux des habitants actuels de la région.
Être de souche
Dire que l’homme « ne fait que passer » sur un territoire semble souvent aller de soi pour certains. Pourtant, l’histoire de Förste démontre qu’une culture, un mode de vie et même une lignée familiale peuvent demeurer solidement enracinés dans un même lieu pendant des millénaires. L’expression « être de souche » trouve ainsi, ici, un sens concret. Loin de l'idée d'une Europe faite de populations métissés, les ancêtres de Manfred Huchthausen n’étaient ni des nomades, ni de passage et sans attaches, mais des êtres humains fortement ancrés dans un territoire. Ils exploitaient le sel, jouaient un rôle économique dans leur région, avaient leur propre tradition en honorant leurs morts dans des grottes. Leur présence a façonné cette terre et son histoire.
Les études génétiques démontrent également que cette identité ne s’est pas dissoute au fil des siècles. Malgré les flux de populations et les crises qui ont agité l’Europe centrale depuis l’âge du bronze, une véritable continuité humaine s’est maintenue ici jusque dans les caractéristiques physiques des individus. Pour Manfred Huchthausen, cette révélation renforce son attachement à son village : « Ici, c’est tellement beau ; ici, on peut vivre éternellement. »