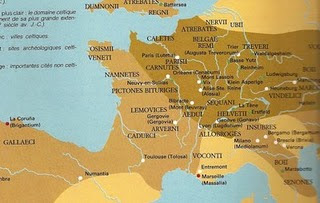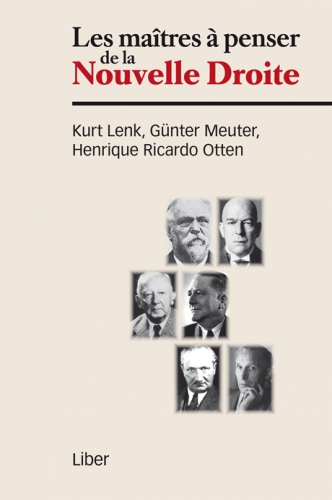Editorial de Frère Thierry
Nous n’aimons guère notre époque, ou, plus exactement, notre époque ne nous aime guère. Depuis des décennies, la société mondialiste qui nous est vendue comme promesse de paradis terminal, de fin de l’Histoire béate, ne fait plus illusion auprès des observateurs un tant soit peu critiques, des hommes de bon sens qu’on rejette dans le camp de l’ennemi en les appelant « réactionnaires ». Le vaste supermarché global, pacifié et unifié, recèle d’insondables horreurs derrière les sourires figés des hordes d’homo oeconomicus qui arpentent les allées. La société mondialiste n’a pas besoin d’hommes, elle n’a besoin que de consommateurs, d’humains réduits à leurs plus basses fonctions d’absorption, d’assouvissement des pulsions et des désirs mimétiques. En cela, cet Empire du Bien dont parlait le regretté Philippe Muray est un totalitarisme. Totalitarisme doux ou mou, certes, mais totalitarisme tout de même, dans ses procédés comme dans ses objectifs. L’Empire veut donc produire à la chaîne des consommateurs, des hommes dociles, souples à l’injonction. Pour ce faire, les déraciner est indispensable, charnellement et spirituellement. Au cœur de cette entreprise nihiliste, la culture est la cible prioritaire. Il faut faire en sorte que les personnes ignorent de plus en plus qui elles sont : on effacera donc d’abord leur histoire, on les privera de chronologie ; on dissoudra leurs traditions, rejetées dans les Ages Sombres d’avant le Village global ; on leur coupera l’accès aux œuvres artistiques et techniques, fruits du génie des leurs ancêtres ; on détruira toute échelle de valeur et de comparaison, sapant l’esthétique et le goût. On les rendra étrangers à leur propre langue, inaptes à l’expression de la pensée et de l’émotion, donc inaptes à être des hommes, ces singuliers animaux faits à l’image du Créateur. On en fera des zombies dénués de toute arme et de toute stratégie pour s’opposer à l’ablation de leur âme et à leur disparition à terme.
Ce combat contre la culture et les cultures (entendues comme les manifestations différenciées des génies des ethnies, des peuples et des races) exige une riposte adaptée, un combat culturel. Que peut bien recouvrir cette notion ? Ce combat vise à défendre l’intégrité de la personne humaine, unique aux yeux de Dieu et enracinée dans l’Histoire. Cette intégrité fait tenir ensemble toutes les capacités de l’homme, intellectives comme émotives, techniques comme artistiques, et les ordonne en vue d’une fin qui les dépasse, qui nous dépasse tous. Pas de vraie culture sans métaphysique, d’une part, et pas plus sans Histoire d’autre part. Ceci implique de reconnaître l’inscription de l’homme et de sa culture dans un contexte religieux et métaphysique et de le défendre comme tel. Point n’est besoin d’être soi-même croyant. : pour preuve, l’agnostique Charles Maurras fut bien l’un des plus ardents défenseurs du rôle de l’Eglise et des créations de la foi. Défendre la culture, c’est défendre un au-delà de l’homme, alors que l’Ennemi veut nous réduire à un en-deçà de l’homme. Défendre une culture, c’est aussi défendre l’histoire de cette culture et des générations qui l’ont portée, c’est s’inscrire dans une lignée, une continuité, se reconnaître dans une suite d’innombrables prédécesseurs, et assumer pleinement et entièrement ce qui est à la fois une dette, un héritage et un honneur. Linéarité du temps historique, ponctuée par la cyclicité des rythmes naturels : l’histoire de la Culture, c’est la Tradition, l’histoire des cultures, ce sont les traditions.
D’abord, assumer et défendre la dimension métaphysique et religieuse de l’homme, assumer et défendre la tradition et les traditions. Mais comment ? Le combat culturel est en fait un combat pour l’intelligence, à l’aide de l’intelligence : par la mémoire, nous accumulons les références historiques, littéraires, poétiques, musicales, architecturales, folkloriques, politiques, et notre intelligence ordonne ces références et nous en fait comprendre les structures. L’intelligence, c’est le don de Dieu pour que l’homme se comprenne. La culture est la mise en forme individuelle et collective de l’intelligence, par l’expérience des aïeux. La culture est l’enclume sur laquelle notre intelligence va se forger, puis se développer, s’aiguiser, s’exercer, se tremper. Sans culture, l’intelligence est matière sans forme, inerte donc inutile. L’homme dont l’intelligence ne sert pas est mûr pour l’esclavage. La culture est donc la condition de la liberté, puisque c’est grâce à elle que notre intelligence personnelle peut devenir épée et bouclier de notre corps et de notre âme.
Il faut revenir à l’étymologie du mot « culture » pour en bien saisir toutes les implications. Le verbe latin colere signifie cultiver une terre, un champ, et par extension « prendre soin de quelque chose ». L’agriculture est le soin apporté à la terre pour qu’elle produise ses meilleurs fruits. Le passage de l’agriculture à la culture, de la matérialité du sol à l’abstraction de l’esprit, passage qui s’opère chez les auteurs romains, en particulier chez Cicéron, conserve cette idée de soin, de travail permanent en vue de la production, de la mise au monde des meilleurs fruits de l’âme. Cette dernière est notre champ, et constamment nous devons être à l’ouvrage, il en va de notre salut physique et moral : sarcler, labourer, semer, faucher, glaner, surveiller, protéger des nuisibles. Le combat culturel est d’abord un effort, une violence faite à soi-même pour se montrer digne de la culture que nous héritons. C’est, pour chacun d’entre nous, un travail immense, harassant, impliquant la concentration, la méditation, la mémoire, la logique, toutes les capacités intellectives qui doivent emmagasiner sans cesse les informations triées et ordonnées par le goût et l’expérience, mais aussi la sensibilité artistique, la capacité d’étonnement et d’émerveillement.
Le combat culturel implique de savoir où trouver, dans l’immense répertoire de la culture que l’honnête homme ne maîtrisera jamais qu’à peine, les preuves, les exemples, les arguments, sous quelque forme que ce soit, qui permettent de s’opposer au mensonge et de tendre, toujours tendre vers la Vérité. La culture donne tout à la fois fierté et humilité, confiance nécessaire en soi et en son héritage, doute et remise en question tout aussi nécessaires. C’est donc en se cultivant que l’on peut défendre légitimement son legs et son identité, et c’est par cette défense intelligente, passionnée et solide que l’on peut convaincre les indécis, voire nos adversaires.
Pour quiconque veut participer, à son niveau, au combat politique pour la sauvegarde de nos patries et de notre civilisation européenne chrétienne, il doit être évident que le combat culturel est l’une des armes principales. C’est lui qui permet, s’il est intelligemment mené, par son effet sur un nombre croissant de personnes, de renverser les modes idéologiques qui conditionnent les comportements sociaux. L’hégémonie gauchiste et progressiste sur le monde des lettres, des arts, de l’université et des media depuis cinquante ans, avec ses aspects les plus mortifères, les plus nihilistes, a pu se mettre en place par une stratégie habile et dénuée de scrupules d’épuration et de disqualification de l’adversaire et de sidération idéologique. Toute contestation, que ce fût du pédagogisme à la Mérieux, de la sociologie de Bourdieux, de l’art contemporain, était immanquablement rejetée dans le camp du Mal, de la Réaction, voire du Fascisme éternel. Mais cette sidération n’a qu’un temps, même si ses ravages vont continuer à s’exercer: l’apparition d’Internet, en particulier, est la chance de tous les militants de la ré-information et du combat culturel, en ce qu’elle permet la constitution de groupes de pression, en ce qu’elle diversifie les sources d’information et permet ainsi au simple citoyen, s’il s’en donne la peine, de vérifier et recouper le contenu souvent douteux véhiculé par les media de masse. Le but qu’il faut fixer au combat culturel est d’obtenir la majorité idéologique, quand bien même l’on ne serait que politiquement minoritaire (ce qui est, de fait, le cas). Nul n’est besoin de se faire sectateur de Gramsci pour comprendre que cette majorité idéologique est la condition nécessaire (mais pas toujours suffisante) d’une majorité politique et donc de l’inflexion de la vie de nos cités et de nos pays dans le sens qui nous semble ordonné sur et vers le Bien, le Beau et le Vrai. Elle ne peut s’obtenir que par l’effort constant de personnalité d’horizon divers mais unis par une culture commune, le sachant et voulant la défendre, sans se renier, sans déposer les armes.
Très concrètement, en quoi consiste la formation d’un combattant culturel (qui n’est au fond que l’activité quotidienne de l’honnête homme et du patriote) ? Elle tient en deux mots : travail et dialogue. Expliquons-nous : le travail, c’est le labour du champ de l’âme et de l’esprit. C’est prioritairement la lecture. L’honnête homme lit, avec un œil critique, une sensibilité ouverte, une mémoire qui fonctionne à plein régime, dans les transports en commun ou sur un canapé, mais il doit impérativement lire. Lire les classiques de la littérature, les livres d’histoire, de philosophie, les essais politiques ; se constituer sa propre bibliothèque, ses références sues par cœur, découvrir les auteurs de la contre-culture chrétienne et/ou patriote et de proche en proche, se constituer une galaxie, une constellation culturelle d’écrivains qui fourniront sans cesse les munition de la lutte permanente : Barrès, Péguy, Bloy, Maurras, Claudel, Bernanos deviendront des familiers, puis, dans un processus d’élargissement éclectique mais sélectif et critique, on s’attaquera à la science-fiction théologique de Maurice G. Dantec, à la critique du libéralisme de Jean-Claude Michéa, à la pertinente défense de l’esprit européen de Jean-François Mattéi, aux fines analyses philosophiques du temps présent de Pierre Manent ou Chantal Delsol. On ira, toujours attentif et ouvert à la découverte, avec suffisamment de formation intellectuelle de base (qui s’acquiert par la fréquentation assidue des classiques…et des manuels d’histoire littéraire et d’histoire des idées !) pour trier le bon grain de l’ivraie, en sachant que, souvent, l’on adhère aux analyses des auteurs sans pour autant valider leurs solutions et prescriptions (ainsi de l’anarchiste ancienne école Michéa). On ira se confronter aux textes des adversaires pour maîtriser leurs armes mieux qu’ils ne maîtrisent les nôtres : il faudra lire Michel Foucault, Jacques Attali ou Michel Onfray. On cartographiera les auteurs, les écoles et courants de pensées, leur histoire mouvante. Mais l’important est de lire, de relire, de mémoriser et de prolonger la lecture par d’autres lectures. Après, pour ouvrir toutes les voies d’acquisition de la culture générale, il faut maîtriser les disciplines d’un trivium et d’un quadrivium pour le temps présent, adapter ces divisions de l’enseignement des arts libéraux instituée par le philosophe Boèce aux exigences d’un homme de culture dans le monde des années 2010 : connaissance intime de la langue française, de sa grammaire, de l’orthographe, des conjugaisons et de la richesse immense de son lexique ; connaissance du patrimoine artistique (peinture, musique, sculpture, architecture…) ; connaissance du patrimoine religieux et pratique du culte ; connaissance des traditions populaires, du folklore et à nouveau pratique; connaissance des enjeux géopolitiques et attention régulière aux nouvelles du monde. Sur ces bases-ci, une culture générale opérationnel, en ordre de bataille, peut être édifiée.
Dans un second temps, ce que nous appelons le dialogue est en fait une version mi-socratique mi-militante : il s’agit, en ne perdant aucune occasion, d’ouvrir le dialogue non pas avec les convaincus, ce qui n’est que rassurant, mais avec tous ceux qu’il reste à convaincre, à orienter vers une certaine idée du Beau, du Bien et du Vrai, vers le bonheur inépuisable de la culture française, européenne et chrétienne et vers l’urgence de la lutte pour sa sauvegarde et à terme pour notre survie en tant que peuple de culture, singulier, unique. En donnant l’exemple d’une culture maîtrisée dans ses aspects les plus variés, et pratiquée, le combattant culturel va susciter la curiosité, l’interrogation, parfois la réprobation, les critiques, mais c’est grâce à cette démarche qui cumule la conviction, l’invitation à la réflexion, l’anticonformisme, et le plaisir du savoir, que l’on peut ouvrir les esprits à notre combat. Le réfractaire au monde moderne tel qu’il nous est vendu se doit d’être cet aiguillon toujours alerte qui montre du doigt les impasses et les contradictions de ce qui, dans la pensée correcte du totalitarisme mou ambiant, est censé aller de soi.
Pour conclure, il faut garder présent à l’esprit que toute culture est par définition vivante, elle vit avec nous qui la portons. Elle risque de fait de mourir si nous n’avons plus les épaules assez solides pour la porter haut. C’est notre devoir de citoyen, de chrétien, d’homme, c’est notre honneur que de batailler pour la culture et par elle.
http://www.cercleareopage.org/