Francis Cousin a l’habitude de s’exprimer sous pseudonymes dans divers revues et sites internet. Avec sa permission, nous diffusons aujourd’hui ce papier signé Gustave Lefrançais et paru dans le N°737 des « Écrits de Paris » (Éditions des Tuileries) en décembre 2010. [NDLR de Scriptoblog]
Face à l'horreur moderne… De la civilisation du pouvoir… Rappelons-nous toujours l’émotion spontanée de la communauté de l’être archaïque…
N’en déplaise à toutes les idéologies de justification des mensonges économiques et politiques de lasociété de l’avoir, le communisme primitif le plus primitif exprimait bien et d’abord l’immanence naturelle dusouci de l’être, en la vérité qualitative de l’essence émotionnelle du jouir et du ré-jouir humains… C’est en tout cas et une fois de plus, la conclusion pratique évidente à laquelle on aboutit face à une découverte remarquable effectuée dernièrement par une équipe de paléoanthropologues lors de fouilles effectuées sur le gisement de la Sima de los Huesos (la Cime des Os) dans la Sierra de Atapuerca, dans la province de Burgos en Espagne…
L’espace ici étudié est celui des territoires traditionnels de l’Homo heidelbergensis qui a vécu en Europe au Pléistocène. Cet ancêtre commun de l’Homme de Néanderthal et de l’Homo Sapiens qui occupait ces lieux, il y a environ 530 000 ans, vivait et se nourrissait communautairement par la cueillette et surtout par la chasse. Il était expérimenté pour venir à bout du gros gibier, par exemple les chevaux et les rhinocéros laineux. Il fabriquait avec soin des armes diversifiés et notamment des épieux à lancer qui pouvaient atteindre jusqu’à 2,50 m de long ainsi que de multiples outils en silex. Les marques de découpage sur les os retrouvés indiquent que ces derniers étaient raclés méticuleusement pour que l’on en retire la viande. Les os étaient aussi utilisés comme instruments pour la fabrication d’outils en silex. Avec habileté, le bois et les os étaient taillés et l’on confectionnait aussi, à partir d’eux, des aiguilles pendant que les tendons, eux, servaient de fils. Et ainsi, avec la peau, les aiguilles et les tendons, il était possible d’élaborer des vêtements particulièrement chauds et résistants. Le développement de ses capacités sociales et culturelles tel que les restes de campements communautaires méthodiquement ordonnés en témoignent laisse très clairement supposer que l’Homo heidelbergensisqui vivait centralement autour de feux communs possédait déjà les fondements d’une langue simple mais efficacement fonctionnelle. La culture matérielle d’Homo heidelbergensis correspond en fait au Paléolithique inférieur et le plus souvent il s’agit d’Acheuléen.
Les archéologues ont aussi découvert des traces nombreuses d’os calcinés, ce qui indique indéniablement la pratique élaborée de rites funéraires avérés. Sur la trentaine d’individus identifiés et examinés dans la Sierra de Atapuerca, un crâne a très particulièrement retenu l’attention du Centro de Evolucion y Comportamiento Humanos de Madrid. Ce crâne est très probablement celui d’une jeune fille d’une dizaine d’années et les fragments que l’on en a retrouvé permettent de diagnostiquer les traces certaines d’une craniosynostose, une maladie génétique rare débutant au cours de la vie fœtale et qui provoque une soudure prématurée des os crâniens susceptible d’entraîner de sévères et irréversibles déficiences psychomotrices.
D’où, la conclusion d’évidence qui s’impose immédiatement et logiquement… Atteinte par cette grave et invalidante malformation congénitale, la jeune fille en question n’aurait jamais pu atteindre l’âge relativement avancé qui fut le sien sans la sollicitude, l’attention et l’égard permanents des siens au sein du groupe dans lequel elle est née et a justement pu vivre dans une bien-veillance obligée de chaque instant. Si cette dernière a donc pu exister, grandir, résister et subsister malgré son lourd handicap, cela procède de l’accompagnement attentif et systématique du groupe de chasseurs-cueilleurs qui était le sien. Cette découverte confirme que l’accueil, la compréhension, la douceur, l’ouverture d’âme et la sollicitude que l’on peut porter aux personnes souffrantes, malades ou infirmes n’est pas un comportement récent dans l’histoire de l’humanité… Bien loin de là, du reste, puisqu’aujourdhui, si l’on retire les avantages financiers des impostures économiques générales en jeu et les pathologies spectaculaires compensatoires de fallacieuse bonne conscience mises en scène, les fraîches et franches relations directes à l’autre sont dorénavant ici extrêmement rares…
Il y a un bon demi-million d’années, nos ancêtres lointains qui vivaient en groupes communautaires ignorant le pouvoir, l’argent et la servitude étaient donc d’instinct capables de ce sentiment, de cette inclination et de cette sensibilité pratique qui regarde l’autre avec émoi, bouleversement et com-préhension. Voilà qui vient nous rappeler les très pertinentes analyses de Marx et d’Engels dans les Grundrisse et dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État tels qu’ils avaient su démontrer que les communautés primitives sont des espaces où l’être ensemble indivisé (et pour cela, se voulant totalité une de sa propre immanence de besoins et de désirs) est une dynamique de vie sans scission entre dominants et dominés qui ignore tout organe séparé de pouvoir et qui d’emblée s’émeut de tous en chacun et de chacun en tous.
Dans la tribu primitive, il n’y a pas d’organe séparé du pouvoir parce que le pouvoir n’est pas sépare de la communauté parce que c’est elle – en l’essence de son être – qui le détient comme son être en tant que totalité unitairement homogène de son auto-mouvement de vie, d’affection, de délicatesse, de sentir, de re-sentir et de fidélité.
Quel est le lieu réel du pouvoir dans la communauté primitive? C’est la totalité du vivre ensemble lui-même qui le détient et l’exerce comme unité totale de son indivision globale de corps et d’âme. Ce pouvoir non séparé de la communauté s’exerce en un seul sens et il anime tous les sens en un seul projet : maintenir dans l’indivision l’être de la communauté, empêcher que la non-réciprocité entre les hommes installe la division dans le groupe. Il s’ensuit que ce pouvoir s’exerce sur tout ce qui est susceptible d’aliéner la société, d’y introduire la désagrégation, le morcellement et le parcellement. Il s’exerce, entre autres, sur l’institution d’où pourrait surgir la captation du pouvoir, la chefferie. Le chef est, dans la tribu, sous surveillance d’intelligence critique constante. La communauté veille à ne jamais laisser le goût du prestige passager se trans-former en désir de pouvoir permanent.
Si l’appétit de pouvoir du chef devient trop évident, la procédure mise en jeu est simple et c’est toujours la même: on le réprimande puis on l’abandonne, voire même on le tue. La crainte clairvoyante de la séparation habite très certainement la communauté primitive, mais elle possède fondamentalement les moyens de la conjurer par l’ardeur passionnelle à exister et à aimer qualitativement les joies de l’être.
L’exemple des communautés préhistoriques nous enseigne là que la division n’est pas inhérente à l’être de l’être ensemble et qu’en d’autres termes, l’État n’est pas éternel, qu’il a, ici et là, une date de naissance et qu’il aura d’ailleurs et bien évidemment une date de mort.
Pourquoi la pathologie de la domestication étatique a-t-elle émergé ? La question de l’origine de l’État doit se préciser ainsi : à quelles conditions une communauté cesse-t-elle d’être primitive et accepte-elle que les satisfactions de l’être se trouvent subjuguées par les inversions mortifères de la dialectique de l’avoir ?
Pourquoi les expériences, les normes et les savoirs qui empêchent le surgissement de l’État défaillent-ils, à tel ou tel moment de l’histoire ?
Il est hors de doute que seule l’interrogation attentive et critique du fonctionnement affectif profond des communautés primitives permet efficacement d’éclairer le problème des origines du déchoir dans l’errance étatique des asservissements de l’acquérir. Et ainsi, la lumière jetée sur le moment de la genèse de l’État éclaire-t-elle également les conditions de possible réalisation de sa liquidation historique quand demain, fatigués de subir la tyrannie du spectacle du quantitatif, les êtres humains décideront de re-trouver l’humanité des véritables tréfonds de leur être.
L’homme du communisme primitif était naturellement en relation naturelle à l’humain et tout en même temps en rapport d’humanité à la nature. Cette découverte à la fois remarquable et touchante en vieille terre d’Espagne vient exhumer cette réalité des profondeurs ignorée depuis des lustres d’insipidité universitaire et étatique et suivant laquelle il est manifeste que la préhistoire fut aussi préhistoire d’une passion et d’unecompassion non encore abruties par la temporalité du commerce et du pouvoir.
Qu’en est-il du produire dans la communauté pré-historique ? À cette question fondamentale, la réponse classique de la vérité officielle de la crasse imbécillité médiatico-universitaire dominante est la suivante : la vie archaïque pré-historique est un vagabondage de subsistance et de pauvreté, elle parvient au mieux à assurer la survie du groupe incapable de sortir du sous-développement technique. Le sauvage écrasé par son environnement écologique et sans cesse guetté par la famine et l’angoisse, telle est l’image d’idiotie ignare habituellement répandue.
Manipulation idéologique des faits, a déjà répliqué depuis longtemps l’anthropologue de vrai terrain Marshall Sahlins. Passant des chasseurs australiens et Bochimans aux communautés néolithiques d’agriculteurs primitifs telles que l’on pouvait encore au siècle dernier, les observer en Afrique ou en Mélanésie, au Viêt-Nam ou en Amérique du Sud, relisant sans parti pris les archives connues et y ajoutant des données chiffrées argumentés, celui-ci affirme, avec méthode et recherche que non seulement la communauté primitive n’est pas une dynamique de misère mais qu’elle est la première et jusqu’à présent la seule vie commune d’abondance.
Comme le disait Marx dans sa radicale critique absolue et universelle de tous les capitalismes tant de sauce bolchévique que de soupe libérale ou de brouet social-démocrate : « Si l’homme primitif ne rentabilise pas son activité, c’est non pas par ce qu’il ne sait pas le faire, mais parce qu’il n’en a ni l’envie ni le besoin puisqu’il se trouve en une autre dimension que celle de l’entassement, de l’accumulation et de l’addition. »
Evidemment, en ces temps là, la relation d’être à la vie qui considérait qu’il n’est de richesse que d’être, n’empêchait pas nos très lointains ancêtres de se tuer en des guerres d’ailleurs limitées et éphémères qui avaient d’abord pour objet d’empêcher les dérives du commerce pacifique qui transforme toujours et aliénatoirement le produire pour l’homme en travailler pour l’échange. Mais, il est tout de même réconfortant d’apprendre sur le terrain concret de la vie réelle vérifiée que le comportement humain vrai a bien entendu préexisté à l’invention des impostures de la morale lorsque le temps civilisationnel du politique et de l’économique a généralisé la paix des éthiques commerçantes et la guerre interminable des religions de l’expansion pour que la dictature démocratique du calcul cosmopolitique finisse par s’emparer du monde.
 La guerre localisée et circonscrite entre tribus est une façon pré-historique de repousser l’émergence économique du rencontrer avec la politique de l’avoir et donc d’endiguer la menace d’une délégation de pouvoir menant aux dérives intrinsèquement liées à la naissance des sociétés de la médiation, de la possession et de la rentabilisation.
La guerre localisée et circonscrite entre tribus est une façon pré-historique de repousser l’émergence économique du rencontrer avec la politique de l’avoir et donc d’endiguer la menace d’une délégation de pouvoir menant aux dérives intrinsèquement liées à la naissance des sociétés de la médiation, de la possession et de la rentabilisation.
Les communautés primitives refusent la différenciation économique et politique en s’interdisant le surplus matériel du spectacle social des prétentions et des représentations qui génèrent inévitablement les démesures infinies du marché narcissique du fétichisme des impuissances de l’ego qui réifie les êtres et qui divinise les choses.
Aujourd’hui, dans la société du triomphe de l’équivalent général-argent près de 30 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde, soit une toutes les quatre secondes, ceci dans l’indifférenciation démocratique la plus absolue puisque désormais tout a un prix et que cette mort est la première facture normalement due au système de l’échange qui veut que dans le circuit des transactions, chaque marchandise humaine soit indifféremment équivalente à n’importe quelle autre humaine marchandise consommée par la vie ou par la mort mais toujours digérée par les impératifs de la distribution financière de la quantité nécessaire.
À la différence de ces milliers d’errants isolés et solitaires qui décèdent, chaque année, dans le sans-abrisme froid, insensible et triste du despotisme de la valeur qui précisément les trouve sans valeur, cette jeune fille pré-historique dans le monde de l’anti-valeur, a eu le contentement de trouver des êtres d’être avec qui une relation d’essence, de sensation et de sentiment a pu jaillir en pur dé-sintéressement d’avoir et en strict attachement d’être…
De la sorte, nous sommes avertis que dans l’embarras momentané que pouvait occasionnellement rencontrer la communauté de l’être archaïque, jamais personne ne restait à l’écart de son groupe dans le délaissement et l’esseulement car l’abondance dans le satisfaire communautaire des chasseurs-cueilleurs était avant tout un accomplir de chacun en l’être et de l’être en chacun. À l’opposé, dans la société de l’avoir qui a aujourd’hui fini par définitivement voiler l’être à lui-même, l’abondance paranoïaque du système solipsiste des objets s’en va tellement loin dans l’abomination de l’in-sensible que le dés-intéressement pour l’être humain qui ne serait pas produit rentable de marchandisation estampillé, peut tout à fait tolérer la mort industrielle de millions d’hommes qui n’ont pas le bon ticket pour entrer dans les grandes surfaces où s’obtiennent les accréditations certifiés pour la sur-vie organisée.
Au moment où la crise radicale du monde du produire de l’intérêt est en train d’atteindre le point crisique majeur où le produire de l’intérêt mondial ne peut plus supporter les mensonges du crédit par lesquels il a longuement fait semblant de croire que la vérité de sa finitude spatiale pourrait être compensée par une fausse infinitude temporelle, il est plus que jamais temps de se remémorer les inspirations et les enthousiasmes d’avant l’argent… Ce vieux monde pourri de temporalité marchande va crever et c’est tant mieux, regardons donc un tout petit peu vers l’Homo heidelbergensis, non pas évidemment pour fuir déraisonnablement dans un retrouver nostalgique impossible qui n’aurait pas de sens mais pour penser subversivement la rationalité du sens de la communauté humaine, cette fois non plus locale, restreinte et étriquée mais universelle, cosmique, révolutionnaire et consciente du Tout historique de son histoire…
Contre la pourriture marchande qui sacralise les errances de l’oubli de l’être…
À bas l’échange, le salariat et l’État…
Vive la communauté ontologique et universelle de l’être de l’homme…
Gustave Lefrançais
(pseudonyme de Francis Cousin) 13 septembre 2009.

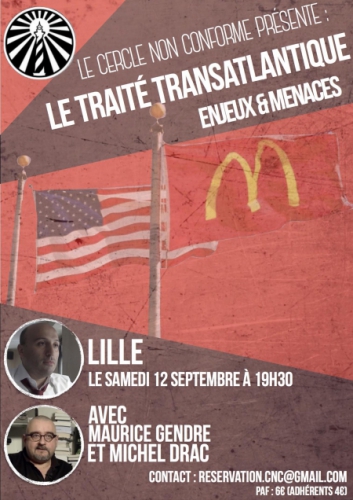
 Comme vu dans la première partie, l'essentiel du bouclier est connu par le biais de ses parties métalliques : umbo, rivets / clous, orles, manipule. On peut néanmoins imaginer, aidés en cela par certains indices archéologiques et des témoignages antiques, d'autres aspects intéressants.
Comme vu dans la première partie, l'essentiel du bouclier est connu par le biais de ses parties métalliques : umbo, rivets / clous, orles, manipule. On peut néanmoins imaginer, aidés en cela par certains indices archéologiques et des témoignages antiques, d'autres aspects intéressants.  Il faut garder à l'esprit que le bouclier gaulois était certainement un consommable pour le guerrier. En effet, une personne entrainée peut aisément, lorsque la planche est brisée, la remplacer en quelques minutes avec les mêmes pièces métalliques. Le bouclier gaulois nous donne une image précieuse et enrichissante quant aux techniques de combats développées dans son aire d'influence. Il semble être au centre de la manière de combattre des Celtes et a certainement contribué à façonner leur réputation de farouches mercenaires.
Il faut garder à l'esprit que le bouclier gaulois était certainement un consommable pour le guerrier. En effet, une personne entrainée peut aisément, lorsque la planche est brisée, la remplacer en quelques minutes avec les mêmes pièces métalliques. Le bouclier gaulois nous donne une image précieuse et enrichissante quant aux techniques de combats développées dans son aire d'influence. Il semble être au centre de la manière de combattre des Celtes et a certainement contribué à façonner leur réputation de farouches mercenaires.