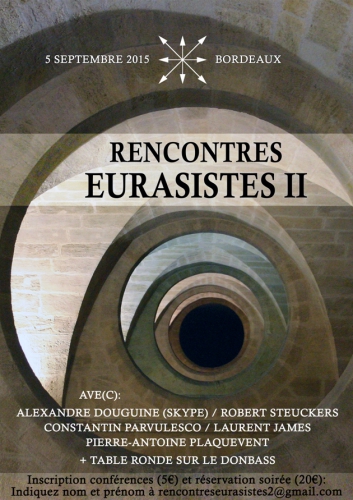Dans les discours des politiciens au pouvoir, dans les annonces des médias aux ordres (c’est-à-dire tous les médias) et dans tous laïus émanant des organes de désinformation, qu’ils soient de l’Université ou de CNRS, il n’est plus question que de « valeurs ». Un millénaire et demi d’histoire de France se résume et se réduit aux seules « valeurs de la République », prétendues ou frelatées. Toute la gauche, qu’elle soit frondeuse ou courtisane, s’est mise à réciter, de conserve avec les idiots utiles, le catéchisme des « valeurs », et personne, aucun journaleux, aucun Plantu de sous-préfecture, aucun dessinateur, aucun rebelle, aucun anticonformiste, aucun intello, aucun insolent (et pourtant, il n’y a plus que ça à gauche) n’éclate de rire devant l’incongruité de cet appel aux « valeurs ». Il n’y a pas un seul humoriste qui ait assez de lucidité ou de mauvais esprit pour faire remarquer que l’injonction « valeurs » résonne comme ces cris que l’on entend partout dans les rues de France : « voleurs ! ».
Valeurs, au pluriel comme au singulier, connote la droite. La valeur, c’est le mérite, l’exigence, le talent (et l’inégalité des talents), le courage, la force. C’est Corneille, Le Cid, Bossuet, etc. Il n’y a pas de mots qui connotent plus clairement la droite que valeurs et valeur. Les valeurs, c’est la tradition vivante. Elles appellent à conserver ce qui vient du fond des âges ; elles consistent à transmettre ce qui a été enseigné par les ancêtres ; elles incitent à s’inscrire dans une longue lignée. Elles font abandonner le principe de précaution pour le devoir de préservation ; et au changement, elles font préférer la continuité ; à la rupture, l’inscription dans le temps ; à la fascination pour le présent, le respect du passé. Du futur (ou de l’utopie), faisons table rase : voilà ce que disent les valeurs.
Il est vrai que ces « valeurs », dont on nous rebat les oreilles, ne sont pas « les » valeurs, mais « des » valeurs, et uniquement celles de la République. Naguère, les républicains durs et durs expliquaient que la République n’était pas fondée sur des valeurs, mais sur des principes. Hollande, le cantonnier de Tulle habitué aux travaux de terrassement (il terrasse tout ce qui entrave sa marche en avant), et sa clique en ont décidé autrement. Les gens de gauche doivent se résigner à ce que le changement, ce ne soit pas Mme de Maintenant, mais la psalmodie des « valeurs » volées au camp d’en face.
Quelles sont ces valeurs ? La liberté ? La France, comme son nom l’indique, est non seulement le pays des Francs, mais aussi le pays des affranchis. Depuis la nuit des temps, il est le premier Burkina Faso (« pays des hommes libres ») qui ait existé dans le monde. Si la liberté est une « valeur », elle est depuis mille cinq cents ans ou davantage une valeur de la France. A moins d’entendre « république » dans son sens latin de res publica ou « chose publique », « Etat », « bien public », la liberté n’a rien à voir avec la République. Elle a d’autant moins à voir avec elle qu’en septembre 1792, la République, à peine proclamée, n’a pas jugé plus urgent que de supprimer toutes les libertés publiques et privées qui avaient été pourtant déclarées « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » trois ans auparavant, alors que la France avait pour régime politique la monarchie absolue de droit divin.
Il en va de même de l’égalité. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » : voilà le préalable de la Déclaration des droits de 1789 que les représentants de la jeunesse noble et du clergé éclairé ont donnée au peuple français. Alors, la France n’était pas une république, encore moins la République, mais une monarchie absolue de droit divin. La fraternité n’a pas ses origines dans la République, qui a montré à plusieurs reprises, en fusillant, coupant des têtes, massacrant, commettant un « populicide » en Vendée, faisant la guerre à quasiment tous les peuples de la Terre, etc. qu’elle tenait la fraternité pour pet de lapin. Certes les francs-maçons, qui, contrairement à ce qu’ils prétendent, ne sont ni francs, ni maçons, ressentent pour la fraternité une indéniable inclination, mais restreinte aux habitués de leurs loges. Ils sont frères, mais entre eux seulement. En cela, ils ne sont pas différents des Frères musulmans, qui se disent tous frères de tous les hommes du monde, mais à condition que ces hommes ne soient ni mécréants, ni chrétiens, ni athées, ni animistes, ni femmes, ni homos, etc. et soient tous béats devant le messager d’Allah.
La laïcité ? Le mot est grec et chrétien. Il est chrétien depuis deux mille ans. Il pose que le « temporel » (le politique et le social, le pouvoir, la société) et le « spirituel » (le religieux) sont deux ordres distincts et séparés, ce qu’ils ont toujours été. La laïcité, qui est toute chrétienne, n’a rien de républicain et, si elle a quelque chose de républicain, c’est que la République, de 1881 à 1906, l’a instrumentalisée pour la retourner contre ces chrétiens que sont les catholiques et les humilier avec la même hargne imbécile qu’elle humiliait les indigènes de ces pays sous souveraineté française qu’étaient le Tonkin, l’Algérie, la Tunisie, le Soudan, etc.
Les « valeurs » de la République, celles qui y sont spécifiques, comme inhérentes et consubstantielles, ne sont pas celles que M. Hollande et ses séides proclament avantageusement, mais ce que la République a mis en œuvre et réellement accompli de 1792 à 1962 et ce sur quoi sont greffées ses valeurs, au point de ne faire qu’un avec elle. La République, ce sont les massacres de septembre 1792, le « populicide » (c’est-à-dire le génocide) de Vendée, la politique de la terreur, la guillotine pour tous, le massacre à coups de baïonnettes et de canons en novembre 1795 de femmes, d’enfants, de vieillards manifestant pour la liberté, la guerre contre tous les peuples d’Europe (Italiens, Espagnols, Anglais, Flamands, Autrichiens, Prussiens, Russes, Egyptiens, etc.), la répression par l’armée en juin 1848 d’ouvriers qui manifestaient dans les rues, la répression sanglante en avril et mai 1871 des Parisiens qui avaient soutenu la Commune, les guerres de conquête coloniale, le racisme, la répression par l’armée des ouvriers en grève, la boucherie de 1914-1918, les 19 morts du 6 février, l’armistice de juin 1940 et le suicide qui s’en est suivi, les guerres coloniales imbéciles, le massacre par l’armée de civils dans la rue d’Isly, etc. Voilà les valeurs que la République a pratiquées et illustrées pendant près de deux siècles.
L’Etat islamique et toutes les organisations, associations, confréries qui se réclament du même islam s’illustrent par des crimes barbares qui horrifient les citoyens. Mais dieu que les républicains ont la mémoire courte ! Ces mêmes crimes ont jalonné l’histoire de la République. Le terrorisme ? C’est une invention républicaine qui a ensanglanté la France en 1793 et 1794. Le vandalisme ? Il n’est pas propre aux talibans ni aux djihadistes. C’est une invention de la Première République : destructions de statues, vol de tableaux et d’œuvres d’art, arasement d’édifices historiques, incendies de bâtiments publics et de bibliothèques… Le génocide ? Mais qu’est-ce que le populicide de Vendée (terme inventé par Gracchus Babeuf en 1796), sinon un génocide et que la République n’a jamais reconnu, ni a fortiori regretté ? A quoi bon exiger des turcs qu’ils reconnaissent le génocide dont ils se sont rendus coupables si l’on est soi-même incapable d’ouvrir grand les yeux sur son passé récent ? Les massacres de populations civiles ? Ils ont été une spécialité de la République, que ce soit en France (novembre 1795, juin 1848, avril-mai 1871, etc.) ou dans les territoires de l’Empire (Espagne, Algérie, Afrique, Indochine, etc.).
On voit la stratégie de Hollande et des socialistes au pouvoir : ce n’est que com. Ils feignent de s’approprier les valeurs, ils font applaudir les forces de police qu’ils haïssent, ils câlinent l’armée qu’ils réduisent à la famine, ils font semblant d’être de « droite », uniquement pour s’abriter de la colère du peuple.
© Arouet Le Jeune pour LibertyVox
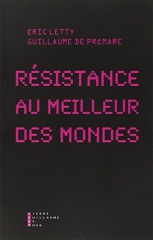 Comme chaque année, à l’occasion de l’été, Boulevard Voltaire vous offre des extraits de livres. Cette semaine, Résistance au meilleur des mondes, par Éric Letty et Guillaume de Prémare. Cliquez sur la couverture du livre pour l’acheter.
Comme chaque année, à l’occasion de l’été, Boulevard Voltaire vous offre des extraits de livres. Cette semaine, Résistance au meilleur des mondes, par Éric Letty et Guillaume de Prémare. Cliquez sur la couverture du livre pour l’acheter.