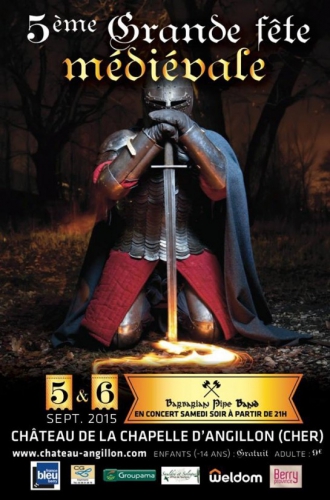Il y a des choses formidables chez Péguy. Surtout à partir de 1905, quand, conscient de la menace allemande et de l'approche de la guerre, il opère un virage, se détache des socialistes et se rapproche des nationalistes (Notre patrie étant le premier jalon de ce second Péguy).
Je reparcours aujourd'hui L'Argent suite, qui est paru il y a exactement un siècle, le 27 avril 1913 (dans les Cahiers de la quinzaine, XIV, 9). Une partie du pamphlet est consacrée à invectiver les socialistes, et en particulier ces deux fameuses figures que sont Jean Jaurès et Lucien Herr, que nombreux aujourd'hui à gauche regardent comme des totèmes, des sources d'inspiration, des autorités morales incontestables. Parmi d'autres griefs, Péguy leur reproche non seulement d'être aveugles face à l'impérialisme allemand, mais aussi de mentir pour occulter cette réalité, et plus encore : d'être carrément des traîtres. Ainsi : « Alors comment se fait-il qu'on nous parle toujours des autres [victimes de l'impérialisme] et qu'on ne nous parle jamais de ceux qui demeurent nos frères [= les Alsaciens-Mosellans]. / Pour Jaurès l'explication est extrêmement simple. Il est pangermaniste. (Il faudrait l'en féliciter, s'il était né sujet allemand.) Il est un agent du parti allemand. Il travaille pour la plus grande Allemagne. » (Pléiade tome III, 1992, p. 932).
Mais je suis surtout tombé sur un paragraphe fascinant par sa contemporanéité. Péguy égrène les belles notions qui ont été détournées, trahies, infectées par la coterie Herr-Lavisse-Jaurès. Il y a le dreyfusisme, le socialisme, l'État, le laïcisme, la République, la force révolutionnaire et l'internationalisme.
« L'internationalisme enfin qui était un système d’égalité politique et sociale et de temporelle justice et de mutuelle liberté entre les peuples est devenu entre leurs mains une sorte de vague cosmopolitisme bourgeois vicieux et d'autre part et très particulièrement et très proprement un pangermanisme, un total asservissement à la politique allemande, au capitalisme allemand, à l'impérialisme allemand, au militarisme allemand, au colonialisme allemand. » (p. 945).
Déjà sous cette forme, la phrase est troublante par son actualité, vu comme le gouvernement socialiste multiplie les signes d'allégeance à l'Allemagne et s'incline totalement devant la conception allemande de l'Europe, François Hollande n'ayant dailleurs rien eu de plus pressé à faire, le jour même de son investiture (!), que de prendre un avion pour Berlin afin d'aller soumettre ses lettres de créance à la chancelière. Cependant, un siècle après 1913, la puissance mondiale dominante n'est plus l'Allemagne, mais les États-Unis d'Amérique. La phrase mérite donc d'être transposée :
L'internationalisme est devenu entre leurs mains une sorte de vague cosmopolitisme bourgeois vicieux et d'autre part et très particulièrement et très proprement un panaméricanisme, un total asservissement à la politique états-unienne, au capitalisme états-unien, à l'impérialisme états-unien, au militarisme états-unien, au colonialisme états-unien.
Saisissant, non ? Alors que se multiplient les signes qui annoncent que le quinquennat de Hollande sera aussi atlantiste que celui de son prédécesseur, voire plus encore, on ne peut manquer de s'interroger sur la continuité qu'affichent les socialistes dans leur mentalité de colonisés intellectuels, économiques et géopolitiques. Le « cosmopolitisme bourgeois vicieux » semble désigner Dominique Strauss-Kahn ou Jack Lang, mais c'est anecdotique. Bien plus importante est l'idée que les socialistes, parce qu'ils se veulent progressistes et modernes, s'aplatissent toujours devant le système de pensée dominant et la grande puissance qui l'incarne, qui le promeut, qui l'étend. Les socialistes de 1913 se comportaient objectivement en agents d'influence de l'Allemagne, au nom d'un chimérique idéal pacifiste et internationaliste. Les socialistes de 2013, au nom d'un idéal presque identique, se comportent objectivement en agents d'influence des États-Unis, du capitalisme états-unien, de la culture états-unienne.
Et cependant Péguy exagérait. Autant il avait raison de souligner l'aveuglement de Jaurès et des siens quant au pacifisme et à l'antimilitarisme du S.P.D. (à peine un an plus tard, les socialistes allemands devaient donner raison à Charles Andler et Péguy en ne faisant rien pour empêcher la guerre et en votant sans sourciller les crédits militaires), – autant il faut bien reconnaître que les socialistes français firent de même : ainsi René Viviani, Alexandre Millerand, Albert Thomas, loin de manquer à l'Union sacrée, se distinguèrent-ils dans leurs fonctions ministérielles pendant la Grande Guerre. Or, peut-on imaginer les Hollande, les Ayrault, les Valls, les Fabius, les Kouchner, les Moscovici, les Vallaud-Belkacem s'engager dans une guerre contre l'Allemagne ? ou une guerre contre les États-Unis ?!! Contre les islamistes du Mali, contre la Syrie d'Assad, contre n'importe quel dictateur qui met du sable dans les rouages du nouvel ordre mondial, contre la Russie, oui, on l'imagine très bien. Mais contre les États-Unis, pas une seconde. Dailleurs plusieurs d'entre eux, à commencer par Hollande, ont participé au programme « Young Leaders » de la French-American Foundation. C'est dire si ce sont des agents états-uniens à bien meilleur titre que Jaurès ne fut un agent allemand...