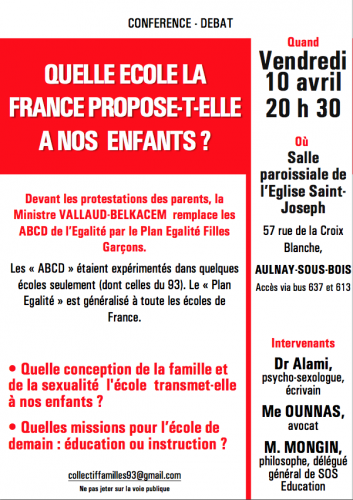Éric Stemmelen, La religion des seigneurs – Histoire de l’essor du christianisme entre le Ier et le VIesiècle, éd. Michalon, Paris, 2010. € 22.
En affirmant à la fois l’unicité et l’intelligibilité du cosmos, puis en l’investiguant par la libre réflexion appuyée sur l’observation et l’expérimentation, les Grecs de l’antiquité avaient fait accomplir à la pensée un véritable saut quantique. Sur ce plan, aucune civilisation ne fut jamais comparable – la nôtre, immergée dans son ébriété marchande et technicienne, n’étant que l’héritière bâtarde et improbable du « miracle grec ». Cette performance unique fut au fondement de la culture dite « gréco-romaine », dont le cadre politique fut, durant des siècles, l’œuvre tenace d’un autre peuple de génie, l’Empire romain que Nietzsche considérait comme « la forme d’organisation la plus grandiose jamais atteinte jusque-là, et en comparaison de quoi tout ce qui précède, tout ce qui suit, n’est qu’ébauche, amateurisme, dilettantisme » (L’Antéchrist, § 58).
L’ouvrage d’Éric Stemmelen dont il est ici question aborde un épisode absolument crucial de notre histoire puisqu’il ne s’agit de rien de moins que de comprendre comment une secte juive dissidente a pu en arriver à conditionner toute la destinée future de l’Europe et du monde en s’emparant du pouvoir dans l’Empire romain et en détruisant de l’intérieur une civilisation millénaire. Car, proclamait déjà le philosophe au marteau, « le christianisme a été le vampire de l’imperium Romanum, il a défait du jour au lendemain ce que les Romains avaient fait de prodigieux, défricher le sol où édifier une grande civilisation qui avait letemps pour elle » (ibidem). L’auteur constate que le phénomène est traditionnellement étudié dans sa dimension idéologique et, donc, à partir des témoignages chrétiens. Il choisit, quant à lui, de privilégier une démarche différente : elle consiste à délaisser le roman fantastique tramé par ces sources « internes » pour envisager résolument le processus du dehors, en le replaçant « dans les évolutions politiques, économiques, sociales du monde romain » (p. 10).
Stemmelen commence par faire un sort au mythe de l’irrésistible ascension du christianisme, censé culminer avec la conversion de l’usurpateur Constantin (306-337). Et en effet, comme ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l’histoire, on ne s’étonnera pas que, jusqu’à nos jours, l’historiographie traditionnelle soit imprégnée d’une vision plutôt conforme aux vœux de l’Église : le surnom de « Grand » conféré à Constantin est, en ce sens, révélateur. Depuis le triomphe de cette dernière, le christianisation est en effet présentée comme un processus irrésistible, nécessaire et bénéfique, s’inscrivant dans le « sens providentiel de l’histoire » et venant parachever le cycle civilisateur du progrès humain. Le récit se résume à la geste héroïque et vertueuse d’une communauté militante vouée au bien-être et au salut de l’humanité souffrante, à l’éloge des qualités intellectuelles et éminemment morales du message véhiculé par les évangiles (τὸεὐαγγέλιον : la « bonne » nouvelle) et, last but not least, à l’évocation des sanglantes persécutions prétendument orchestrées par un pouvoir romain buté dans son pathétique attachement aux traditions « païennes ». Ainsi, en 1939, l’historien et académicien Jérôme Carcopino, parlant de la chrétienté, écrit sans rire : « Évidemment sa croissance souterraine a progressé avec une étonnante rapidité ; … La religion des Juifs avait exercé son attrait sur nombre de Romains séduits par la grandeur de son monothéisme et la beauté du Décalogue. Celle des Chrétiens qui rayonnait des mêmes lumières, mais qui, de plus, divulguait un splendide message de rédemption et de fraternité, ne tarda pas à y substituer son propre prosélytisme » (La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire, p. 163). Dans cette vision, le monde romain était déjà largement et spontanément converti dès le IIIe siècle. Le ralliement de Constantin au parti chrétien et sa conversion apparaissent dès lors comme l’achèvement d’un processus et non comme un « basculement ». C’est ce qu’écrit, par exemple, le cardinal Daniélou dans sa Nouvelle histoire de l’Église (1963) : « Au début du IVe siècle, les forces vives de l’empire étaient en grande partie chrétiennes. … En dégageant l’empire de ses liens avec le paganisme, Constantin ne sera pas un révolutionnaire. Il ne fera que reconnaître en droit une situation déjà réalisée dans les faits ».
Or, les résultats les plus récents de la recherche infirment cette sentence, et c’est sur eux que s’appuie la thèse de Stemmelen. Il faut surtout signaler les travaux de Robin Lane Fox et d’Alan Cameron aux États-Unis, de même que ceux de Pierre Chuvin et de Claude Lepelley en France. Ils apportent un sérieux bémol à cette vulgate de l’histoire chrétienne. En bonne méthode critique, ces auteurs sont retournés aux sources pour constater que la dite vulgate n’a guère d’autres fondements que les écrits, partisans et polémiques, des auteurs chrétiens eux-mêmes. En fait, de nombreux témoignages montrent que jusqu’en plein IVe siècle, les cultes traditionnels – « païens » – gardent toute leur vigueur ; à l’inverse, jusque vers le milieu du IIIe siècle, le corpus des textes non chrétiens ne comporte que très peu de témoignages de l’existence du christianisme, sans parler de l’authenticité douteuse de certains d’entre eux. Il en va de même des données épigraphiques, papyrologiques et archéologiques dont l’importance ne devient vraiment significative qu’à l’approche du IVe siècle. Si ce constat pose un rude problème méthodologique du fait que les affirmations de l’apologétique chrétienne – déjà suspectes en soi – ne peuvent guère être contrôlées par des recoupements externes, il laisse en tout cas soupçonner que la secte chrétienne a plus ou moins végété durant deux bons siècles, sinon dans le mépris, du moins dans la quasi indifférence générale, perdue qu’elle était dans le foisonnement des religions et des doctrines philosophiques d’un monde polythéiste et donc « pluraliste » par nature. Ce soupçon devient conviction lorsque l’on considère la faiblesse numérique des chrétiens avant et longtemps encore après leur prise du pouvoir : selon des estimations plausibles – car fondées sur des documents peu nombreux, certes, mais néanmoins révélateurs –, à la fin du IIe siècle, ils ne représentaient qu’à peine 2 % des habitants de l’Empire, et, au début du IVe, pas plus de 4 ou 5 %. Encore faut-il tenir compte des disparités régionales inhérentes à l’immensité de l’Empire : dans les provinces européennes, hormis Rome et quelques villes importantes, on tombe à 1 ou 2 %. Quant à l’Égypte, riche de sa documentation papyrologique et tenue pour l’un des premiers gros bastions du christianisme, elle ne devait compter tout au plus que 20 % de convertis à la même époque. On est loin de l’irrésistible et rapide conversion des masses décrite par les historiens conformes ! Et pour ce qui est des trop fameuses « persécutions », soit dit en passant, elles relèvent, pour l’essentiel, de fictions propagandistes chrétiennes : jusqu’au milieu du IIIe siècle et surtout jusqu’aux mesures bien trop tardives de Dioclétien (284-305), le pouvoir romain ne se préoccupa guère d’une secte si peu importante – de minimis non curat praetor –, et les actions antichrétiennes se résumèrent à des faits anecdotiques locaux, plutôt rares et aux effets limités.
Ce constat entraîne une conséquence capitale : le ralliement de Constantin ne peut plus être considéré comme l’aboutissement inévitable d’une christianisation avancée de l’Empire, mais bien comme un coup de force révolutionnaire qui imposa, en peu de temps, la dictature du parti de « Dieu ». Ceci apparaît d’autant plus clairement que, par ailleurs, la « question constantinienne » semble désormais tranchée. Elle s’était longtemps posée aux historiens qui s’interrogeaient sur la date de la conversion de Constantin : était-ce en 312, après sa fameuse vision et sa victoire décisive sur Maxence au pont Milvius, ou plus tard, en 326, après les meurtres de son propre fils Crispus et de sa seconde épouse Fausta, ou encore en 337, sur son lit de mort, lorsqu’il reçut enfin le baptême (une astuce d’époque, pour se faire pardonner jusqu’au dernier de ses innombrables péchés) ? On a maintenant de bonnes raisons pour fixer l’événement en 312 et pour rechercher sa cause du côté des nécessités politiques bien plus que des convictions religieuses.
La grande crise du IIIe siècle, avec ses usurpations, ses sécessions et ses guerres civiles, avait en effet gravement ébranlé l’image impériale. Pour la restaurer, les « empereurs soldats » avaient recouru à un stratagème idéologique qui consistait à se poser comme les représentants sur terre d’un dieu suprême. Aurélien s’était ainsi voué à Sol Invictus, tout comme les tétrarques Dioclétien et Maximien respectivement à Jupiter et à Hercule, ce qui leur conférait une légitimité d’essence divine, censée disqualifier les usurpateurs. Or, précisément, Constantin était un usurpateur qui, en 306, n’avait pas reculé devant un coup d’État et devant une guerre civile pour s’assurer de la succession de son père, Constance Chlore, au détriment des règles constitutionnelles de la Tétrarchie nouvellement instaurée par Dioclétien. Confrontés à des adversaires qui s’appuyaient sur les cultes encore vivaces des divinités traditionnelles de l’Empire, il s’était d’abord tourné vers les figures tutélaires d’Apollon et de Sol Invictus avant de sauter un pas décisif en adoptant, pour mobiliser ses troupes, une divinité d’un tout autre genre et en misant sur l’appui d’un mouvement religieux très minoritaire, certes, mais disposant d’atouts idéologiques indiscutables, et solidement organisé par des activistes passés maîtres dans l’art de l’agit-prop. Depuis longtemps, en effet, malgré son penchant affiché pour les misérables, l’ecclésia chrétienne avait réussi à gagner de l’influence auprès de certains éléments des couches aisées voire fortunées de la société, sans doute séduits par l’aplomb d’une doctrine qui non seulement prétendait donner réponse catégorique à toutes les interrogations existentielles, mais encore synthétisait des idées familières véhiculées autant par les gnoses et mystères orientaux que par une certaine philosophie grecque (dualisme, monothéisme, universalisme, eschatologie, sotériologie). Ce sont ces milieux qui avaient fourni le financement et les cadres éduqués indispensables à la propagande et à la crédibilité du mouvement au plus haut niveau. Ainsi, l’Africain Tertullien (entre 160 et 225) tout comme Minucius Felix, son quasi-contemporain, étaient des avocats des plus aisés, l’un à Carthage, l’autre à Rome, et nombreux étaient les évêques issus de familles très riches, tel Cyprien à Carthage (200-258).
C’est ainsi que l’on peut établir une conjonction entre les besoins de la politique et l’offre idéologique de l’époque : pour assurer son coup de force politique, Constantin fit le pari d’une nouvelle légitimité reposant sur une formule simple, démagogique et à l’efficacité prometteuse. L’analyse ne peut toutefois s’arrêter en si bon chemin car, ce faisant, l’usurpateur prenait le risque de se mettre à dos l’écrasante majorité des habitants de l’Empire. Comment, dès lors, expliquer son calcul ? Stemmelen, comme il l’a annoncé dans son prologue, procède alors à une approche « externe » des faits et vise à démontrer que le succès durable de Constantin tint au soutien décisif de la classe dominante des grands propriétaires, elle-même déjà largement gagnée par le christianisme.
Si l’on admet les aspects les moins contestables de la pensée de Marx, il faut ici rappeler que toute société se construit autour de trois contraintes qui sont l’exploitation économique, la domination politique et l’hégémonie idéologique. Selon le sociologue Robert Fossaert (La société. I : Une théorie générale, 1977), « l’instance économique tend à représenter l’ensemble des pratiques et des structures sociales relatives à la production de la vie matérielle de la société. Le concept central à partir duquel elle s’organise est celui de mode de production. L’instance politique tend à représenter l’ensemble des pratiques et des structures sociales relatives à l’organisation de la vie sociale. Le concept central à partir duquel et autour duquel elle s’organise est celui de l’État ». Quant à l’instance idéologique, elle se définit de la façon la plus large « comme l’analyse de l’ensemble des pratiques par lesquelles et des structures dans lesquelles les hommes-en-société se représentent le monde où ils vivent ». Si l’on transpose ces considérations au cas historique qui nous préoccupe, on voit que sa victoire de 312 assura à Constantin la mainmise sur l’appareil d’État romain (il liquidera Licinius, son corégent et beau-frère, en 325), laquelle conditionna la mise en place de l’hégémonie idéologique de l’Église et du parti chrétiens. Or, le caractère durable et, en fait, définitif de cette révolution induit nécessairement que des éléments dominants de la société étaient partie prenante dans l’opération car, comme le rappelle Stemmelen, « aucun régime politique ne peut gouverner contre la classe qui détient le pouvoir économique » (p. 110). Ce point constitue le noyau de la thèse développée par l’auteur, et il le résume comme suit (pp. 271-72) :
« Au IIe siècle, l’économie romaine est entrée dans un nouveau mode de production, fondé sur la propriété latifundiaire et sur le colonat, qui s’est substitué à l’esclavage traditionnel, en particulier en Orient et en Afrique. Il consiste à faire exploiter de très grands domaines agricoles par des paysans, dénommés « colons » [coloni], qui, bien que « libres » et non pas esclaves, doivent demeurer attachés à la terre qu’ils travaillent, pour le compte et au bénéfice d’un richissime propriétaire. Pour que ce système fonctionne, il est nécessaire que ces paysans se soumettent à l’autorité des grands propriétaires fonciers, qu’ils acceptent de travailler pour le compte d’autrui alors que leur statut d’hommes libres ne les y oblige pas, contrairement aux esclaves, et enfin qu’ils fondent une famille et qu’ils assurent une descendance afin que perdure l’exploitation. Or, dans un monde aux mœurs plutôt relâchées, où règne une certaine oisiveté (le travail et la soumission étant réservés aux esclaves), rien n’incite des hommes libres à se plier à de telles contraintes. La religion chrétienne va fournir aux propriétaires l’instrument idéologique adéquat car elle est la seule à promouvoir avec force les valeurs d’autorité, de travail et de famille. Sa vision très particulière de la sexualité, réduite à sa fonction reproductrice, s’oppose radicalement aux mœurs antiques. Les nouveaux seigneurs fonciers vont donc favoriser l’essor de cette secte très minoritaire et utiliser ses cadres, les évêques, d’abord pour asseoir leur tutelle sur les coloni, ensuite pour s’emparer du pouvoir politique, ceci aux dépens de l’ancienne classe dominante esclavagiste représentée par l’ordre sénatorial. La création d’un empire chrétien s’ensuivra, avec la mise en place, au IVe siècle, d’un régime dictatorial, entièrement voué à la puissance et à l’enrichissement des seigneurs, et qui procèdera à une christianisation forcée. »
Dans son principe, cette thèse est séduisante en ceci qu’elle tente d’expliquer le triomphe de l’Église chrétienne non plus par de simples considérations idéologiques (les « vertus » intrinsèques du discours chrétien) mais, plus largement et plus fondamentalement, par des arguments d’ordre politique, économique et social. À la suite des profondes mutations subies par l’Empire romain durant le IIIesiècle,elle décrit, en fait, l’émergence d’un ordre nouveau totalitaire où, au travers d’une stricte hiérarchie de « seigneurs » (domini ; plus tard, en latin ecclésiastique, seniores), se conjuguent de manière saisissante les rets de l’exploitation économique, de la domination politique et de l’hégémonie idéologique. De haut en bas, on a ainsi le Dominus céleste – créateur et principe de l’univers –, puis le dominus terrestre – l’empereur, jadis simple princeps et désormais maître du monde par la grâce divine –, et enfin, de multiples domini locaux – grands propriétaires, soutiens et bénéficiaires ultimes du système tout autant qu’incarnation de celui-ci auprès du commun des mortels.
La démonstration, pourtant, ne laisse pas de susciter quelques objections. On ne peut, en effet, que s’étonner de voir l’auteur reprendre une affirmation du juriste italien Aldo Schiavone disant que « la crise de l’esclavage romain s’accompagne, à partir des débuts du troisième siècle après J.-C., de l’effondrement de tout le système économique de l’empire » (p. 30). Ce point de vue catastrophiste, fondé surtout sur les textes et partagé naguère par nombre de spécialistes, est aujourd’hui dépassé. Les recherches récentes des archéologues dessinent au contraire une image nettement plus favorable de la situation économique de l’Empire durant ce siècle troublé ; elles présentent, en outre, un tableau très différencié suivant les périodes et les régions. Par exemple, on sait maintenant que, si l’Afrique a connu alors un véritable « boom » économique, ce ne fut pas au détriment d’autres provinces et encore moins à celui de l’Italie, prétendument en complète régression : simplement, les acteurs économiques, les réseaux d’échanges et les centres de gravité ont évolué avec le temps. En particulier, les conséquences du déclin de la main d’œuvre servile ont été exagérées. Elle a surtout touché l’Italie, où les esclaves avaient été très nombreux à la suite des conquêtes de la République ; mais le processus s’était amorcé dès le Ier siècle de notre ère et, dans le monde rural, ses effets avaient été absorbés depuis, grâce aux restructurations rendues possibles par la persistance d’une nombreuse paysannerie libre, en Italie comme dans les provinces. Ceci dit, le nombre des esclaves restait tout de même non négligeable, ce qui, d’ailleurs, ne heurtait en rien les idéologues chrétiens. Dans ces conditions, on ne peut affirmer, sans plus, que « le colonat s’est substitué à l’esclavage traditionnel » et que « les nouveaux seigneurs fonciers » se sont établis « aux dépens de l’ancienne classe dominante esclavagiste représentée par l’ordre sénatorial ». La réalité fut plus complexe, sans aucun doute, mais, vu le caractère limité de nos sources, elle se laisse difficilement appréhender.
Le problème du colonat illustre bien cet état de choses. Le colon était un paysan libre qui, contre redevance, recevait le droit de cultiver une parcelle de terre agricole. Ce genre de bail à métayage était courant sur les grands domaines (praedia) privés ou publics du monde romain. Sous l’Empire tardif, les textes législatifs révèlent une apparente dégradation de la condition des colons. Ces derniers, ainsi que leurs descendants, sont désormais impérativement liés (adscripti) à leur « lieu d’origine » (origo), c’est-à-dire à la terre qu’ils cultivent. Ceci est apparu comme une préfiguration du servage médiéval, et, longtemps, on a cru y voir une mesure destinée à remédier à la défaillance de l’économie esclavagiste. En réalité, l’obligation de rester sur sa terre d’origine est une conséquence de la grande réforme fiscale promulguée par Dioclétien en 287. À cette occasion fut introduit le système de l’impôt par répartition qui consistait à attribuer à chaque unité fiscale, du haut en bas de la hiérarchie administrative, un certain nombre de parts (capita) de la charge globale. Les grands domaines fonciers comptèrent de la sorte parmi les unités de base, et, afin de soulager les agents du fisc, leurs propriétaires, les domini, eurent chacun pour tâche de répartir et de percevoir l’impôt (capitatio) dans leur domaine propre – ce qui n’était sans doute que la systématisation d’un pragmatisme bien antérieur. Aussi est-ce pour assurer la pérennité du rendement fiscal que les colons furent légalement adscrits à la terre. Ceux-ci restaient donc libres car l’obligation à laquelle ils étaient assujettis était de droit public et non privé : autrement dit, la loi visait à garantir l’intérêt de l’État – i. e. la rentrée de l’impôt – et non celui des propriétaires fonciers qui, de leur côté, bien sûr, cherchaient à maintenir leurs baux. Cependant, si la législation visait, au départ, à protéger les colons, elle ouvrait indéniablement la portes aux pires abus en déléguant aux domini non seulement la collecte de la capitation mais aussi le contrôle de l’obligation faite aux colons de rester en place. À la longue, évidemment, au gré des défaillances de l’État, le pouvoir de ces « seigneurs » finit par rompre l’équilibre et par détourner à son profit ce fragile cadre juridique.
Dans un monde où l’agriculture représentait encore la part majeure de l’économie, les grands propriétaires fonciers étaient, sans conteste, les principaux détenteurs des moyens de production, d’autant qu’ils étaient aussi impliqués dans les échanges commerciaux. Sous l’Empire tardif, ils formèrent une classe particulièrement opulente et puissante, en Orient et, plus encore, en Occident. On ne saurait dire, toutefois, qu’elle s’est constituée, par la grâce du colonat, en opposition à l’ancien ordre sénatorial « esclavagiste ». Elle est, en fait, le résultat des évolutions politiques, sociales et économiques des trois premiers siècles de l’Empire qui ont vu l’ancienne aristocratie italienne s’ouvrir peu à peu aux élites provinciales puis aux parvenus de toute sorte, alors même que l’économie agraire se restructurait diversement suivant les régions, en privilégiant d’autres modes de production que l’esclavagisme. Nonobstant, ce correctif mis à part, il est tout à fait plausible qu’une partie au moins de la classe des « seigneurs » ait joué un rôle actif et intéressé dans la promotion d’un christianisme promouvant si opportunément les valeurs « d’autorité, de travail et de famille » ; de nombreux signes montrent, en tout cas, que cette classe s’est largement ralliée au camp de Constantin puis de ses fils à partir de la victoire décisive du premier en 312, réalisant ainsi le « basculement » évoqué par Stemmelen.
Reste, maintenant, un point essentiel. De ce qui a été dit jusqu’ici, on peut conclure que l’ébranlement de l’Empire, au IIIe siècle, n’est pas, dans son essence, assimilable à une crise économique majeure – et encore moins à un « effondrement » –, comme le conçoit Stemmelen à la suite de toute une tradition historiographique marquée du plus typique des réductionnismes « modernes », à savoir l’économisme (« réduction à l’économie des finalités sociales et des buts du politique »). S’il en avait été ainsi, jamais l’Empire n’eût pu y survivre comme il le fit. La crise, bien réelle en tout état de cause, fut plutôt la conséquence d’un collapsus politique induit par une impasse géopolitique. Les effets de cette dernière, un temps maîtrisés, finiront par mener, au Ve siècle, à l’effondrement militaire et politique de l’Empire romain en Occident.
Depuis ses origines, en effet, le système impérial souffrait d’une contradiction majeure car, pour le faire accepter au terme de sanglantes guerres civiles qui avaient abattu le pouvoir du Sénat, Auguste, le premier empereur, avait dissimulé les réalités de la nouvelle monarchie militaire en perpétuant le décorum des institutions républicaines. On était donc toujours officiellement en République et le Sénat gardait, au moins nominalement, un certain nombre de prérogatives, dont la désignation de l’empereur, présenté comme le princeps, « le premier des sénateurs » (d’où le nom de « principat » donné au régime). Or, malgré l’opposition larvée de l’ordre sénatorial, les réalités ultimes du pouvoir se trouvaient maintenant de facto aux mains de l’armée (perpétuant l’idée du peuple romain en armes), sans qu’aucun principe constitutionnel ne vînt clairement définir les modalités de la succession impériale.
Par ailleurs, la République, régime oligarchique d’assemblée – par nature méfiant à l’égard des grands commandements affectés à de grandes entreprises –, n’avait jamais élaboré de concept stratégique autre qu’empirique et s’en tint toujours à quelques principes, dont le plus constant consista à ne dépasser sous aucun prétexte l’écosystème du bassin méditerranéen, berceau de la civilisation et base du système international dans lequel se déployait la politique romaine. Le Sénat crut possible, en effet, de se réserver « la part utile » du monde, quitte à abandonner le reste à son sort, faisant sur ce point essentiel bon marché des pesanteurs de la géopolitique et transposant à l’échelle de l’œkoumène un comportement de propriétaire terrien typique de l’aristocratie romaine. Ce fut le génie novateur de César qui, au temps de la révolution romaine, amena la rupture avec cette posture restrictive en concevant une authentique « grande stratégie » accordée à la vision d’un empire universel. Le nouveau concept tirait les conséquences de la situation très particulière et aussi très préoccupante de l’empire républicain, lequel, bordant presque tout le pourtour de la Méditerranée, se présentait comme une île inversée, avec ses côtes tournées vers l’intérieur et ses territoires déployés en arc de cercle, ouverts aux profondeurs continentales. La vulnérabilité de ces frontières interminables s’étant brutalement révélée lors de l’invasion cimbrique qui avait frappé l’Italie et les provinces depuis la péninsule balkanique jusqu’à l’Espagne (113-101), l’objectif de César fut alors d’annuler ces frontières en portant les limites de l’empire jusqu’aux rivages de l’océan. La fameuse « guerre des Gaules » (58-51) fut l’amorce de cette « grande stratégie » qui, d’emblée, s’orienta vers l’Europe, hinterland de l’Italie. La mort du « dictateur » empêcha la réalisation d’un plan qu’il prévoyait de poursuivre depuis la Caspienne jusqu’à l’Atlantique. Le projet fut cependant repris par son petit neveu, Auguste, le premier empereur, qui, après avoir plus clairement encore donné la priorité stratégique à l’Europe plutôt qu’à l’Orient, poussa jusqu’à la Baltique, la Bohême et le bassin des Carpates. L’échec final de ce projet perspicace – dû plus à des raisons de politique intérieure qu’aux difficultés rencontrées (révoltes germaniques et illyriennes) – et le repli sur le Rhin et le Danube ordonné par Tibère, son successeur, constituèrent le tournant décisif de toute l’histoire stratégique romaine, car c’est sur ce front, entre mer du Nord et mer Noire, qu’allait se décider le destin de l’Empire et, par suite, de l’Europe. Cette décision, qui devait se révéler définitive, eut une double conséquence : d’une part, elle entraîna le retour, sur un mode élargi, à l’empire méditerranéen, caractérisé par un manque de profondeur stratégique sur le théâtre européen, et, d’autre part, elle redonna, par contrecoup et comme sous la République, la priorité à l’Orient et à ses mirages. Ce choix équivalait à une faute géopolitique capitale dont, aujourd’hui encore, la portée historique semble échapper autant aux historiens qu’à Stemmelen, qui écrit benoîtement que « Julien, comme bien avant lui Trajan ou Septime Sévère, avait compris que l’Orient pourrait redonner à l’empire romain une raison d’être et une identité collective » (p. 163).
Aussi, s’il n’y eut manifestement pas progression linéaire mais basculement du monde traditionnel vers l’ordre nouveau, la raison première en fut, selon toute apparence, la conjonction fatale entre les fragilités internes du régime impérial et une configuration géopolitique au plus haut point défavorable. La crise, déjà latente depuis la fin du IIe siècle, atteint son maximum au cours du IIIe, surtout durant les cinquante années qui s’écoulent de l’assassinat d’Alexandre Sévère (235) à la proclamation de Dioclétien (284). L’Empire est alors confronté à des attaques de grande ampleur simultanément sur plusieurs fronts. À l’est, sur le plateau iranien, la dynastie parthe déclinante cède la place à celle, beaucoup plus agressive, des Sassanides, lesquels se réclament de l’héritage des Achéménides, jadis vaincus par Alexandre le Grand ; en clair, ils revendiquent tout l’Orient romain et percent les défenses de celui-ci jusqu’à la Méditerranée. Au sud, les nomades du désert africain multiplient les razzias. Enfin, les peuples germaniques et leurs alliés s’ébranlent sur un front allant de la mer du Nord à la mer Noire, et lancent une multitudes de raids sans cesse renouvelés sur les provinces européennes de l’Empire : bientôt l’Espagne, l’Italie, la Grèce et même l’Asie Mineure sont touchées. La profonde dénivellation culturelle séparant l’Europe romaine des « Barbares » avait été l’occasion pour ces derniers de se mettre à l’école de la civilisation romaine, tout comme ils l’avaient fait, jadis, à celle des Celtes laténiens. L’archéologie révèle aujourd’hui l’ampleur des influences exercées par Rome sur ses voisins du Nord – à travers une diplomatie active, un commerce téléguidé, un recrutement assidu de mercenaires et un transfert étonnant de richesses et de technologies. Le résultat fut une militarisation et une organisation croissante des sociétés germaniques, dont les liens gentilices furent de plus en plus doublés par des structures politico-guerrières héritées des Celtes d’Europe centrale et perfectionnées au contact de la machinerie militaire romaine, celles des comitatus (all. Gefolgschaften) vouant, par serment, de grandes compagnies à des chefs de guerre entreprenants, capables de mener des actions prédatrices et de redistribuer ensuite le butin accumulé.
Sous cette formidable pression, le système défensif romain fut débordé et le transfert répété de troupes du front européen vers l’Orient entraîna la ruée toujours renouvelée de véritables armées germaniques vers les richesses convoitées du Sud. Pillages, destructions, massacres et déportations de prisonniers ne se comptèrent plus ; les provinces européennes furent ainsi le plus durement touchées et c’est là qu’on peut voir se profiler, à des degrés variables, le plus d’impacts économiques et sociaux. Le paroxysme fut atteint en 260, lorsque la défaite et la capture de l’empereur Valérien par les Perses entraîna la sécession de pans entiers de l’Empire, contraints de prendre acte de la défaillance du pouvoir central et d’assurer eux-mêmes leur défense. Les pronunciamientos et les usurpations, autant que les guerres internes et externes, consacrèrent le rôle démesuré des armées et achevèrent ainsi de désorganiser l’État. Celui-ci, en la personne des « empereurs-soldats », n’eut alors de cesse de se trouver une nouvelle légitimation capable de mobiliser les forces nécessaires à la reconquista et à la restauration de l’Empire. C’est dans ce contexte de chaos à peine maîtrisé que se place la totale refonte des institutions tentée par Dioclétien, encore placée sous les auspices de la religion romaine traditionnelle, et qui devait aboutir à l’éphémère système tétrarchique. C’est toujours dans ce contexte que le rebelle Constantin cherchera à imposer son pouvoir, cette fois, selon Stemmelen, en s’appuyant sur un tout nouveau parti de possédants et dans un esprit révolutionnaire implacable et sans scrupules que perpétueront ses successeurs. Jésus dit le « Christ », l’icône du nouveau régime, n’avait-il pas été explicite, en son temps, lorsqu’il déclarait sans ambages : « Quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les en ma présence » (Luc, 19, 27).
Conclusion : l’Histoire officielle mérite, à maints égards, une révision radicale. Les « racines chrétiennes de l’Europe », dont on nous rabat les oreilles, constituent un mensonge absolu : depuis quand des racines se trouvent-elles si haut sur l’arbre ? La christianisation fut un accident tardif de l’histoire européenne. Celle-ci plonge ses vraies racines bien plus loin, dans un passé fabuleux dont le Parthénon, les mégalithes et la grotte Chauvet ne sont que des étapes parmi tant d’autres. C’est en cela qu’il faut saluer le bel effort de Stemmelen : « La religion des Seigneurs » est un essai et, comme tel, l’ouvrage n’est pas exempt d’objections critiques, mais il n’en demeure pas moins un livre documenté et stimulant pour la discussion, d’autant que l’importance de son sujet n’est pas à démontrer.
Willy Fréson, juin 2011.
willy.freson@hotmail.com
http://vouloir.hautetfort.com/archive/2015/02/03/la-religion-des-seigneurs-5521297.html