culture et histoire - Page 1413
-
Bagadou Stourm - Stalingrad - Bezenn Perrot
-
Libre journal des lycéens: Notre héritage nomade (04/04/15)
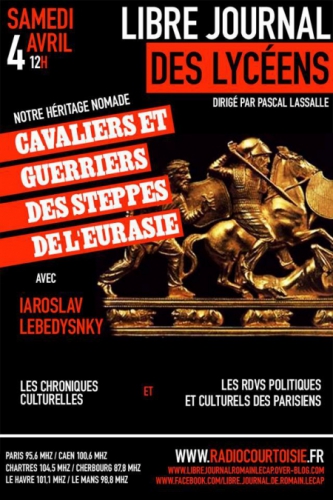
-
Jacques Doriot et le Parti Populaire français
Jacques Doriot et le Parti Populaire français
S.-d. Bernard-Henri Lejeune
Les Cahiers d’Histoire du Nationalisme n°3 (Synthèse Nationale, 2014)
Jacques Doriot et le Parti Populaire français est le second volet de l’étude que l’ancien membre du PPF, Bernard-Henri Lejeune, consacra à son ancien parti et à son célèbre dirigeant, Jacques Doriot. Le premier tome, consacré au PPF de 1936 à 1940 avait déjà été recensé par nos soins (ici) et il était logique d’en faire de même pour cette suite et fin. Une fois encore, cet historisme se présente sous la forme d’un copieux ensemble de documents et de témoignages nous éclairant sur ce que fut ce grand parti français de la débâcle de 1940 à sa fin tragique en 1945.
Indissociable de ce « parti de type fasciste », la figure de Doriot, du « Grand Jacques » comme on l’appelait affectueusement, est présentée par Roland Hélie qui retrace les grandes étapes de la vie de ce personnage haut en couleurs qui mit toute son énergie dans le combat politique au service du redressement de la France. Passé du communisme au socialisme national, ce qui ne fut finalement pas si rare dans l’avant-guerre, Doriot l’ancien métallo était « une prodigieuse force brute, excessive en tout […] un miracle de la puissance physique au service de la parole » nous rapporte Eric Labat. Un autre combattant bien connu du front de l’est, René Binet, confirme qu’ « il faisait grande impression sur les foules ». Solidement implanté à Saint-Denis dont il fut député-maire, il fonda en 1936 leParti Populaire français (PPF) qui devint rapidement un parti de masses. Combattant en 1940, il se range après la défaite derrière le Maréchal et fait du PPF le plus important organisme politique des années suivantes. Le prestige de Doriot n’y est pas pour rien : déjà fort connu en France, il s’engage sur le front de l’est, y gagne la croix de fer et n’hésite pas à multiplier les meetings politiques dès qu’il revient en permission sur le territoire national. Exilé à Sigmaringen en juin 1944, Jacques Doriot garde son optimisme et croit toujours en la victoire de l’Allemagne. Le combat politique pour le « gouvernement national et révolutionnaire » qu’il appelle de ses vœux continue à mobiliser toutes ses forces mais le « Grand Jacques » trouve malheureusement la mort sous les balles d’un avion allié le 22 février 1945 près de la ville allemande de Mengen.
Cliquez ici: https://www.youtube.com/watch?v=8p1M3tR3Mmc
Le PPF se désignait comme un parti « national, social, populaire » et se posait en défenseur des classes laborieuses et de la paysannerie. Farouchement anti-communiste, il s’inspirait certes du modèle mussolinien (en particulier sur sa charte du travail) mais restait avant tout un organisme original et indépendant. Appelant de ses vœux un homme nouveau qui aurait « le goût du risque, la confiance en soi, le sens du groupe, le goût des élans collectifs », le PPF souhaitait avant tout œuvrer pour la nation dans son ensemble et « refaire la France » pour reprendre Abel Bonnard. Pour faire « sortir du tombeau » notre pays, il convenait de rassembler les Français quelles que soient leurs différences (classes sociales, métropolitains ou coloniaux etc.). Le PPF s’intéressait à toutes les composantes de la vie de la nation et les documents présentés dans le présent ouvrage le montrent bien. De la religion au monde du travail en passant par la jeunesse, la presse ou le racisme, le parti entendait ne rien laisser au hasard dans son objectif de rebâtir la France dans une perspective révolutionnaire. Prenons pour illustrer ce propos l’exemple du programme d’urgence du PPF. Celui-ci faisait suite à la débâcle de 1940 et développait en 8 points ses propositions en cette période troublée :
- Le PPF exige la liquidation du communisme sous toutes ses formes, théoriques et pratiques, politiques et terroristes.
- Le PPF exige le châtiment des responsables de la guerre 1939-1940, de la livraison de l’Afrique du Nord et de la Corse aux Anglo-Américains.
- Le PPF exige l’examen par un Tribunal populaire de toutes des hommes publics, quels qu’ils soient, et la révision de tous les grands marchés et transactions commerciales passés depuis 1939.
- Le PPF exige l’abolition de la dictature des trusts et de l’exploitation capitaliste. Comme première mesure, le PPF exige la défense et le développement des Comités Sociaux d’entreprises et un appui matériel et moral aux syndicats qui œuvrent dans l’esprit de la Charte du Travail.
- Le PPF exige l’anéantissement de la puissance juive et la restauration d’une race française forte.
- Le PPF exige l’exclusion des francs-maçons de la vie publique.
- Le PPF exige le châtiment exemplaire des trafiquants du marché noir et l’organisation d’un ravitaillement cohérent.
- Le PPF souhaite une coopération entre les grandes puissances continentales pour l’établissement du nouvel ordre européen.
L’organisation du PPF, nationale et locale, fait l’objet de plusieurs documents dans l’ouvrage qui nous la font connaître dans les détails. Fortement structuré, hiérarchisé et discipliné, le PPF était construit autour de Jacques Doriot, ce Chef incontesté inspirateur d’une profonde mystique militante présente à tous les échelons du parti. Le sens du sacrifice y était honoré plus que tout autre. Dans le serment du parti, on trouvait ainsi le passage suivant : « Je jure de servir jusqu’au sacrifice suprême la cause de la révolution nationale et populaire d’où sortira une France nouvelle, libre et indépendante. » L’action et l’effort étaient également des marqueurs incontournables de la vie militante. L’esprit qui prévalait au PPF transparait bien dans cet extrait du discours que prononça Victor Barthélémy, numéro 2 du parti : « Prenez ce pays à bras-le-corps ; sortez-le de la défaite et de la honte. Ouvrez-lui toutes grandes les portes d’un avenir digne de son passé. Et faites fleurir sur les tombes de nos martyrs et de nos héros les lauriers féconds de la Révolution victorieuse. » L’engagement au PPF était pluriel, tant au niveau de l’origine sociale de ses membres que de leur parcours politique antérieur. Toutes les classes sociales y étaient représentées mais les ouvriers constituaient la majeure partie des effectifs (environ 35% en 1936 et 50% en 1942). Si de nombreux militants venaient originellement de la gauche (anciens communistes ou socialistes) ou de la droite au sens large (Action Française…), le parti du « Grand Jacques » avait toutefois réussi à attirer un grand nombre de personnes qui ne s’étaient jamais investies auparavant dans une structure politique. Le PPF, d’après les calculs de Bernard-Henri Lejeune, aurait compté sur un vivier de 30.000 militants sans prendre en compte les dizaines voire les centaines de milliers de sympathisants ! Il était donc un parti de masses et les meetings de Doriot dans les plus grandes villes de France en 1942 le prouvent bien. Tous les chiffres de ce tour de France des régions montrent le succès des réunions où le « Grand Jacques » prenait la parole devant des foules conquises. 4000 personnes à Lille, 5000 à Rouen, 7000 à Bordeaux !
La machine PPF, en plus de son efficacité organisationnelle, pouvait compter sur le soutien de nombreux intellectuels (Abel Bonnard, Alexis Carrel…). De prestigieux collaborateurs participaient (parfois épisodiquement) à ses différents organes de presse : Le cri du peuple, L’émancipation nationale, Les cahiers de l’émancipation nationale etc. Les noms suivants suffiront à vous en donner une idée : Benoist-Méchin, Alphonse de Chateaubriant, Cousteau, Drieu, Fontenoy, Fabre-Luce, Bertrand de Jouvenel, Montandon, Saint-Paulien, Suarez, Rebatet ou encore Jean Hérold-Paquis, chroniqueur de Radio Paris (dont est repris ici un superbe éditorial datant de 1943).
Dans Jacques Doriot et le Parti Populaire français, on retrouve plusieurs textes provenant directement de la plume de Bernard-Henri Lejeune ou de cette presse PPF que l’on vient d’évoquer. Ces articles ont été bien choisis car les thèmes sont diversifiés (La Commune, La médecine, Le PPF et la question anglaise, La question raciale...) et permettent de mieux connaître et comprendre les positions des doriotistes. Au sujet de la religion par exemple, Alain Janvier préconisait le régime concordataire comme « solution logique ». Estimant que « l’éducation antichrétienne, appelée laïque, a été l’origine de tous nos maux », ce membre du Bureau Politique du PPF se faisait le défenseur d’un nécessaire accord entre l’Eglise et l’Etat : « Nous devons favoriser les forces spirituelles et morales qui, plus que toutes les autres, ont contribué à la grandeur de la France. […] L’Eglise, gardienne de ces puissantes traditions, et l’Etat, sauvegarde du bien public, doivent donc s’accorder et, sur le plan spirituel, coordonner leurs efforts. » La question bretonne, chère au PPF, est également à l’honneur avec un article passionnant datant de 1943 où l’auteur fustige le jacobinisme français qui, depuis 1789, a cherché à tuer l’âme bretonne. Au contraire, il faut que la Bretagne reste elle-même, qu’elle conserve à tout prix sa personnalité et ses traditions ! Contre l’assimilation et l’unification, il convient de mettre en œuvre un « statut breton » qui apportera à la Bretagne « la place qu’elle doit avoir dans le cadre de l’Etat français » car « on doit l’admettre comme elle est » et non chercher à la faire changer. Ce sera la condition élémentaire « pour de jeunes bretons fiers de leur sol, de leur race et de leurs ancêtres et décidés à faire de la Bretagne l’élément dynamique et pur d’une France nouvelle, populaire et nationale. » Cette position de bon sens était logique lorsque l’on sait que, dès 1936, le PPF s’était positionné pour la reconstitution des anciennes provinces françaises !
Vous l’aurez compris, ce troisième volume des Cahiers d’Histoire du Nationalisme est un achat fortement recommandé car il permet de combler une vieille lacune : la méconnaissance de ce grand parti que fut le PPF. Il trouvera ainsi sa place à côté du Doriot de Jean-Claude Valla. La richesse de sa documentation en fait également un outil précieux à la compréhension des idées politiques de cette période de notre histoire.
Rüdiger / C.N.C.
-
Drac/Adinolfi "Les stratégies de la tension" Partie 1
Drac/Adinolfi "Les stratégies de la tension... par erlorraine -
La Révolution conservatrice allemande et le modèle italien sous la République de Weimar
Stefan Breuer : academia.edu :: lien
-
Nos Chers Vivants n°11 : Le Western Zappatiste
-
Épopée Québécoise en Amérique #11 - Enfin la guerre (1929-1945)
-
Bagadou Stourm - Bezenn Perrot - Bezenn Perrot
-
Perles de Culture n°50 - Daniel Dancourt présente "Les bourgeoises à la mode" au festival d'Orange
-
L’Entropie dans l’Histoire (1/4)
« Dès lors, considérer que « La nation, c’est la guerre » est une antienne de la doxa d’aujourd’hui. »
Introduction conclusive
L’Histoire, conçue comme l’identification objective d’événements passés, est envisageable comme la manifestation de la recherche de l’optimum écosystémique. L’écosystème est l’espace où sont optimisés l’usage des ressources et le contingentement des contraintes auxquelles sont soumis les individus, les populations et les communautés. L’écosystème est donc l’espace où, par des relations de réciprocité, ces entités se perpétuent. Envisagée ainsi, l’Histoire est la chronologie de crises majeures provoquant des ruptures irréversibles pour tendre vers l’optimum écosystémique. Nos génomes sont l’épicentre de cette dynamique. Ils réunissent des gènes spécifiques à l’origine de nos déterminismes biologiques et comportementaux en tant qu’individus, populations, communautés, lignées.
L’entropie est alors envisageable comme le moyen d’explorer de nouvelles postures et organisations écosystémiques. Dit en termes plus hermétiques, l’entropie est un facteur d’exploration de l’espace des phases des systèmes vivants à tous niveaux, des procaryotes à la biosphère.
La discipline de référence pour étayer cette vue est l’Ecologie intégrant la Thermodynamique et la Sociobiologie. Quatre articles courts vont nous permettre d’appréhender l’Histoire sous cet éclairage.
Article I de l’Entropie dans l’Histoire : le conflit comme moyen de survivre durablement.
Victor Serge et Ilya Prigogine
A l’occasion d’un exposé sur Victor Serge, figure de la Révolution russe, un historien résumait l’histoire de ce territoire à l’alternance de périodes longues, très rigides, entrecoupées de périodes plus courtes où tout était possible. Ainsi, proche de nous, à la Révolution russe succède le glacis stalino-bréjnévien. Aux errances gorbatcho-eltsiniennes succède la stabilité poutinienne…, jusqu’à maintenant. On verra ensuite. Dans des périodes plus reculées, l’ancienne Russie est déstabilisée au Temps des troubles (1598-1613) pour être extraordinairement stable de Pierre le Grand jusqu’à Nicolas II. De telles alternances sont observables partout, mais en Russie cela est particulièrement contrasté.
Issu de ces contrées, le physicien russe francophone Ilya Prigogine a résumé l’évolution des systèmes en non-équilibre thermodynamique (vivant ou non-vivant) par la succession d’états stationnaires longs et d’états marginaux brefs. Physiquement, la distinction entre ces deux états est caractérisée par la capacité ou non du système à absorber le « désordre ». En termes physiques, cela correspond aux situations où l’amplitude d’une fluctuation thermodynamique, donc d’origine entropique, est inférieure ou non à la longueur de cohérence du système. Pour les spécialistes, le modèle de référence pour formaliser ces situations est les équations de Lyapounov appliquées à la stabilité des systèmes dynamiques.
Que Prigogine, personne de haute culture connaissant parfaitement les vicissitudes de son pays, ait été à l’origine du modèle bio-physico-chimique qu’il a inventé ne ferait aucun doute pour un épistémologue. Personnalité scientifique majeure du XXe siècle, il eut l’intuition d’analyser la crise écologique ou environnementale en prenant appui sur la notion d’entropie qu’il a contribué à préciser. Ces travaux ont irrigué une multitude de disciplines, dont l’écologie. L’histoire envisagée à travers cette grille de lecture nous permet de saisir les raisons des changements profonds et des ruptures affectant nos écosystèmes artificiels que sont les sociétés humaines. L’histoire à travers ce prisme métapolitique n’est que la succession de stabilités et de ruptures brutales. Les ruptures ultimes sont les guerres intraraciales, c’est-à-dire celles opposant des individus semblables, distinguables uniquement par leurs emblèmes et leurs uniformes.
Pourquoi la guerre ?
Aujourd’hui, le fait est que nous vivons un état stationnaire depuis 1945. Le monde est en paix. Aucun conflit n’a opposé frontalement les grandes puissances. Certes, il y eut des morts lors de guerres périphériques, mais aucune n’atteignit les sommets de 1914-1918 et de 1939-1945. En outre, elles n’ont pas changé grand-chose à l’ordre du monde issu du dernier conflit mondial. Beaucoup voient dans ce succès le résultat de la disparition de l’état-nation dissous dans des ensembles fédérateurs. Dès lors, considérer que « La nation, c’est la guerre » est une antienne de la doxa d’aujourd’hui.
Il est vrai que les grands conflits depuis les guerres de la Révolution française ont comme pivot l’Etat-nation, seul capable de mobiliser les millions d’hommes appelés à porter les armes. Avant cela, pourtant, il y eut des conflits gigantesques comme la Guerre de Trente Ans, la Guerre de Sept Ans, etc., mais généralement celles-ci étaient le fait de chevaliers encadrant des cohortes de déclassés sociaux qu’une guerre de succession de quelque chose permettait d’occuper, assimilant dans cet esprit la guerre à de l’hygiène sociale pour les plus optimistes.
Cependant, ces morts et les désolations créées étaient déjà de trop, suscitant l’imagination pour les limiter. Ainsi, tout le monde aujourd’hui revendique les propos de Montesquieu qui dans De l’esprit des lois affirme que « Où il y a des mœurs douces, il y a du commerce », et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. A cela les marxistes répondront que l’essence du commerce, c’est le capitalisme ; que celui-ci conduit à l’impérialisme ; et l’impérialisme à la guerre – guerre que le maréchal Helmut von Moltke portait aux nues : « La guerre est sainte (…). Elle empêche les hommes de tomber dans le plus répugnant matérialisme. » Ce à quoi Maupassant répondait : « Entrer dans un pays, égorger l’homme qui défend sa maison (…) et laisser derrière soi la misère et le choléra : voilà ce qu’on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme… ». Etc.
Indépendamment des justifications possibles de la guerre se pose ainsi la question de ses déterminants avec comme seule réponse qu’il est impossible de les identifier à une seule cause. Les motifs pour faire la guerre sont innombrables. Un seul constat s’impose : c’est un phénomène récurrent dont il convient encore de réfléchir sur ses causes premières, amenant la vox populi à clamer que « la guerre est dans l’homme ». Allant plus loin, Ernst Jünger a pu écrire dans La Guerre comme expérience intérieure : « La guerre n’est pas instituée par l’homme (…), elle est loi de la nature. »
Un écologue ne pourrait désavouer ces propos car le conflit est immanent à la nature. Votre voisin est votre garde-manger, mais vous êtes son garde-manger. Et pourtant, tous vivent les uns à côté des autres. C’est donc cette loi de la nature irrépressible que nous allons éclairer à la lueur de l’écologie, de la thermodynamique et de la sociobiologie sur le fondement d’une idée-clé : les compétitions intra- et inter-espèces garantissent paradoxalement la pérennité des lignées interagissant.
Pourtant, l’heure n’est pas à l’exaltation de ces attitudes. Les générations nées pendant ou après le baby-boom n’ont jamais porté les armes et donc n’ont jamais participé à ces ordalies décisives. Une conscience de soi réduite à l’individu domine nos esprits actuellement.
Cependant, la conclusion s’imposant est que la guerre, ou le conflit en général, participe au façonnage des écosystèmes artificiels et à leur rééquilibrage, l’écosystème étant le lieu où les individus et les lignées constitutives se perpétuent. Le conflit est alors envisageable comme un phénomène éliminant les constituants et pratiques obérant la perpétuation des parties viables, mais aussi une réaction à la croissance de l’entropie irréversible que subit toute structure en non-équilibre thermodynamique. Il s’agit dans tous les cas de pérenniser leurs lignées constitutives.
Ainsi envisagé, le moteur de l’Histoire n’est pas le cheminement vers une fin, mais la perpétuelle adaptation à des changements. L’histoire est la manifestation de nos gènes, c’est-à-dire de la Vie, à se perpétuer. Nos aïeux qualifiaient cela de « vitalisme ». Ceci se fait à travers des génomes, des individus, des lignées, des populations, des communautés à la recherche d’un optimum écosystémique inaccessible en raison, d’une part, des changements perpétuels de la géosphère, et, d’autre part, de la croissance irréversible de l’entropie selon le second principe de la thermodynamique. Paradoxalement, la Vie ou plutôt nos gènes imposent ces ordalies que sont les guerres pour survivre. A l’issue de ces conflits, les systèmes politiques se recomposent sur des bases plus efficientes. Les personnalités dirigeantes changent ; des peuples entrent dans l’histoire ou en sortent ; les populations se restructurent sur des fondements plus viables ; les communautés se recomposent, etc. En résumé, l’ordre métapolitique mute.
C’est cette entropie consubstantielle à tout système en non-équilibre thermodynamique qui anime cette dynamique. (A suivre)
Frédéric Malaval, 9/03/2015
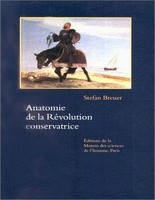 Les partis politiques fondés par Hitler et Mussolini laissentapparaître tant de similitudes dans leurs buts, leur organisation et leursmoyens de prédilection, que l’ont pourrait s’autoriser à parler d’un« dénominateur commun fasciste ». Si l’on considère leurs objectifs, cesont des « partis de patronage » au sens de Max Weber, dans la mesureoù ils revendiquent le pouvoir pour leur chef et son état-major. Leur organisation est de type charismatique, et leurs méthodes se préoccupent peu de la légalité, et faisant usage de la violence et de l’intimidation deleurs adversaires politiques est néanmoins leur divergence la plus frappante. Le régimeitalien se mue en dictature charismatique, certes, mais en se reposant sur des administrations d’Etat de type bureaucratique, et en ne s’éloignant pas fondamentalement du modèle étatique occidental moderne.
Les partis politiques fondés par Hitler et Mussolini laissentapparaître tant de similitudes dans leurs buts, leur organisation et leursmoyens de prédilection, que l’ont pourrait s’autoriser à parler d’un« dénominateur commun fasciste ». Si l’on considère leurs objectifs, cesont des « partis de patronage » au sens de Max Weber, dans la mesureoù ils revendiquent le pouvoir pour leur chef et son état-major. Leur organisation est de type charismatique, et leurs méthodes se préoccupent peu de la légalité, et faisant usage de la violence et de l’intimidation deleurs adversaires politiques est néanmoins leur divergence la plus frappante. Le régimeitalien se mue en dictature charismatique, certes, mais en se reposant sur des administrations d’Etat de type bureaucratique, et en ne s’éloignant pas fondamentalement du modèle étatique occidental moderne.