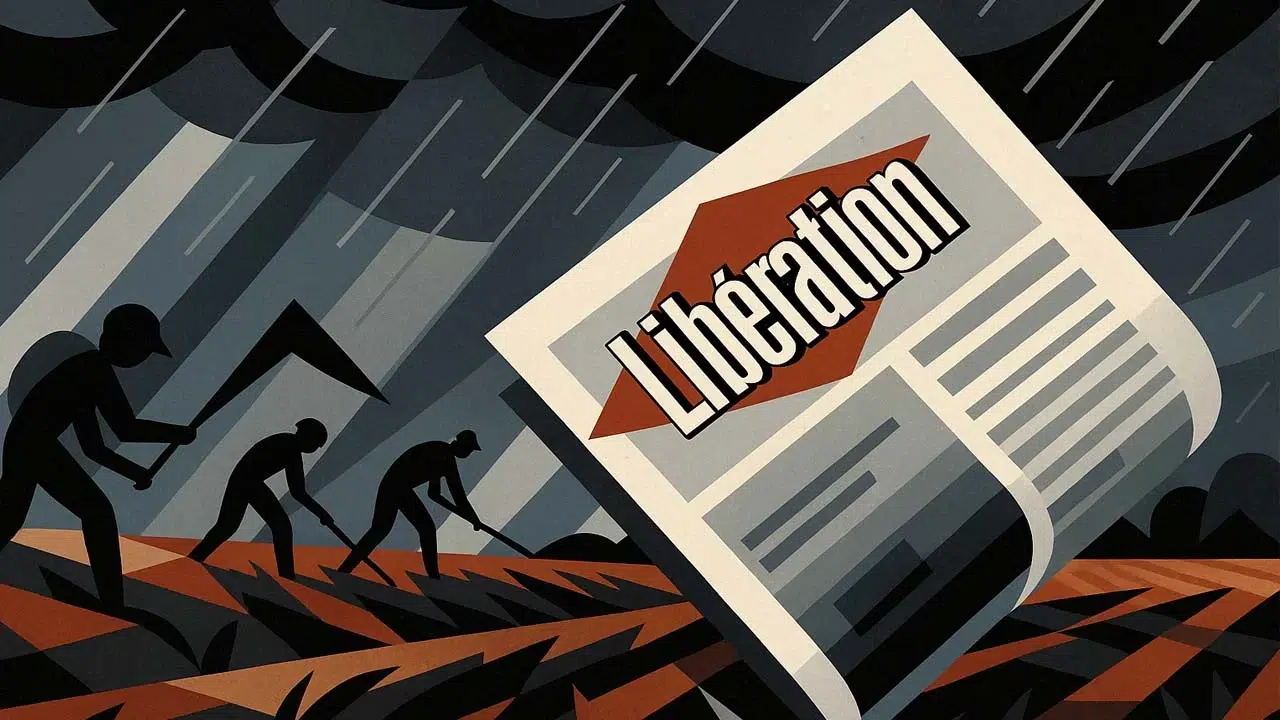
L’article que Libération consacre à un forum d’Afro-descendants organisé à Salvador de Bahia, en présence de Christiane Taubira, se présente comme une réflexion transatlantique sur les héritages de l’esclavage. Il n’est toutefois qu’un nouvel exemple de traitement mémoriel partiel et idéologisé, où l’histoire devient un matériau politique plutôt qu’un objet de connaissance. Ce texte, qui prétend éclairer, obscurcit. Il convoque des souffrances réelles, mais les enferme dans un récit volontairement amputé. Il présente l’esclavage comme une faute exclusivement européenne, et les Afro-descendants comme des victimes éternelles et « racisées », privées de responsabilité propre. Or les faits racontent tout autre chose.
Balbino Katz
La fabrique d’une identité victimaire : quand Libération invente les « populations racisées »
L’un des ressorts discursifs les plus marquants de l’article est la notion de « populations racisées ». Le terme, désormais courant dans certains milieux universitaires français, repose sur un glissement conceptuel majeur : il ne désigne plus une identité réelle, mais une identité attribuée. Selon cette logique, les Afro-descendants ne seraient plus des héritiers d’une histoire africaine, américaine ou caribéenne, mais des individus définis par le regard discriminant supposé d’autrui.
Ce renversement sémantique est fondamental : il fait passer l’individu de son propre héritage au regard de l’autre. L’identité devient un stigmate, non une continuité. L’individu ne se pense plus comme membre d’un peuple, d’une tradition ou d’une culture, mais comme le produit d’un système hostile. Cette manière de définir l’identité par la blessure et non par la transmission est au cœur des politiques mémorielles contemporaines. Elle déresponsabilise, désindividualise et installe durablement l’idée que l’identité profonde n’est pas ce que l’on est, mais ce dont on souffre.
Cette logique produit une vision binaire de l’histoire : d’un côté les dominés éternels, de l’autre les dominants permanents. Les Afro-descendants ne sont alors plus les héritiers d’empires africains, de résistances et de cultures, mais des victimes assignées à résidence morale. C’est ce que le sociologue américain Orlando Patterson appelait « la seconde servitude ». Cette identité diminuée, figée, tournée vers l’extérieur plutôt que vers soi, enferme les trajectoires individuelles dans une plainte infinie.
Pourtant, les Afro-descendants ont mille raisons d’assumer leur histoire avec fierté. Ils sont les héritiers de royaumes puissants tels que le Dahomey, le Kongo ou l’Ashanti, de penseurs remarquables comme Anton Wilhelm Amo ou Edward Blyden, et d’une créativité culturelle qui a traversé l’Atlantique en influençant le monde entier, de Haïti aux États-Unis, du Brésil aux Caraïbes. Réduire cette richesse à une identité de « racisés » revient à nier leur capacité d’agir et leur souveraineté mémorielle.
L’esclavage avant l’Europe : une pratique universelle que Libération efface
Le récit promu par l’article repose sur une culpabilité exclusivement européenne, comme si l’esclavage était une invention occidentale et la traite atlantique son seul théâtre. L’historiographie moderne contredit pourtant cette vision simpliste. Les travaux d’Olivier Pétré-Grenouilleau, Ralph Austen, Bernard Lewis, Paul Lovejoy ou Murray Gordon montrent que l’esclavage constitue un phénomène universel, ancien et multiforme. Trois grands systèmes esclavagistes, d’ampleur comparable, ont existé :
– la traite intra-africaine, enracinée dans les structures politiques traditionnelles ;
– la traite orientale ou arabo-musulmane, active du VIIᵉ au XXᵉ siècle ;
– la traite atlantique, plus récente.
La traite intra-africaine est la plus ancienne et plonge ses racines dans les mécanismes politiques de nombreux royaumes précoloniaux. La capture de prisonniers, leur mise en servitude et leur redistribution faisaient partie du fonctionnement ordinaire de ces systèmes. Quant à la traite orientale, elle fut la plus longue et l’une des plus brutales, avec castration systématique et absence de descendance. La servitude demeura un statut juridique légitime dans le droit islamique classique jusqu’au XXᵉ siècle.
La traite atlantique fut immense et tragique, mais ne fut pas inventée par les Européens : elle s’inscrivit dans des structures africaines déjà établies. Plus de 90 % des captifs étaient conquis et convoyés par des autorités africaines militarisées. Les Européens restaient sur les côtes ; les réseaux internes étaient africains. Cela n’efface pas la responsabilité européenne, mais rappelle qu’elle n’était ni exclusive ni originelle.
Le débat de Valladolid : quand l’Europe questionne sa propre domination
Le débat de Valladolid (1550-1551), organisé par Charles Quint, constitue un épisode unique de l’histoire intellectuelle mondiale. Pour la première fois, une puissance impériale interrogeait publiquement la légitimité morale de sa domination. Las Casas y défendit l’humanité pleine des Indiens ; Sepúlveda invoqua la « servitude naturelle » selon Aristote. Ce débat n’a eu aucun équivalent dans les autres civilisations. Il inaugura un mouvement d’autocritique qui conduisit, deux siècles plus tard, aux premières abolitions modernes.
Une Europe paradoxale : seule civilisation à abolir l’esclavage universellement
L’abolition fut le fruit de cette maturation intellectuelle. La Grande-Bretagne lança le premier mouvement abolitionniste structuré, puis interdit la traite en 1807 et l’esclavage en 1833. La Royal Navy consacra une partie de sa flotte à l’interception des navires négriers. La France suivit en 1848. À l’inverse, les abolitions dans le monde musulman furent tardives : jusqu’en 1981 en Mauritanie. Ces dates ne sont pas une question morale, mais un constat historique.
La loi Taubira : l’institutionnalisation d’une mémoire amputée
La loi Taubira (2001) reconnut la traite transatlantique comme « crime contre l’humanité », mais exclut totalement les traites africaines et orientales. Plusieurs historiens soulignèrent son caractère sélectif. Christiane Taubira expliqua qu’évoquer la traite arabo-musulmane risquait d’« offenser certains jeunes », avouant implicitement que l’objectif n’était pas la vérité historique globale, mais la réponse à une demande victimaire identitaire. Cette orientation transforma l’histoire en instrument politique et introduisit une mémoire officielle, partielle et donc fragile.
Pour une mémoire adulte, non infantilisante
L’esclavage exige une approche totale et non tronquée. Les Afro-descendants n’ont rien à gagner à une identité victimaire qui les prive de responsabilité et d’autonomie. Ils ont tout à revendiquer : la complexité de leurs parcours, la dignité de leurs ancêtres, la diversité de leurs héritages. La fierté libère ; la victimisation enferme. L’histoire ne progresse que par la franchise et l’absence d’angles morts. La vérité ne se divise pas : elle s’assume ou elle s’efface.
Balbino Katz 27/11/2025