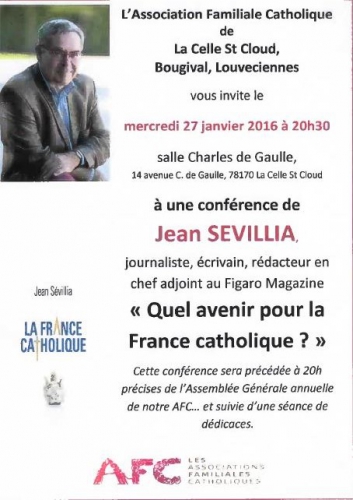29 professeurs d'histoire ont écrit une lettre à Robert Ménard, publiée dans Le Midi Libre le 15 janvier. Le maire de Béziers répond:
"Ainsi donc, ces enseignants du lycée Jean-Moulin m'accusent "d'instrumentaliser" et de "retricoter" l'Histoire dans un but "polémique". Sans qu'ils s'en rendent compte sans doute, ils révèlent ainsi la nature profonde de leur structure intellectuelle : le refus du débat, le refus de la confrontation des idées. Ils y ajoutent le procès en légitimité, propre à la pensée de gauche, qui exclut l'Autre à partir du moment où celui-ci ose penser l'Histoire différemment, ose envisager son enseignement autrement qu'il est pratiqué depuis mai 68. Quand ces enseignants écrivent, "nous sommes attachés à la rigueur de la démarche historique", on a envie de rire tant leur courrier témoigne presque à chaque ligne du contraire. Un courrier que l'on peut résumer en quelques points.
Premier point : la guerre d'Algérie. Ces enseignants me reprochent d'avoir débaptisé la rue du 19 mars 1962. Pour eux, c'est "rouvrir les plaies" et "réhabiliter l'OAS". On croirait lire un tract du Parti communiste ! Or, d'un point de vue historique, de quoi s'agit-il ? Peut-on dire que la guerre d'Algérie a pris fin avec la signature des accords d'Évian du 19 mars 1962 ? Oui, affirment ces enseignants. Oui, affirment les anciens porteurs de valises. Non, disait François Mitterrand. Non, pensent les milliers de familles dont les membres ont péri après le 19 mars. Il peut donc y avoir débat. Ce n'est pas une question de querelles de "mémoire". Ce débat, ces enseignants l'esquivent. Ils ne sont pas "attachés à la rigueur de la démarche historique", ils font de la politique.
Deuxième point : il m'est reproché un tweet dans lequel j'invitais à lire un numéro du Figaro Histoire "Quand les barbares envahissaient l'Empire romain". Selon ces enseignants, il s'agirait d'une allusion implicite aux migrants. En quelque sorte, on m'accuse d'une arrière-pensée. Procédé stalinien s'il en est ! Or, il s'agissait simplement d'attirer l'attention sur un numéro du Figaro Histoire. Mais peut-être est-il interdit de citer Le Figaro ?On est loin de "la rigueur de la démarche historique". Et plus près de la politique.
Troisième point : si j'en crois ces professeurs, je ne devrais plus évoquer les combattants de 14-18 dans mes discours. Il m'est reproché de m'être interrogé ainsi à leur sujet : que diraient-ils "en voyant certaines rues de nos communes où le Français doit baisser la tête ?" Au nom de quelle "démarche historique" ces enseignants prétendent m'interdire de faire un rapprochement entre 1914 et 2016 ? Oui, les Poilus biterrois de 14-18 qui sont morts pour la France, pour qu'elle ne soit pas allemande, que penseraient-ils de notre Béziers de 2016 ? Poser cette question n'est ni ridicule ni déplacé car elle s'adresse, au fond, non pas aux Poilus, mais à nous, à nos consciences. À quoi bon se gargariser de la gloire de nos ancêtres, si nous acceptons ce qu'ils ont refusé au prix de leur vie ? Ces enseignants de Jean Moulin peuvent ne pas être d'accord. Mais la querelle qu'ils me font n'est pas historique ou scientifique, elle est politique.
Quatrième point : il m'est reproché implicitement d'avoir installé une crèche en mairie. Pour ces professeurs, c'est mal car cela "ne s'inscrit pas dans la tradition laïque garante de cohésion sociale et protectrice des libertés". Quel laïus pour dire : nous ne sommes pas d'accord. Soit ! Mais la justice a tranché. La crèche dans la mairie ne viole pas la laïcité. Le christianisme est un élément culturel constituant de l'identité française. Il est possible que cela chagrine ces professeurs, il est possible qu'ils préfèrent n'en souffler mot dans leur enseignement sinon pour le minorer. Cependant, quand ils écrivent qu'ils sont attachés à leurs obligations de "réserve et de neutralité", ils se moquent du monde. Envoyer à la presse une lettre ouverte au maire de la ville et la signer explicitement en tant qu'enseignants du lycée Jean-Moulin, qu'est-ce sinon entrer dans le débat public, sinon faire de la politique, et donc violer le devoir de "réserve et de neutralité" dont ils se réclament ?
Cinquième point : Jean Moulin. Deux choses à ce sujet. D'abord, Jean Moulin, comme le général de Gaulle, a combattu avec des hommes venant de tous les horizons. Le secrétaire de Jean Moulin venait de l'Action française. Autour de De Gaulle, on retrouvait des gens venus de la droite la plus dure, qui feraient passer Marine Le Pen pour une centriste. Pour eux, seules comptaient la libération de la France, sa souveraineté. Jean Moulin n'était pas le "visage de la France républicaine", comme l'écrivent les enseignants, il était le visage de la France. Il n'est pas mort pour un concept politique, il est mort pour une réalité charnelle, pour un peuple. En 1940, les nationalistes français ont répondu présents en masse à Londres alors qu'une partie de la gauche a voté les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Alors à qui appartient Jean Moulin ? D'abord et avant tout à l'histoire de France. Il est le symbole d'un Français qui meurt pour que son pays ne soit pas occupé par une armée étrangère. À qui ne peut pas appartenir Jean Moulin ? À ceux qui vendent notre pays, à ceux qui le pillent. Comme à ceux qui trouvent des excuses aux pillards et aux vendus. L'autre point important sur Jean Moulin est plus factuel. La Ville va créer un musée historique qui lui sera entièrement consacré. Alors que son appartement natal était dans un état déplorable, il va être restauré. Et quel est le premier mouvement de ces enseignants de Jean Moulin ? Se réjouir ? Non ! C'est de faire un procès moral, un procès historique, un procès politique à la mairie ! Pour conclure, je crois que ces enseignants de Jean-Moulin auraient mieux fait de ne pas signer ce texte, rédigé par un ou deux d'entre eux. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré son caractère politique. Pour ma part, je forme le vœu qu'ils transmettent à leurs élèves l'amour de la France, une France qui n'a commencé ni en 1968, ni en 1789.Qu'ils forment des citoyens, des citoyens fiers de leur pays, fiers de leur identité."