culture et histoire - Page 1244
-
Regard catholique : le rexisme et son chef Léon Degrelle - Alain Escada
-
Avez-vous lu le n°1 des Cahiers d'Histoire du nationalisme ? (rexisme)
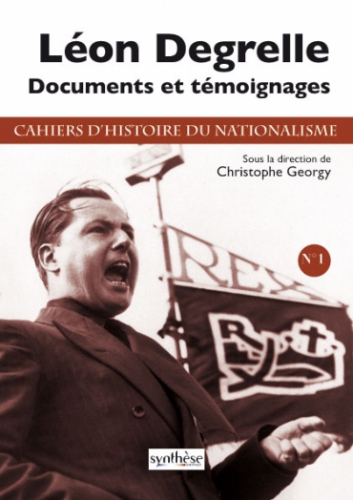
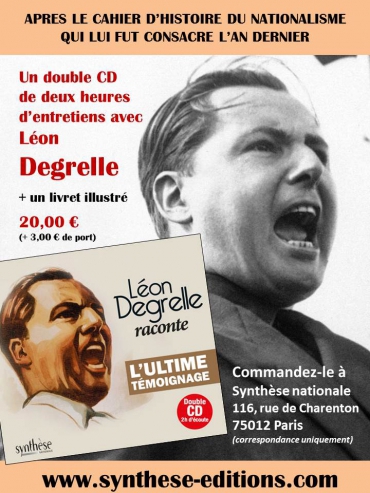
-
Les invasions barbares - Bruno Dumézil
-
L’enseignement de l’histoire est nécessaire pour l’orientation
L’abandon programmé de l’histoire
par Carl Bossard*
Ex: http://www.horizons-et-debats.ch
Pour les réformateurs scolaires, l’«histoire» en tant que matière indépendante est superflue. Dans le meilleur des cas, cette tendance restera une note de bas de page… de l’histoire. Remarques concernant un fourvoiement.
Quiconque travaille avec des jeunes gens connaît leur intérêt historique et leur fascination pour les époques et les cultures. Il connaît leur désir de comprendre leur propre univers et les univers étrangers. Mais leurs connaissances factuelles et celles des relations d’interdépendances entre les faits sont minimes. Détourner les yeux n’est pas une solution; l’école doit faire contrepoids. Mais elle préfère supprimer l’histoire en tant que matière indépendante.Tout appartient au présent
«Actuellement, les jeunes gens vivent de manière interconnectée, dans l’horizontale», déclare l’écrivain zougois Thomas Hürlimann. Et d’ajouter: «Ils sont simultanément à Tokyo, à New York et à Berlin; mais la dimension historique n’est pour eux qu’une page de Wikipédia.» Tout appartient au présent.
Tout ce qu’on ne peut pas se représenter n’existe pas, pourrait-on en conclure. Voici encore une citation de Hürlimann: «Ma génération, au contraire, a grandi dans la verticale: au début, il y eut l’ancien testament, puis Rome, puis l’histoire de l’ancienne Suisse. Les gens se comprenaient comme une prolongation de ce qui fut autrefois.»1
Là, Thomas Hürlimann a raison: les dates et les faits restent dans l’horizontale.Les connaissances ne naissent pas incidemment
Elles sont les signatures du présent. Les connaissances et la formation contiennent une verticalité. L’école est donc confrontée à d’importantes tâches. On peut certes distiller des informations utiles des données amassées (cf. «Big Data»), mais elles sont uniquement complémentaires. Elles ne génèrent guère des connaissances. Les connaissances ne naissent pas incidemment. Elles sont le résultat du travail et non l’effet accidentel du fait d’essuyer et de trouver. Apprendre et comprendre, c’est ce que chaque élève doit faire personnellement.
C’est astreignant. Il faut un enseignement stimulant, un discours basé sur le dialogue et des enseignants très présents. Ce qui importe, ce sont des enseignants exigeant et confrontant leurs élèves à des structures dont les jeunes ne feraient jamais connaissance dans leur propre monde du présent. Donc, un enseignement représentant une force opposante, rempli de courage d’aller à contre-courant. L’horizontale a besoin de la verticale.Enseigner de réels contenus sans date d’échéance
L’école, dans sa mission de conduire les enfants dans le développement de leurs facultés d’apprentissage, est plus importante que jamais. Et c’est pourquoi les plans d’études doivent se concentrer sur les contenus et les connaissances formelles de base permettant de rester durablement capable d’apprendre – et non sur les actualités: de réels contenus sans date d’échéance. Dans une société basée sur les services et la communication, il faut avoir, dans sa langue maternelle, des connaissances linguistiques orales et écrites bien développées. Il est de grande importance d’avoir aussi des capacités élémentaires en mathématiques et en sciences naturelles; une condition absolue est également la qualification en langues étrangères.
Un autre élément important de formation est de connaître sa propre histoire pour être capable de relier l’origine et l’avenir. Dans notre civilisation moderne, nous avons besoin du sens historique – plus que jamais. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons entrer en relation avec l’étrangeté qui se rapproche de nous et l’étrangeté de notre propre passé, dont nous nous éloignons rapidement, suite au continuel progrès. Une telle attitude permet de coopérer et d’affronter l’avenir positivement. La pensée historique en est la base.L’histoire doit être présente en tant qu’histoire
Mais les écoles suisses ont supprimé l’histoire en tant que matière indépendante. L’histoire erre comme un essaim nébuleux dans le domaine disciplinaire «Sciences de l’Homme et de la société» sous forme de pièces détachées incohérentes: un peu de Lacustres, un peu de Romains, une dose de chevalerie. Aucune vue d’ensemble, aucune connaissance liant les différents aspects, aucune structure, pas même au niveau temporel. L’histoire a été systématiquement dévaluée.
Aucun nombre d’heures garanti. Guère de contrôles. Le Plan d’études 21 n’y corrige rien, tout au contraire. Il efface l’histoire même au collège. La matière devient une partie du domaine disciplinaire «Espaces, époques, sociétés» – avec la géographie. Y sont définies douze exigences principales. L’histoire n’y apparaît plus qu’en fragments dispersés. Leur valeur n’est pas définie. Ce sont les enseignants qui décident de leur importance. Ces constructions individuelles ne donnent aucune nouvelle valeur à la matière «Histoire».Espaces, époques, sociétés
Aussitôt qu’une discipline disparaît en tant que domaine indépendant, le contenu disparaît également. Dans les têtes des enfants, cela va de soi: «Si l’histoire ne se manifeste pas en tant qu’histoire, elle n’est pas présente dans leurs têtes», précise une didacticienne d’histoire. «La notion ‹Histoire› indique de manière programmatique le contenu principal de la science de l’histoire, son maniement de la temporalité, sa manière de la réflexion et l’analyse du passé», critique l’historien Lucas Burkart.2 Dans un domaine disciplinaire «Espaces, époques, sociétés», cela se perd, ajoute-t-il. L’histoire enseigne de faire des liens dans le sens de la largeur, mais aussi entre le passé et le présent.
François E. Weinert, psychologue du développement renommé et vice-président de la Société Max-Planck, a déjà mis en garde contre de telles matières groupées: «Les matières en tant que systèmes de connaissance pour l’apprentissage cognitif sont irremplaçables. Il n’y a aucune raison de créer un pêle-mêle hétérogène des matières.» La seule exception étant l’enseignement par projets; là, des phénomènes réels ou des problèmes de notre monde forment le point de départ.Une boussole dans un monde complexe
La dynamique civilisationnelle est effrénée. Mais le regard en avant a besoin du rétroviseur. Plus la société change rapidement, plus la connaissance de sa propre histoire est importante – et la conscience: «Nous venons de là.» Si nous perdons cette dimension, nous perdons la verticale. Si nous nous plaçons uniquement dans l’horizontale et ne nous rapportons qu’au présent, nous perdons nos liens avec l’histoire et donc l’orientation – et sans orientation, il n’y a pas de valeur fondamentale de cohésion possible, et pas d’idée de la raison d’être de la Suisse. L’école permet un regard en arrière; mais ce regard est toujours aussi dirigé en avant. L’avenir a besoin de connaître les origines, pour rappeler l’expression souvent citée d’Odo Marquard.
C’est pourquoi l’histoire est si importante. Elle raconte des histoires captivantes. Les gens ont besoin des bonnes histoires. Elles éveillent l’intérêt. Elles mènent vers des événements, telles la Révolution française de 1789 et la Révolution helvétique de 1798 ou vers la création de l’Etat fédéral en 1848. Non pas comme des événements isolés, comme un ensemble sans contexte, comme un voisinage sans nom. Ce ne sont pas de simples dates ou de simples faits, appris par cœur et reproduit mécaniquement. Non. Chaque événement est relié au présent dans un large cadre.
Cela peut être démontré, par exemple, avec l’époque de 1798 à 1848 – l’une des époques les plus passionnantes de l’histoire suisse. Aussi pour les adolescents. C’était la lutte pour la modernisation de la Suisse et de son essor vers l’avenir, le conflit entre l’Etat unitaire et la fédération d’Etats, le conflit entre le centralisme napoléonien français – symbolisé par la pomme – et l’ancien particularisme helvétique – symbolisé par la grappe de raisins. La lutte pendant 50 ans entre la pomme et la grappe fut intensive. Il y eut la guerre; le sang coula. La Suisse en fut presque dissolue. L’Etat fédéral de 1848 amena le compromis – symbolisé par l’orange: un pays varié avec des Etats membres aussi autonomes que possible – grâce à une structure étatique fédérale.
La parallèle avec le présent est évidente – et voilà donc le postulat de l’historien suisse Herbert Lüthy: «Toute l’histoire est histoire du présent parce que le passé en tant que passé ne peut pas être vécu, mais seulement en tant que passé dans le présent.»Les liens sont la clé vers le monde de l’avenir
C’est uniquement quand nous reconnaissons les choses dans leur contexte, que les mondes historiques apparaissent. La compréhension des liens historiques développe la sensibilité pour les dimensions temporelles et les processus de développement, concernant ce qui a changé et ce qui est actuel. Les liens sont alors la clé vers le monde de l’avenir. Ce n’est pas un hasard si le philosophe Hans Blumenberg qualifia, il y plusieurs années, la formation non pas d’un «arsenal», mais d’un «horizon». Ce n’est pas un assemblement de dates et de faits, mais un moyen de s’orienter. L’enseignement permet de s’orienter dans les mondes intellectuels et historiques.
Cela ne vient pas tout seul. Chaque compréhension importante – aussi historique – doit être élaborée mentalement. Dans la verticale. Aucune machine à données ne pourra nous épargner cela, dans l’avenir non plus. Et la matière scolaire «Histoire» est une espèce d’assurance de base. Le Land de Hesse, très progressif, avait supprimé cette matière et entre-temps l’a réintroduite – après que l’actualité leur ait fourni les preuves qu’ils étaient dans l’erreur.* Carl Bossard a été directeur du gymnase/lycée Alpenquai de Lucerne et recteur-fondateur de la Haute Ecole pédagogique de Zoug.
Source: www.journal21.ch/geschichtsvergessenheit-als-programm
1 Alexandra Kedves. Thomas Hürlimanns Kirschgarten. In: Tages-Anzeiger du 5/6/15, p. 25
2 Lucas Burkart. Jugendliche sollten eine Faszination für andere Zeiten entwickeln. In: Neue Zürcher Zeitung du 18/3/12 -
La Corée du Nord au-delà des clichés par Georges FELTIN-TRACOL
Le 6 janvier 2016, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) procéda à l’explosion souterraine de sa première bombe H thermonucléaire. Si l’essai a bien été confirmé, les experts occidentaux estiment que vue sa basse intensité, ce ne serait finalement qu’une banale bombe A. Il n’empêche que fidèles à leurs grossières manières de bandit de grand chemin, les États-Unis ont cherché une nouvelle fois à insulter Pyongyang qualifié d’« État-voyou » alors que les modèles de cette funeste catégorie s’appellent, outre les USA, la Grande-Bretagne, l’Allemagne fédérale, l’OTAN, l’Arabie Saoudite, la Qatar, leur maîtresse, la République hexagonale, la Turquie et Israël. Ce dernier possède même plus d’une centaine d’ogives nucléaires, mais ne subit jamais une seule condamnation de la minable « Communauté internationale ». Tel-Aviv est parfaitement intégré dans le mondialisme réticulaire global tandis que la RPDC ne souhaite pas s’y rallier. Cette démonstration nucléaire pose la souveraineté politique, nationale et populaire, du seul vrai État en Corée, ce que tous les souverainistes de la planète devraient se féliciter.
La Corée du Nord n’est guère connue en France. C’est la raison pour laquelle l’essai de Denis Gorteau est plus que bienvenu. En de courts chapitres didactiques, il tente à la fois de mieux cerner et de faire découvrir ce que les médiats institutionnels appellent avec un mépris certain le « Royaume-ermite ». Le propos, s’il est pertinent – quoique un peu sommaire – , se situe fréquemment à contre-courant. En effet, l’auteur pense que la Corée du Nord pourrait devenir une nouvelle puissance économique. Cela n’a pas échappé aux organisateurs du 46e Forum économique mondial de Davos qui aurait accueilli une délégation nord-coréenne conduite par l’ancien ambassadeur en Suisse, Ri Su-yong, et actuel ministre des Affaires étrangères. Cela aurait été une première depuis dix-huit ans si, après le nouvel essai, Davos n’avait pas retiré son invitation… La maîtrise conjointe du nucléaire et du spatial (la RPDC place en orbite des satellites depuis sa propre base de lancement) représente un atout stratégique majeur.
L’héritage de la présence japonaise
Plutôt que vouloir vitrifier sa voisine et sœur ennemie du Sud, la Corée du Nord souhaite d’aborddissuader son voisinage d’une quelconque ingérence dans ses affaires intérieures. La géographie la met au centre de plusieurs aires d’influence concurrentes : la Chine, la Russie, le Japon et les États-Unis. Dans son histoire, « les voisins du Nord et de l’Est servent généralement d’envahisseurs tandis que la Chine joue le rôle de protecteur et de tuteur à la fois militaire et culturel (p. 11) ». Or, les traités inégaux du XIXe siècle font perdre ce rôle à l’Empire du Milieu au profit du Japon qui annexe la péninsule en 1910. « Avant cet épilogue au bénéfice du Japon le débat d’idée était vif en Corée, tout le monde voulait des changements mais il n’y avait pas de consensus sur les moyens de se moderniser : on hésite entre la tutelle chinoise, l’Occident et le Japon. En tout cas l’indépendance coréenne devient précaire eu égard au retard du pays (p. 18). » L’occupation japonaise n’est pas entièrement négative. « L’intégration à l’économie japonaise a changé la Corée : les villes se développent et se modernisent suite aux destructions. […] Le Japon industrialise le pays à son profit : les grandes firmes nippones installent leurs hommes autour des gouverneurs. Une foule de petites entreprises émerge à l’ombre des occupants, elles serviront de base aux multinationales actuelles… (pp. 18 – 19) » : les fameux chaebol (conglomérats industriels et commerciaux d’origine familiale) – tels Hyundai ou Samsung – structurent l’économie de la Corée du Sud.
Ce dilemme se retrouve parmi les militants communistes prêts à la libération nationale. Quand est fondé le Parti du travail de Corée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’appareil communiste se divise en quatre tendances : les militants restés en Corée et souvent emprisonnés par les Japonais, les réfugiés en Chine, les exilés en URSS et les partisans entrés en guérilla en compagnie de Kim Il-sung. Fils d’un militant indépendantiste, Kim Il-sung rejoint une résistance modeste vers 1932. Pragmatique, il louvoie entre les différentes instances chinoises et soviétiques avant de créer et de diriger à partir de 1948 la RPDC. Il se distingue bientôt par une voie originale, nationale-communiste, tout en conservant une stricte équidistance, une quasi-neutralité, entre Pékin et Moscou. « Si Kim Il-sung partage les critiques de Mao à l’encontre de l’URSS “ révisionniste ”, il se garde de donner des prétextes à Moscou pour intervenir (pp. 23 – 24). »
L’abandon du communisme
C’est dans un contexte géopolitique complexe (hostilité de l’Occident atlantiste et guerre froide entre la Chine et l’Union Soviétique) que Kim Il-sung développe la doctrine très pertinente du juche. C’est un fait méconnu : « Dès après 1955 l’idéologie de la Corée du Nord va lentement évoluer vers autre chose qu’un communisme orthodoxe porté par Staline et le bloc de l’Est. Se considérant comme un pays du tiers-monde concerné par les problèmes d’indépendance nationale, la RPDC et plus encore son maître incontesté Kim Il-sung vont développer une idéologie composite entre le communisme et le nationalisme : le juche. Un terme coréen difficilement traduisible qui mêle les notions d’indépendance, de souveraineté et de liberté créatrice (p. 45) ». De là, l’effacement des références communistes, voire marxistes-léninistes, au profit de valeurs nationalistes et identitaires. Sait-on ainsi que « la constitution de 1972 [qui] remplace celle de 1948 […] n’était pas une constitution communiste : les pouvoirs y étaient séparés et la référence au socialisme très indirecte (p. 24) » ? Mieux, « le juche remplace même explicitement le marxisme-léninisme comme idéologie de l’État (p. 46) » tandis que le gendérisme, le bankstérisme et le métissage multiracial constituent toujours la clef de voûte du Système laïcard dans l’Hexagone… Certes, « à la lettre le juche se présente comme une suite du marxisme, un post-socialisme adapté à la réalité de la nation coréenne encore partiellement dominée (au Sud) et cerné de grandes puissances (p. 46) ».
La Corée du Nord paraît développer un caractère spécifique, national-révolutionnaire soldatique, digne duTravailleur et de la Mobilisation totale chers à Ernst Jünger. En effet, « les livres nord-coréens traitant dujuche ont une forme philosophique : l’Homme y est présenté comme pouvant tout. Par “ Homme ” il faut comprendre les masses ou la nation. La patrie (et non plus vraiment les classes exploitées) doit être guidé par un Parti et le chef de celui-ci. C’est sans doute le sens des gigantesques rassemblements entraînés pour animer d’immenses fresques vivantes (p. 46) ». Prométhée, ou Faust, séjournaient dorénavant à Pyongyang… À moins que cela soit Hegel qui œuvrait en faveur d’« une monarchie constitutionnelle, fortement centralisée dans son administration, largement décentralisée en ce qui concerne les intérêts économiques, avec un corps de fonctionnaires de métier, sans religion d’État, absolument souverain, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur (E. Weil, Hegel et l’État. Cinq conférences, Vrin, coll. « Problèmes et controverses », Paris, 1950, p. 56) ».
Un État vraiment souverain
Si l’objectif principal demeure la réunification de la péninsule et le départ définitif de l’occupant bellicisteyankee, d’où l’existence sous la direction du Parti du travail de Corée d’un Front démocratique pour la réunification de la patrie incluant le Parti social-démocrate de Corée et le Parti Chondogyo-Chong-u (une formation nationale-religieuse chondoïste, un culte révolutionnaire paysan apparu à la fin du XIXe siècle sur un syncrétisme animiste, bouddhiste, taoïste et chrétien), la RPDC « semble peu favorable aux échanges. La monnaie nationale, le won, n’est pas convertible et le pays refuse tout échange en dollar, la monnaie de “ l’ennemi ” étatsunien (pp. 83 – 84) ». Authentique société fermée qui applique les règles de l’autarcie ou, au moins de l’auto-suffisance, la Corée du Nord par son refus du billet vert, s’exonère de toute tutelle terroriste – bancaire US. On conçoit mieux ensuite la folle détermination de Washington la ploutocratique de réduire cet « empêcheur de tourner en rond ». « Néanmoins, cette fermeture est à relativiser (p. 84) ». « Bien des Nord-Coréens font des aller-retours avec l’étranger soit de façon légale, soit de façon para-légale (p. 83) », car l’État réglemente les déplacements de population et limite les migrations.
Grâce à Denis Gorteau, on va au-delà des clichés et des interprétations fictives, biaisées et mensongères diffusés par des médiats occidentalistes, grands pourvoyeurs de désinformation chronique. Par son idiosyncrasie, la RPDC s’inscrit pleinement dans « le passé de la Corée [qui] confirme cette tendance à la personnalisation du pouvoir sur fond de défense de la nation (p. 50) ». Ne pas prendre en compte son indubitable particularisme serait la preuve flagrante d’une incommensurable sottise occidentale.
Georges Feltin-Tracol
• Denis Gorteau, Corée du Nord, le pays qui n’était pas là, Alexipharmaque, coll. « Les Réflexives », 2015, 126 p., 15 €, à commander à BP 60359, F – 64141 Billère CEDEX ou à <alexipharmaque@alexipharmaque.eu>.
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire -
Passé Présent n°86 - Léopold III de Belgique, roi controversé
-
Conférence Dextra Vendredi 29 janvier : « La rue, état des lieux » avec Claude Huet
Ce vendredi 29 janvier, nous recevronsClaude Huet,ancien SDF devenu écrivains, qui nous parlera de la vie dans la rue, et de son état actuel.Au terme de la conférence,il sera possible d'acheter plusieurs de ses ouvrages édités parles éditions du Rubicon,et de les faire dédicacer.Nous vous attendons nombreux pour cette conférence,avec un homme atypique et courageux.Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, social 0 commentaire -
Spectre 007 - Orages d'acier - 24/01/16
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, lobby, magouille et compagnie 0 commentaire -
Le sens de l’existence
Ce sens est défini par les quatre mots-clés qui sont : les racines, la mission, la tenue et l’exploit.
Hayek montre bien que nous n’avons créé ni notre langage, ni notre raison, ni note civilisation. Comment un individu pourrait-il créer ce qui le précède ? Nous avons donc, que cela plaise ou non, un héritage qui est constitutif de notre être. Sans cet héritage, comme on l’a vu avec les « enfants sauvages » perdus en forêt et élevés par des animaux, notre personnalité et notre raison même seraient inexistantes.
On peut considérer que puisque nous avons un héritage, nous devons en remercier nos ancêtres et notre nation et ne pas être ingrats. Qui dit héritage dit histoire et l’homme pleinement homme a une « conscience historique » à l’inverse de l’animal.
Les racines de l’existence, la fidélité.
Qui dit héritage et histoire dit donc « fidélité ». Les mots « foi » et « fidélité » ont une commune origine. Un homme « sans foi ni loi » est un homme à qui l’on ne peut pas faire confiance. Du point de vue éthique, la fidélité est donc une vertu fondatrice
Mais il y a plus, car les traditions qui constituent notre héritage contiennent un savoir, une sagesse énorme sélectionnée par des siècles de pratique de millions d’hommes. Se priver de cet héritage en voulant faire table rase (Tabula rasa) est donc un acte absurde et suicidaire. La sagesse des traditions est plus grande que celle de l’individu limité dans le temps et dans ses capacités rationnelles individuelles. L’orgueil individuel est donc stupidité. Les tentatives de tout refaire à nouveaux frais et d’éradiquer les traditions s’appellent historiquement des « révolutions ». Les révolutions permettent à la barbarie présente dans le cerveau primitif de l’homme de réapparaitre. C’est pourquoi elles mènent au sang et aux meurtres. L’homme a toujours le choix entre sauvagerie, barbarie et civilisation et la tâche de préserver et d’accroitre la civilisation n’est pas une tâche anodine, elle est vitale. Le rejet des traditions est en effet mortel, mort lente ou rapide selon les cas.
Ce qui fait la différence entre l’animal et l’homme, ce sont donc les traditions, elles-mêmes évolutives par petites touches à travers les événements historiques. Au mot racine, on peut donc associer le mot FIDELITE, condition même de la pérennité de la vie et de l’apparition de l’existence comme mode de vie spécifiquement humain.
La mission de l’existence, la liberté
Comme tous les philosophes existentiels l’ont compris de Pascal à Kierkegaard, de Nietzsche à Heidegger, l’homme peut mener une vie sans existence authentique et se laisser balloter de plaisirs fugaces en plaisirs fugaces. Il peut aussi refuser cette vie limitée au « divertissement » (Pascal) et mener une existence éthique (Kierkegaard). Il peut, comme l’écrit Heidegger, être simplement jeté dans le monde (il l’est toujours d’ailleurs au départ) ou « missionné ». C’est la conscience et le sentiment d’avoir une mission à réaliser sur terre qui distingue le plus l’homme de l’animal. Pour choisir cette mission, l’homme peut tenir compte ou non de ses racines, voire les rejeter au prix d’une énorme perte d’information. C’est en cela que l’homme est doué de LIBERTE.
Mais la liberté conduit, comme l’a écrit le tragédien grec Sophocle, sur le chemin du bien comme sur le chemin du mal. On peut choisir une mission de rebelle (Al Capone) ou de révolutionnaire (Pol Pot, Fouquier-Tinville). On peut aussi choisir une mission humanitaire et croire naïvement que le bien nait seulement du bien à l’encontre d’Héraclite qui proclamait l’unité des contraires. La réalité est que la paix créé la guerre et que la guerre créé la paix. C’est pour cela que le Christ dans Sa sagesse affirme ce qui peut paraitre scandaleux : « Je suis venu apporter non la paix mais l’épée ». On peut enfin estimer que la mission est de faire fructifier l’héritage de sa civilisation au lieu de la renier et s’engager sur la voie du dépassement de soi-même vers le bien, par des actes créateurs, où l’homme devient « co-créateur » du monde (Nicolas Bediaeff). Le fait d’avoir une mission donne du sens à l’existence et la rend plus belle, ce qui n’exclue pas le tragique. Elle permet de s’élever sur le chemin qui va de la bête vers le héros. L’existence peut être comme disait De Gaulle : « sans caractère, morne tâche d’esclave, avec lui, jeu divin du héros ! »
La tenue, l’honneur
La mission, qui est liberté, vous contraint à la tenue, qui est devoir et discipline. La tenue est ce qui vous empêche de déchoir. Elle est associée au sens de L’HONNEUR. Le héros qui a le choix entre se planquer ou affronter un ennemi supérieur en nombre, a de la tenue, il est honorable. C’est pourquoi la condition militaire a toujours été honorée dans l’histoire. Il fallait autrefois faire le métier des armes pour pouvoir être anobli. Le proverbe « noblesse oblige » exprime ce sens de l’honneur. La noblesse ne mendie pas des « droits » mais revendique au contraire des devoirs. Elle permet ainsi à l’homme de sortir de lui-même, de cet égocentrisme de petit enfant car à l’intérieur de l’homme privé de lumière extérieure, il n’a que de la boue, comme l’a justement écrit feu le philosophe Jean-François Mattéi (si l’on entend par « boue » les pulsions incontrôlée du cerveau reptilien).
Nietzsche a écrit : « l’homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme » où le surhomme selon lui, devait remplacer Dieu, qu’il croyait mort dans la conscience des hommes. En effet, sans l’idéal apporté par la « mission », la tenue disparait et l’homme régresse vers l’animalité ou vers la barbarie. Mais il est difficile à l’individu isolé, très faible qu’on le veuille ou non, de tenir son poste et sa mission, et de conserver la tenue, sans institutions extérieures pour le pousser à s’élever. L’homme a besoin de traditions, et dans ces traditions, il y a les institutions. C’est pourquoi, lorsque un peuple est vaincu, le vainqueur retire souvent au vaincu ses institutions et traditions propres. Il lui brise ainsi les reins.
L’exploit, l’excellence
Pourvu d’une mission, marque de liberté, et d’une tenue, donc du sens de l’honneur, la personne est appelée à accomplir des exploits. Cela peut être des actes héroïques mais cela peut aussi être des actes créateurs (les symphonies de Beethoven). Les actes en question sont aussi des actes d’amour : l’amour créé du nouveau, des êtres ou des œuvres. Sans amour, l’homme est condamné à la stérilité, dans tous les sens du terme, stérilité biologique ou stérilité culturelle. Pour qu’il y ait exploit, il est nécessaire de rechercher l’excellence, vertu majeure des anciens Grecs. Tout se tient : pas d’excellence sans tenue, capacité de se dépasser. Pas d’excellence sans une mission inspiratrice. Pas d’excellence sans puiser dans l’héritage immense des racines, des traditions. Racines, mission, tenue et exploits forment le quadriparti de l’existence. L’existence est plus que la vie.
Ivan Blot, 23/01/2016
-
Anthropologie politique. Une société anti-humaine. Promouvoir une famille humaine
Puisque la famille, premier repère naturel et premier besoin social de tout homme, est en pleine désagrégation, au risque d'engendrer la perte des libertés les plus élémentaires de la personne humaine, il convient de réfléchir aux méthodes les plus drastiques pour la redresser et la consolider.
Les maux invoqués étaient l'hyper-contractualisation de l'institution familiale, qui en fragilisait l'unité, par la reconnaissance de tous les types possibles d'unions autres que le mariage légitime entre un homme et une femme, et les possibilités ouvertes de divorces. En outre, le régime actuel des successions, pensons-nous, accroît cette fragilisation, amoindrissant le sentiment de transmission inter-générationnelle, en détruisant les patrimoines familiaux fonciers qui doivent être très souvent vendus pour acquitter les droits et réaliser les partages.
Sur le premier point, celui des autres formes d'union et les divorces, il est apparu que cette situation est née d'excès moraux passés et présents. L'usage excessif de la raison au détriment de la passion dans les siècles passés a rendu l'institution matrimoniale invivable et étouffante à la plupart des hommes européens qui souffrit de mariages d'intérêt où l'amour avait peu à voir. Il s'agissait de marier les propriétés plus que les hommes, de marier dans la région avec un parent, ou au contraire d'éviter de marier avec un parent pour des raisons canoniques, ou encore il convenait de caser au plus vite la fille de la famille sans lui demander son avis, etc. Autant de raisons très différentes, qui s'inséraient dans des stratégiques familiales et qui ne sont pas mauvaises, à condition qu'elles respectent l'inclination amoureuse des futurs époux, ce qui n'était pas le cas. A cet excès en répondit un autre, celui du tout passionnel, né du romantisme du XIXe siècle et parvenu en plein éclat depuis la fin de la seconde guerre mondiale et notamment après les événements de mai 1968. Ce tout passionnel considère qu'il est prioritaire de se plaire ou de s'aimer follement au détriment de toute raison. En réalité, on est dans le sentiment amoureux, passager, et non pas dans l'acte volontaire d'amour. Ces deux déséquilibres ont attaqué les institutions familiales chacun à leur manière et involontairement, puisqu'ils pensaient toujours en être la meilleure expression.
La première réponse à trouver doit donc être morale.
D'une part, les jeunes gens doivent être éduqués, dans le cadre familial, associatif et scolaire, à une saine gestion de leurs sentiments. C'est-à-dire qu'au lieu de succomber à la passion amoureuse et de rouler de flirt en flirt à la recherche d'une impossible jouissance parfaite et permanente de l'esprit et des sens, les jeunes gens doivent apprendre à se maîtriser pour rechercher le plus grand bien. Dans l'ordre de la vie sentimentale, il s'agit du bien qui épanouira de la manière la plus durable, c'est-à-dire dans l'acte volontaire d'amour et non la passion passagère. Cela implique de maîtriser sa sexualité, d'éduquer son regard et de n'imaginer qu'une relation amoureuse durable, à laquelle seule contribue vraiment l'institution du mariage, tuteur de croissance et cadre protecteur. Pour le jeune homme, comme pour la jeune femme, cela exige de comprendre le fonctionnement des sentiments et du corps de son sexe et du sexe opposé, mais également d'en percevoir la très haute valeur. Pourquoi très haute ? Parce qu'il s'agit de l'esprit et du corps de la moitié de l'humanité, et que dans le cadre de la relation avec l'autre moitié naît une complémentarité qui est la seule capable de bâtir une société humaine équilibrée et de générer l'avenir par l'enfantement.
L'autre apport moral nécessaire est dans l'éducation au mariage. En effet, l'éducation sentimentale et sexuelle ne suffit pas, même si elle donne un cadre général encourageant. Il est justement général, alors que le mariage est une institution spécifique. Il convient donc de s'y préparer spécifiquement. Traditionnellement, les deux amants avancent vers le mariage par un temps de fiançailles, où ils se rapprochent, apprennent à se mieux connaître, à connaître leurs familles respectives et préparent leur future vie commune. Ce temps, sous des formes différentes et parfois avec d'autres noms, a su être conservé jusqu'aujourd'hui y compris dans le cas de mariages uniquement civils et même lorsqu'il y avait déjà concubinage dans le passé. C'est un temps à part. Il semble qu'il est donc le plus adéquat pour réaliser une formation exigeante présentant aux fiancés la nature du mariage, de l'institution familiale qui en découle, son exigence et ses principes. On ne peut se marier à la légère, considérant que cette institution pose le point de départ d'une structure naturelle de la société qui dure même après les séparations. En effet, la famille que vous avez constitué et qui a donné naissance à un enfant, même après un divorce, continue de vivre par cet enfant qui est le seul porteur au monde de vos deux génomes intégraux organisés dans son corps selon un séquençage qui lui est propre.
C'est pourquoi la préparation au mariage devrait être un passage obligatoire avant toute union, qu'elle soit religieuse ou civile, et même avant d'autres formes d'union comme le PACS.
Les changements moraux qui résulteraient de l'application consciencieuse de ces deux réformes d'éducation générale sont incalculables parce qu'il s'agit d'une démarche inédite. Mais l'on peut raisonnablement penser qu'en rendant sa dignité à l'amour durable et familial dans les cœurs et les esprits, en plaçant les personnes face à leurs responsabilités, on contribuerait à combattre les divorces et les unions autres que le mariage légitime, en montrant les graves limites de ces contre-institutions. Ce n'est qu'une fois cette première lutte engagée que les gouvernants ou des membres de la société civile seraient légitimes pour supprimer sans blessures sociales majeures ces contre-institutions et ainsi redonner son caractère permanent et unique à la famille issue du mariage légitime.
Sur le plan inter-générationnel, essentiel au bon fonctionnement de la famille, qui est largement une relation entre enfants, parents et grands-parents, mais aussi souvent cousins, oncles ou tantes, la question patrimoniale est presque aussi essentielle que celle des formes d'unions légitimes. L'enracinement territorial est une donnée capitale pour la constitution d'une identité familiale. Celle-ci, à condition qu'elle n'étouffe pas les sentiments individuels, contribue à créer des personnalités libres et affirmées car fortes d'un héritage spirituel incarné dans les lieux, mais affirmées dans le cadre d'une communauté humaine et spirituelle, celle de la famille géographiquement située. Il est donc essentiel, autant que cela est possible, de préserver les patrimoines fonciers, même faibles voire insignifiants.
Comme on a pu le dire dans l'équilibre entre raison et sentiment dans le mariage, il ne faut pas dans la propriété familiale passer d'un excès à l'autre en enchaînant les hommes à leur terre. En effet, il est parfois nécessaire de faire disparaître une terre familiale, soit pour la survie économique du groupe, soit pour sa survie morale tant les blessures attachées à cette terre seraient nombreuses. Mais il faut aussi permettre à ceux qui le désirent de conserver leur enracinement. En somme, il faut avoir la liberté d'opérer un choix de préservation. C'est ce que permettrait la suppression des droits de succession sur les patrimoines fonciers et artistiques et la liberté testamentaire dans le cadre de la ligne directe pour ce genre de biens, à condition de ne pas spolier les autres héritiers qui devraient recevoir une compensation, même mineure. En effet, à quoi servirait-il de sauver la terre, si la famille se désagrège dans les luttes de succession ?
Nous pensons que cette réforme de l'héritage aurait l'immense vertu de renforcer le lien entre génération et donc l'institution familiale dans l'espace et le temps, pour le plus grand bien de l'épanouissement personnel et de la liberté.
A suivre…
Gabriel Privat
Du même auteur :
- Publié le jeudi 17 septembre 2015 : Anthropologie politique. Une société anti humaine. La Famille
- Publié le vendredi 16 octobre 2015 : Anthropologie politique. Une société anti humaine. L'enracinement territorial
- Publié le 18 novembre 2015 : Anthropologie politique. Une société anti humaine. Le lien professionnel
