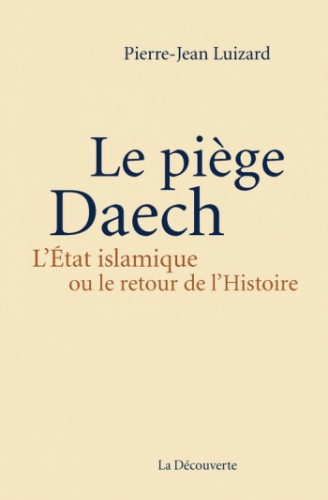 Chronique de livre : Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech, l'Etat islamique ou le retour de l'histoire, La Découverte, Paris, 2015
Chronique de livre : Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech, l'Etat islamique ou le retour de l'histoire, La Découverte, Paris, 2015
Pierre-Jean Luizard est directeur de recherche au CNRS, historien spécialiste du Moyen-Orient, en particulier de l'Irak, de la Syrie et du Liban. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur cette région du monde comme La Formation de l’Irak contemporain (CNRS Éditions, 2002) ; La Question irakienne (Fayard, 2002 ; nouvelle édition augmentée 2004) ; La Vie de l’ayatollah Mahdî al-Khâlisî par son fils (La Martinière, 2005) que pour ma part je n'ai pas consulté. Il publie avec Le piège Daech, l'Etat islamique ou le retour de l'histoire, un ouvrage éclairant sur la question de l'Etat islamique, ce nouveau califat qui agite l'actualité nationale et internationale, particulièrement depuis les attentats du vendredi 13 novembre.
L'ouvrage de 178 pages, agrémenté d'une chronologie et de trois cartes, se lit rapidement et permet de se faire une idée assez claire du sujet traité. Nous regretterons simplement l'absence d'un lexique répertoriant tous les termes spécifiques – en arabe – employés par l'auteur, et l'absence, plus embêtante encore, d'une bibliographie permettant au lecteur intéressé de poursuivre ses investigations. Je ne traiterai par ailleurs ici que de quelques aspects de l'ouvrage, faisant volontaire l'impasse sur Al Qaeda, Al Nosra, l'émergence concrète de l'Etat islamique, entre autres thèmes abordés dans celui-ci.
Achevé le 28 décembre 2014 et paru en février 2015, il ne concerne donc pas des événements de l'année 2015. Ne cherchez pas ici une quelconque analyse des évolutions géopolitiques de l'année écoulée, ni des événements qui ont secoué notre pays. En revanche il permet de se faire une idée beaucoup plus claire de l'histoire et de la situation de la région, l'auteur s'attaquant d'abord à expliquer la formation de l'Etat islamique, avant de faire un retour en arrière vers le découpage de la région par les puissances coloniales britanniques et françaises. Il analyse aussi la faillite des états irakiens et syriens, apporte des réflexions sur un bouleversement total et durable du Moyen-Orient et tente de justifier le titre de son ouvrage dans la dernière partie éponyme. Le moins que l'on puisse dire c'est que cet ouvrage est une réussite. Je suis toujours précautionneux face aux différentes publications en lien avec l'actualité, où certains universitaires veulent surtout se faire mousser. Point de tout cela chez Pierre-Jean Luizard qui ne fait un livre à charge contre personne, pas même l'Etat islamique, et cherche à nous livrer des clefs pour comprendre ce phénomène. Je n'ai tiqué qu'à deux reprises, la première par l'emploi systématique de l'expression « régime de Bachar al-Assad », qui certes correspond sûrement à la réalité d'un Etat qui a perdu le contrôle sur une bonne partie de son territoire, mais ne traduit pas que jusqu'à preuve du contraire, il s'agit du régime légitime reconnu par la communauté internationale. La seconde lorsque l'auteur nous livre une phrase élogieuse au sujet de l'Armée Syrienne Libre qui serait « pétrie de nationalisme arabe » alors qu'il me semble pourtant que des éléments salafistes y ont joué un rôle dès l'origine, comme ce fut le cas dans de nombreux mouvements de protestations issus du « printemps arabe » de 2011. A cette occasion l'auteur n'étaye d'ailleurs pas son propos par des déclarations ou toute autre forme de démonstration, nous devrions donc le croire sur parole, et en toute bonne foi.
Hormis ces détails, l'ouvrage vous en apprendra beaucoup sur la région et il adopte une grille de lecture qui nous semble tout à fait valable : temps long historique et prise en compte du fait ethno-confessionnel.
Pour le temps long historique, à l'instar de ce que j'écrivais d'ailleurs dans un article publié le 23 juin 2015, nous pouvons prendre comme une des clefs de lecture la chute de l'empire ottoman et le redécoupage du Moyen-Orient par les puissances coloniales, et mandataires, françaises et britanniques qui n'a pas tenu compte des anciennes velayets (ou wilayas) de l'empire Ottoman, ni des aspirations des populations. La décennie 1915-1925 semble être un tournant majeur dans l'histoire régionale. En effet en 1916, Français et Britanniques concluent un accord secret nommé Sykes-Picot, du nom des deux personnages en charge de cet accord, qui prévoit le redécoupage du Moyen-Orient. Après moultes tribulations et trahisons expliquées dans l'ouvrage, on assiste à la définition des frontières des états que nous connaissons : Liban, Syrie, Irak, (Trans)Jordanie et Palestine (plus tard Israël) qui sont fixées en 1925. L'auteur mentionne également les accords de Balfour entre britanniques et sionistes qui prévoient, dès 1917, l'installation d'un foyer national juif en Palestine. Les britanniques auront comme à leur habitude (l'Afrique du sud en est un autre exemple patent) semé les graines de la discorde. Ils iront jusqu'à mener en bateau le chérif de La Mecque, lui promettant une grande union pan-arabe qui ne verra jamais le jour. Les Britanniques appuieront ensuite en Irak la minorité sunnite face à la majorité chiite. Les Etats-Unis en feront d'ailleurs de même après la révolution islamique d'Iran. Alors que le régime irakien n'aurait jamais dû survivre aux années 80, il profita de l'appui de Washington qui y voyait un allié contre l'Iran et un territoire intéressant pour le pétrole.
En Syrie, où l'influence européenne était encore plus importante du fait de la situation géographique méditerranéenne du pays et de l'importance des communautés chrétiennes, c'est un phénomène assez similaire qui se produit mais en faveur des chiites et des chrétiens. Les fondateurs du baassisme syrien sont pour la plupart des chrétiens voulant échapper au statut de minorités face à la majorité sunnite. L'arabité y est perçu comme un facteur unitaire permettant de dépasser les clivages confessionnels. En cela les baassistes importent les éléments issus de l'histoire politique européenne dont ils ont été nourris dans les universités françaises (nationalisme, ethnicisme, laïcité, état de droit, etc...). L'auteur explique que pour les minorités de la région, ce qui importe c'est d'accéder à une égalité de droit. Partout les minorités veulent s'extraire de leur statut. Le fait donc qu'en Irak des chiites, qui traitent aujourd'hui les sunnites comme ils furent eux-mêmes traités par ces derniers, passent de l'islam confessionnel au communisme avant de retourner à l'islam confessionnel, ou que des sunnites passent du baassisme irakien à l'Etat islamique n'est donc pas étonnant si l'on prend en compte la clef de lecture ethno-confessionnelle, c'est à dire la mosaïque identitaire de cette région. Hussein lui-même joua cette carte contre l'Iran persan et chiite en opposant une identité arabe et sunnite. L'Etat islamique est donc une réponse à la fois pan-arabe et islamique, fonctionnant sur un enracinement territorial et une arabité culturelle d'une part et sur un universalisme islamique salafiste (wahhabite) d'autre part, permettant l'intégration de populations diverses (tchétchènes, néo-convertis occidentaux, maghrébins, etc...). L'auteur rappelle également que la Syrie est un foyer historique du hanbalisme dont est issu le wahhabisme. Le terreau y était donc fertile, surtout si la majorité sunnite est exclue des sphères du pouvoir... A cela il faut rajouter toutes les questions tribales, claniques, la parenté, la descendance du prophète, les différentes sectes religieuses, etc... faisant de ces régions un authentique sac de nœud communautaire (18 communautés au Liban, par exemple). Si La Yougoslavie, formée en 1919-1920, a explosée dans les années 1990, il semblerait que le Moyen-Orient suive le même chemin et que l'Etat islamique ne soit - entre autre - qu'une manifestation de ce phénomène. Ces derniers ne s'y sont pas trompés en détruisant symboliquement la frontière syro-irakienne avec un tractopelle en faisant référence aux accords Sykes-Picot. Car si l'unité des arabes n'apparaît au final que rhétorique en Syrie et en Irak, et a surtout permis à des clans de s'assurer le pouvoir, cet élément de propagande est repris par l'Etat islamique. Ce que les Etats syriens et irakiens n'ont jamais fait - car ils étaient créés et (en partie) inféodés aux occidentaux -, alors l'Etat islamique le fera. Voila dans les grandes lignes ce qu'on peut comprendre. A cela s'ajoute la dimension islamique salafiste « takfiri » qui considère que les autres branches de l'islam se sont compromises avec l'Occident.
L'auteur s'attaque également à la position difficile des Etats voisins, qu'ils soient modestes comme le Liban ou beaucoup plus influents comme la Turquie et l'Arabie Saoudite. Au Liban, c'est le Hezbollah qui apparaît comme le principal ennemi de l'Etat islamique, l'armée libanaise se retrouvant coincée entre des sunnites assez hostiles au Hezbollah et à la Syrie et des chiites et des chrétiens plutôt favorables. Pour la Turquie il considère que l'AKP n'a effectué que des mauvais choix qui se sont retournés contre-lui. Erdogan, en refusant de désigner un ennemi principal et en mettant dos à dos en terme de menaces les minorités alévis et kurdes avec l'Etat islamique, semble perdre le contrôle de la situation. Il rappelle cependant que la frontière passoire entre l'EI et la Turquie n'est pas une nouveauté et que déjà avec Saddam Hussein les trafics de pétrole y étaient nombreux. En Arabie Saoudite, le pouvoir qui a joué le grand écart entre son rigorisme salafiste et son alliance avec les Etats-Unis semble aujourd’hui dans une situation complexe. L'auteur titre même « le roi est nu ». La plupart des officines salafistes ou liées au Frères musulmans, qui profitèrent jadis du régime, se retournent depuis quelques années contre lui. Les chiites qui eurent l'espoir de s'intégrer il y a dix ans vivent aujourd'hui un redoutable retour au réel avec les répression de leurs congénères à Bahrein et au Yémen où sont impliqués les Saoudiens. L'exécution récente d'un responsable chiite saoudien ne peut que donner raison aux intuitions de l'auteur sur la fuite en avant du régime saoudien. Les Saoudiens s’attellent donc à protéger leurs frontières en surveillant les 800 km qu'elle a en commun avec les Etats en pleine déconfiture et, élément que ne mentionnent pas l'auteur, ils ont augmenté leur budget militaire depuis deux ans (4eme en 2014 derrière les Etats-Unis, la Chine et la Russie). Avec l'effondrement des rentes pétrolières, la dissidence d'une partie des élites saoudiennes favorables à l'EI et le soutien de grandes familles qataris aux Frères musulmans et à l'EI, la situation semble tendue pour ce pays qui se veut un gardien des lieux saints. Bémol de cette partie de l'ouvrage, l'auteur ne s’attaque pas à la pérennité de l'Etat d'Israël ni à son implication dans la région. Je fus par contre très agréablement surpris de voir que l'auteur mentionne l'effet miroir entre Occidentaux et salafistes de l'EI, rappelant par là le conflit mimétique cher à feu René Girard. Jean-Pierre Luizard indique par exemple que l'EI emploie à son profit des expressions qu'on retrouve dans Le Choc des civilisations d'Hutington. L'auteur n'hésite pas à pointer du doigt l'échec de la politique américaine depuis 2003, politique dont d'ailleurs il ne comprend pas la logique pour les intérêts des Etats-Unis eux-mêmes. Ceux-ci ont cru qu'en redonnant le pouvoir aux chiites et en valorisant les Kurdes, ils régleraient les difficultés de l'Irak sunnite de Saddam Hussein ; ils n'auront au contraire fait que détricoter le Moyen-Orient créé par les Européens, et libérés les conflits ethno-confessionnels. Fabius n'est pas en reste, l'auteur estimant qu'il n'a toujours pas pris la mesure de la réalité du terrain et que les appels à la souveraineté de l'Irak ne risquaient pas de trouver un écho chez des sunnites en conflit larvé avec les chiites.
L'auteur considère donc que l'EI a très bien manœuvré en provoquant les différents acteurs sur un terrain qui les conduiraient à s'impliquer, nous les premiers. Avec les attaques sur les minorités ou les femmes et en diffusant des vidéos scénarisées destinées à faire réagir notre opinion publique, et donc nos politiciens sur le mode émotionnel, l'EI a marqué des points contre nous. Il modère en revanche la question chrétienne en rappelant qu'en tant que « Gens du Livre » ils peuvent profiter du statut de dhimmis, comme à Raqqa. Dans d'autres territoires contrôlés par l'EI, ce sont les chrétiens qui ont refusé la conversion ou le statut de dhimmis et les différentes conditions de l'EI prévues par la charia, et se sont exilés, comme c'est le cas à Mossoul. Il ne traite pas en revanche la question des réfugiés/migrants/clandestins qui arrivent en Europe. Il faut dire que le phénomène s'est amplifié depuis la parution du livre. En revanche il n'hésite pas à mentionner que les nombreux réfugiés sont des foyers de déstabilisation dans leurs pays d'accueils : Liban ou Jordanie. Et nombreux sont les pays qui y voient de potentiels djihadistes infiltrés. Les européens, qui méconnaissent totalement le champs des conflits inter-ethnique et interconfessionnel depuis longtemps, ne sont donc pas encore préparés à appréhender le phénomène des réfugiés avec le regard des pays moyen-orientaux qui en ont l'habitude. Les bagarres qui éclatent dans les camps de clandestins en Europe sont pourtant une illustration de ce phénomène de tension inter-ethnique. Il ne serait pas étonnant que cela arrange bien les différents Etats de la région de nous envoyer leurs réfugiés, s'épargnant des émeutes et troubles potentiels dans un contexte déjà très tendu.
Au final, tous les pays sont donc tombés dans le « piège Daech » et on devine d'où Alain de Benoist tire sa réflexion lorsqu'il écrit « Il ne sert à rien de supprimer l’État Islamique si l’on ne sait pas par quoi le remplacer ». L'auteur conclue en effet son ouvrage, entre autre, par ces mots : « Une longue période historique s'achève : on ne reviendra pas au Moyen-Orient que nous avons connu depuis près d'un siècle. Une guerre lancée sans perspectives politiques n'est-elle pas perdue d'avance ? C'est le piège que l'Etat islamique tend aux démocraties occidentales pour lesquelles il représente certainement un danger mortel. Les leçons de l'Histoire doivent aussi servir à le combattre. »
L'avenir qui se dessine ressemble en tout cas étonnamment au projet de « Grand Moyen-Orient ». Il est de toute façon clair que cette mosaïque ethnique, aux frontières dessinées par les Européens, ne pouvait pas durer, comme c'est aussi le cas en Afrique, du reste. Le retour de l'histoire, c'est le retour des grandes aires de civilisation, c'est le retour du temps long et des revendications ethno-confessionnelles. Un coup de surin dans le monde hérité des Lumières.
Jean / C.N.C.
http://cerclenonconforme.hautetfort.com/archive/2016/01/03/chronique-de-livre-pierre-jean-luizard-le-piege-daech-l-etat-5739470.html
 en remplissant le
en remplissant le 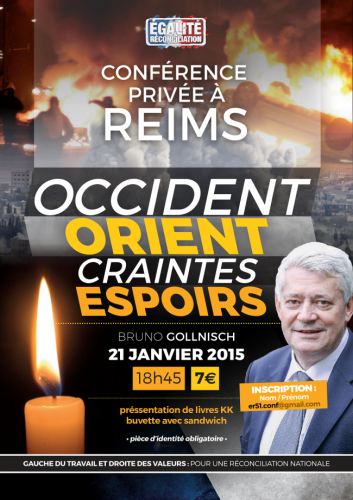
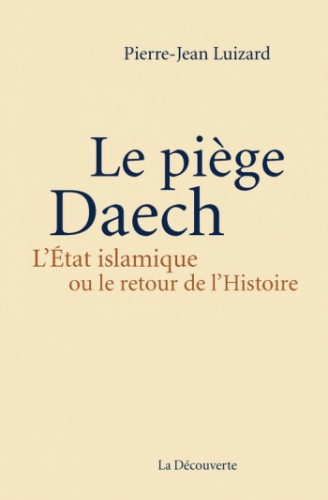 Chronique de livre : Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech, l'Etat islamique ou le retour de l'histoire, La Découverte, Paris, 2015
Chronique de livre : Pierre-Jean Luizard, Le piège Daech, l'Etat islamique ou le retour de l'histoire, La Découverte, Paris, 2015