culture et histoire - Page 1249
-
DRDA : Le Nôtre, un génie français
-
Éléments N° 158 disponible !

Au sommaire de ce numéro d’Éléments : une interview exclusive de Jacques Sapir, qui interpelle notamment Jean-Luc Mélenchon, un entretien avec Pierre Manent sur la France face au défi de l’islam, une mise en cause de l’art contemporain par Jean Clair, de l’Académie française, et des articles sur le retour de la puissance russe, sur Carl Schmitt et l’état d’urgence, sur les guerres de François Hollande, etc.
Sans oublier le dossier central sur l’avenir et la démondialisation… -
Ce que civilisation veut dire
Priez pour Paris ! Ce fameux hashtag crée une polémique chez nos confrères de Libération. Les Français n’ont toujours pas compris dans qu’elle guerre ils sont : non pas d’abord une guerre avec des blindés et des avions, mais une guerre de civilisation.
Nos énarques sont en pleine panade, leurs méthodes se trouvent manifestement dépassées par ce qui arrive. Suivant le conseil du Comte de Saint Simon, ils avaient voulu substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses.Tout le monde avait l'impression rassurante que ce pays se gouvernait avec des mesures techniques et des circulaires administratives. Et voilà qu'une situation inédite se manifeste : parmi la population musulmane que nos fonctionnaires avaient ordre de faire rentrer dans notre pays sans même avoir le droit de les compter, une partie, une petite partie, quelque chose comme 10 % des entrants adhèrent à une version littérale de l'islam, celle qui ordonne, selon la lettre du Coran, de « tuer les infidèles jusqu'à ce qu ils aient payé tribut ». Le fait est sans précédent dans l'histoire de la République. Les migrants d'hier et d'aujourd'hui, cela fait des millions de musulmans en France... 10 %, quand cela porte sur des millions, c'est énorme. Quant au profil du musulman dit radicalisé, il provoque aussi quelques surprises : on nous le décrit régulièrement comme poli, gentil, toujours prêt à rendre service. Et puis il a fait un voyage en Syrie, un aller-retour bien sûr, et là il s'est radicalisé. Il passe à l'attaque, ce n'est plus le même homme.
S'agit-il d'une guerre classique ? Non, n'en déplaise à M. Hollande, qui depuis qu'il a mené la guerre au Mali se prend pour un stratège. Il ne suffira pas d'envoyer des avions rafales en Syrie, ni même notre unique porte avion pour gagner cette guerre, c'est trop tard. Maintenant la guerre a lieu à Saint-Denis. Comme l'explique une coiffeuse de la ville dont la boutique comporte une pièce spéciale pour les femmes voilées : « Ici on n'est pas à Oran. Les gens vont jusqu'au bout de leur foi ».
Que peut-on faire contre cette foi musulmane d'un peuple, plus forte en France terre de conquête qu'au Maroc, à Oran, terre d'islam ? Déclarer qu'elle n'est pas dangereuse et que la France est accueillante, voilà la politique menée indistinctement par l'UMP (en ce temps-là) et par le PS (aujourd'hui). Mais y a-t-il une autre politique possible ? Le problème désormais échappe aux politiques issus de l’énarchie. On ne réglera pas la question avec des techniques de gouvernements ou de gestion des hommes. Le drame est spirituel. C'est l'Église qui doit prendre position. Surprise : alors que d'habitude, la Conférence épiscopale prend la parole sur tout, cette fois, depuis le sinistre vendredi 13, on n'a pas entendu nos évêques.
Pas un communiqué commun. La réalité, si longtemps évitée à coup de langue de buis, ne peut plus être niée. Le réel a eu lieu, plus personne ne peut prétendre le contraire : nous sommes dans une guerre de civilisation que nous n'avons pas déclarée, mais qui nous est faite en silence depuis des années et désormais dans la pétarade des kalachnikovs et dans les explosions des hommes-bombes. On pourra désamorcer telle ou telle action, en laissant des blessés de chez nous sur le terrain, comme à Saint-Denis, et bientôt sans doute des morts. Cela ne changera rien à la configuration générale et à la guerre qui a lieu. Dans cette guerre, nos évêques ne s'en rendent pas compte;, ils sont en première ligne. En effet, le seul moyen, je ne dis pas de convertir les musulmans comme un seul homme mais de leur faire oublier cette pente à la radicalisation qu'ils montrent si souvent, c'est, pour la France, de revenir à ses racines chrétiennes, pour les chrétiens, pratiquants ou non, de reprendre conscience de l'importance de leur foi dans la guerre de civilisation qui est la nôtre, pour l'ensemble du corps social de retrouver ses valeurs.
Les valeurs françaises ne sont pas laïques ; c'est lorsque l’on parle avec des "laïcs" convaincus que l'on s'en aperçoit : les valeurs des laïcs sont des valeurs chrétiennes, respect du prochain, de la création etc. Mais c 'est le laïcisme français, qui, lui, est historiquement antichrétien et qui continue imperturbablement dans ce registre. Comme le montre la récente histoire des crèches, qui, à en croire l'AMF, devraient désormais être proscrites systématiquement de tout bâtiment public, le laïcisme militant fait désormais le jeu de l'islam. En contribuant à faire disparaître les crèches, ces images de Noël dans notre société, le laïcisme favorise le véritable grand remplacement, le grand remplacement culturel : l’Aïd pourra prendre la place du 25 décembre. Les fêtes de rupture de jeune, après le mois de Ramadan, remplaceront le Premier de l'an (qui, par parenthèse, marque que je sache le calendrier chrétien).
Dans le combat culturel avec l'islam fondamentaliste, les chrétiens ont une véritable avance intellectuelle. Mais ils sont ralentis par deux inventions de Vatican II : la repentance (au début de Gaudium et spes) et le dialogue interreligieux (qui mène au refus d'évangéliser). Il faut des autorités spirituelles dignes de ce nom, pour mener aujourd'hui un combat qui a dépassé les politiques et qui devient un combat spirituel, mental, civilisationnel.
Abbé G. de Tanoûarn monde&vie 23 novembre 2015
-
Marche Sainte Geneviève - Paris Fierté 2016
-
L'homme catholique dans la société - François de Carennac
-
Pierre Boutang et la permanence de « L'espérance royale » : celle de Maurras, la sienne, la nôtre ...
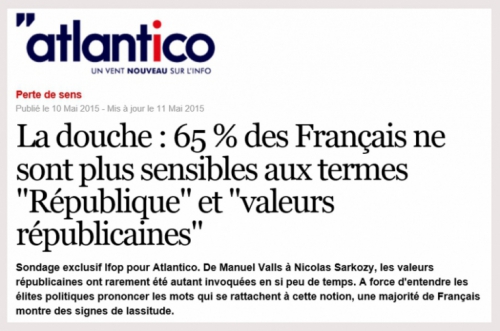
Dans son prélude au livre essentiel qu'il a écrit sur Maurras* - ouvrage sans-doute trop volumineux et souvent trop difficile pour que beaucoup d'esprits fassent l'effort de s'y arrêter vraiment - Pierre Boutang dit ce que fut l'espérance royale de Charles Maurras, mais aussi la sienne propre, et conséquemment la nôtre, nous qui gardons, dans le contexte actuel, la foi politique qui fut la leur, comme de beaucoup d'autres. Une foi et une espérance politiques purement d'Action française. Ce texte, dont nous publions plus loin quelques extraits, nous paraît en effet en particulière concordance avec l'évolution en cours d'un certain nombre d'esprits importants, soit qu'ils se livrent à une forme très nette de remise en cause des valeurs républicaines, de la République en soi-même, soit qu'ils posent, très clairement, la question du régime et évoquent le manque de Roi, à l'instar d'Emmanuel Macron, ministre de l'Economie en exercice. Ainsi, la monarchie réapparaît, une fois de plus, comme le dit Boutang, sinon immédiatement à l'horizon du possible, du moins au cœur du débat public Dans un contexte et un langage actuels, comme il est normal. Et si l'idée monarchique ne cesse pas d'être sous-jacente à la réflexion politique contemporaine, on verra ce qu'elle doit, selon Boutang, à la démonstration puissante, répétée pendant un demi-siècle, par Maurras et par l'Action française selon laquelle la République ne remplit pas les conditions minimales d'un Etat. Tel est en tout cas le constat que font aujourd'hui, selon des voies diverses, nombre de personnalités dont il serait aisé de réunir les noms et les textes. Dans les crises de toute nature où se débat le régime, ces avancées de l'hypothèse monarchique ne sont pas négligeables. Tout au contraire. LFAR
Dans cet ordre, sans doute [l'espérance royale], il n'a jamais pensé qu'à faire. Ses pires insulteurs sont ceux qui feignent de douter qu'il ait, de toutes ses forces, voulu le Roi, comme il voulait la patrie. Encore un coup, Péguy était bon juge, espérait même qu'il y eût quelqu'un pour vouloir la République comme Maurras voulait le Roi, et a dit la conviction que cet homme était prêt à mourir pour ce Roi qui ne meurt pas, qui accompagne la patrie; pour Celui, tout autant, qui, de manière fixe, destinée, figure, pour une ou deux générations cette escorte des siècles. Croyez-vous, jeunes gens, que, parce qu'il le démontre avec tout l'éclat du Même et du Logos, il y adhère moins ? Ça ne serait vraisemblable que pour un qui se distinguerait de sa pensée. Il voulait même que le Roi voulût régner, autant et plus qu'il prouvait sa nécessité.
[…] Plusieurs décennies ont passé depuis sa mort, et nous avons recommencé, cessé, et puis recommencé; nous avons, quelques-uns, roulé le rocher de Sisyphe qu'est, au regard étranger, pas au nôtre, la monarchie.
Possible que cela prête, au moins, à sourire, n'est-ce pas ? Nous en souririons nous-mêmes, s'il n'y avait l'espérance qui crie en nos petits-enfants. Oui, comme a dit ce vieil et pur camelot du roi de Bernanos, « autour des petits garçons français penchés ensemble sur leurs cahiers, la plume à la main, et tirant un peu la langue, comme autour des jeunes gens ivres de leur première sortie sous les marronniers en fleur, au bras d'une jeune fille blonde, il y avait ce souvenir vague et enchanté, ce rêve, ce profond murmure dont la race berce les siens ». Il y avait ? Il y a : chaque fois que naît un enfant dont on sait déjà que, bientôt, il saura dire son ave Maria, et le long d'un clair ruisseau buvait une colombe.
Je l'admets, Maurras n'a pas réussi à ramener le Roi. Il a travaillé « pour 1950 », et voici bientôt l'an deux mille, et si le Roi n'est pas ramené, notre foi politique est vaine.
[…] Mais, d'abord, il y a un sens où le retour du Roi n'a nullement été étranger à son action et à sa preuve. Certes nos Princes n'échappent pas à la cruelle loi d'exil grâce à la force ou la ruse de l'Action française. Simplement l'Idée du Roi, sans laquelle on ne sait pas qui rentre, sans laquelle nos Princes eux-mêmes ne l'auraient pas toujours su, cette Idée-là dormait au cœur de la forêt historiale sans que personne eût le souci ni les moyens de la réveiller.
Ensuite l'auteur de l'Enquête n'a jamais douté que l'instauration et la consolidation d'une monarchie moderne — ou affrontée au monde moderne — ne dût être l'œuvre du Prince lui-même, et de son charisme qui dépasse la raison, du moins toutes les raisons.
Toutefois […] nous avons été « jetés en monarchie », en quasi-monarchie par un Charles De Gaulle très conscient des prolongements nécessaires pour que son œuvre ne fût pas, à long terme, un échec pire que celui de la république qu'il avait « ramassée dans la boue » en 1944 et déposée en 1958...
Enfin deux ordres de réalités concomitantes doivent être considérés à propos de Maurras :
D'une part, en remontant du salut public […] jusqu'à sa condition royale, il a pu ériger la preuve puissante, jamais réfutée, que la république en France, règne du nombre, des partis, et, à travers eux, de l'or et de l'Étranger, ne remplissait pas les conditions minimales d'un État; qu'elle ne pouvait donc masquer sa nullité politique que par une tyrannie administrative et bureaucratique vouée à défaire la nation. Il en résultait que l'avantage majeur de la monarchie serait de n'être pas la République, de combler son vide par la présence d'une personne douée, en général et au moins, des attributs de l'humanité, la raison de « l'animal rationnel mortel » et la responsabilité.
Sans cette démonstration, répétée pendant un demi-siècle, la monarchie n'aurait pu apparaître à l'horizon du possible.
D'autre part le royalisme maurrassien a trouvé sa forme supérieure, et sa composition stable, (la seule qui pût avoir des prolongements positifs, hors de la simple critique de la religion et de la non-politique démocratiques) chez ceux qui, ou bien avaient conservé une fidélité monarchique, tout endormie et désespérée qu'elle fût, ou bien, dans l'Armée, l'Église, et quelques réduits de l'Intelligence critique et de l'Université, ne voyaient pas chez le Roi la simple négation de la République, mais une personne vivante, l'héritier des fondateurs de la patrie.
Maurras avait dû, sans jamais oublier ce royalisme, où ne s'opposent jamais l'intelligence et le cœur, mettre l'accent sur la preuve négative, creuser et miner la démocratie parlementaire dont les ruines pouvaient seules, une fois déblayées, laisser la place à la monarchie moderne. Cela étant fait, et bien fait, cette critique ayant pénétré dans le subconscient de toutes les familles politiques, un fait nouveau, aussi inattendu que, pour les marxistes orthodoxes avant Lénine la Révolution dans un seul pays, apparut : non seulement le Roi se concevait comme négation effective de la République sans tête ni cœur, mais l'accession au pouvoir souverain, peut-être sous une forme nouvelle, d'un Capétien, fils de saint Louis, sortait de la simple spéculation**.
* Maurras, la destinée et l'œuvre, Plon, 1984
** Boutang évoque ici - et plus loin - la volonté de régner du Comte de Paris (Henri VI) et son action. De même la persistance des Princes de la Maison de France à assumer "la tradition qu'il (leur) a été donné d'incarner".
-
Les principes régaliens de l'État - François de Carennac
-
DRDA : Notre-Dame au coeur de l'Histoire
-
XXeme Table Ronde de Terre et Peuple (video)
-
Réflexions sur la géopolitique et l’histoire du bassin oriental de la Méditerranée
Dérives multiples en marge de la crise grecque
La crise grecque est majoritairement perçue comme une crise économique et monétaire, détachée de tout contexte historique et géopolitique. Les technocrates et les économistes, généralement des bricoleurs sans vision ni jugeote, englués dans un présentisme infécond, n’ont nullement réfléchi à la nécessité, pour l’Europe, de se maintenir solidement dans cet espace est-méditerranéen, dont la maîtrise lui assure la paix. Sans présence forte dans cet espace, l’Europe est déforcée. Ce raisonnement historique est pourtant établi : les croisades, l’intervention aragonaise en Grèce au 14ème siècle (avec la caste guerrière des Almogavares), etc. montrent clairement que ce fut toujours une nécessité vitale d’ancrer une présence européenne dans cet archipel hellénique, menacé par les faits turc et musulman. L’absence de mémoire historique,entretenue par les tenants de nos technocraties banquières et économistes, a fait oublier cette vérité incontournable de notre histoire : la gestion désastreuse de la crise grecque le montre à l’envi.
Erdogan, Toynbee et la dynamique turque
La puissance régionale majeure dans cet espace est aujourd’hui la Turquie d’Erdogan, même si toute puissance véritable, de nos jours, est tributaire, là-bas, de la volonté américaine, dont l’instrument est la flotte qui croise dans les eaux de la Grande Bleue. Trop peu nombreux sont les décideurs européens qui comprennent les ressorts anciens de la dynamique turque dans cette région, qui donne accès à la Mer Noire, aux terres noires d’Ukraine, au Danube, au Caucase, au Nil (et donc au cœur de l’Afrique orientale), à la Mer Rouge et au commerce avec les Indes. Comprendre la géopolitique à l’œuvre depuis toujours, dans ce point névralgique du globe, même avant toute présence turque, est un impératif de lucidité politique. Nous avons derrière nous sept siècles de confrontation avec le fait turc-ottoman mais c’est plutôt dans l’histoire antique qu’il convient de découvrir comment, dans la région, le territoire en lui-même confère un pouvoir, réel ou potentiel, à qui l’occupe. C’est le byzantinologue Arnold J. Toynbee, directeur et fondateur du « Royal Institute of International Affairs » (RIIA), et par là même inspirateur de bon nombre de stratégies britanniques (puis américaines), qui a explicité de la manière la plus claire cette dynamique que pas un responsable européen à haut niveau ne devrait perdre de vue : la domination de l’antique Bithynie, petit territoire situé juste au-delà du Bosphore en terre anatolienne, permet, s’il y a impulsion adéquate, s’il y a « response » correcte au « challenge » de la territorialité bithynienne (pour reprendre le vocabulaire de Toynbee), la double maîtrise de l’Egée et de la Mer Noire. Rome devient maîtresse de ces deux espaces maritimes après s’être assurée du contrôle de la Bithynie (au prix des vertus de César, insinuaient les méchantes langues romaines…). Plus tard, cette Bithynie deviendra le territoire initial du clan d’Osman (ou Othman) qui nous lèguera le terme d’« ottoman ».
Une Grèce antique pontique et méditerranéenne
On parle souvent de manière figée de la civilisation grecque antique, en faisant du classicisme non dynamique à la manière des cuistres, en imaginant une Grèce limitée tantôt à l’aréopage d’Athènes tantôt au gymnase de Sparte, tantôt aux syllogismes de ses philosophes ou à la géométrie de ses mathématiciens, une Grèce comme un îlot isolé de son environnement méditerranéen et pontique. Le point névralgique de cette civilisation, bien plus complexe et bien plus riche que les petits professeurs classicistes ne l’imaginaient, était le Bosphore, clef de l’ensemble maritime Egée/Pont Euxin. Le Bosphore liait la Grèce égéenne à la Mer Noire, la Crimée et l’Ukraine, d’où lui venait son blé et, pour une bonne part, son bois et ses gardes scythes, qui assuraient la police à Athènes. La civilisation hellénique est donc un ensemble méditerranéen et pontique, mêlant divers peuples, de souches européennes et non européennes, en une synthèse vivante, où les arrière-pays balkaniques, les Thraces et les Scythes, branchés sur l’Europe du Nord finno-ougrienne via les fleuves russes, ne sont nullement absents. L’espace hellénique, la future Romania d’Orient hellénophone, l’univers byzantin possèdent donc une dimension pontique et l’archipel proprement hellénique est la pointe avancée de ce complexe balkano-pontique, situé au sud du cours du Danube. En ce sens, l’espace grec d’aujourd’hui, où s’étaient concentrées la plupart des Cités-Etats de la Grèce classique, est le prolongement de l’Europe danubienne et balkanique en direction du Levant, de l’Egypte et de l’Afrique. S’il n’est pas ce prolongement, si cet espace est coupé de son « hinterland » européen, il devient ipso facto le tremplin du Levant et, éventuellement, de l’Egypte, si d’aventure elle redevenait une puissance qui compte, comme au temps de Mehmet Ali, en direction du cœur danubien de l’Europe.Toynbee, avec sa thèse bithynienne, a démontré, lui, que si l’hellénité (romaine ou byzantine) perd la Bithynie proche du Bosphore et disposant d’une façade pontique, la puissance qui s’en empareraitpourrait aiséments’étendre dans toutes les directions : vers les Balkans et le Danube, vers la Crimée, la Mer Noire et le cours des grands fleuves russes, vers le Caucase (la Colchide), tremplin vers l’Orient perse, vers l’Egypte en longeant les côtes syrienne, libanaise, palestinienne et sinaïque, vers le Nil, artère menant droit au cœur de l’Afrique orientale, vers la Mer Rouge qui donne accès au commerce avec l’Inde et la Chine, vers la Mésopotamie et le Golfe Persique. L’aventure ottomane, depuis la base initiale des territoires bithynien et péri-bithynien d’Osman, prouve largement la pertinence de cette thèse. L’expansion ottomane a créé un verrou d’enclavement contre lequel l’Europe a buté pendant de longs siècles. La Turquie kémaliste, en rejetant l’héritage ottoman, a toutefois conservé un pouvoir régional réel et un pouvoir global potentiel en maintenant le territoire bithynien sous sa souveraineté. Même si elle n’a plus les moyens techniques, donc militaires, de reprendre l’expansion ottomane, la Turquie actuelle, post-kémaliste, garde des atouts précieux, simplement par sa position géographique qui fait d’elle, même affaiblie, une puissance régionale incontournable.
Une Turquie ethniquement et religieusement fragmentée derrière un unanimisme apparent
Le fait turc consiste en un nationalisme particulier greffé sur une population, certes majoritairement turque et musulmane-sunnite, mais hétérogène si l’on tient compte du fait que ces citoyens turcs ne sont pas nécessairement les descendants d’immigrants guerriers venus d’Asie centrale, berceau des peuples turcophones : beaucoup sont des Grecs ou des Arméniens convertis en surface, professant un islam édulcoré ou un laïcisme antireligieux ; d’autres sont des Kurdes indo-européens sunnites ou des Arabes sémitiques également sunnites ; d’autres encore descendent d’immigrants balkaniques islamisés ou de peuples venus de la rive septentrionale de la Mer Noire ; à ces fractures ethniques, il convient d’ajouter les clivages religieux: combien de zoroastriens en apparence sunnites ou alévites, combien de derviches à la religiosité riche et séduisante, combien de Bosniaquesslaves dont les ancêtres professaient le manichéisme bogomile, combien de chiites masqués chez les Kurdes ou les Kurdes turcisés, toutes options religieuses anciennes et bien ancrées que l’Européen moyen et les pitres politiciens, qu’il élit, sont incapables de comprendre ?
Le nationalisme turc de facture kémaliste voulait camper sur une base géographique anatolienne qu’il espérait homogénéiser et surtout laïciser, au nom d’un tropisme européen. Le nationalisme nouveau, porté par Erdogan, l’homme qui a inauguré l’ère post-kémaliste, conjugue une option géopolitique particulière, celle qui combine l’ancienne dynamique ottomane avec l’idéal du califat sunnite. Les Kurdes, jadis ennemis emblématiques du pouvoir kémaliste et militaire, sont devenus parfois, dans le discours d’Erdogan, des alliés potentiels dans la lutte planétaire amorcée par les sunnites contre le chiisme ou ses dérivés. Mais tous les Kurdes, face à l’acteur récent qu’est l’Etat islamique en Irak et en Syrie, ne se sentent pas proches de ce fondamentalisme virulent et ne souhaitent pas, face à un sunnisme militant et violent, céder des éléments d’émancipation traditionnels, légués par leurs traditions gentilices indo-européennes, par un zoroastrisme diffus se profilant derrière un sunnisme de façade et de convention, etc.
Echec du néo-ottomanisme
L’Europe, si elle avait été souveraine et non pas gouvernée par des canules et des ignorants, aurait parfaitement pu admettre la géopolitique de Davoutoglu, comme une sorte d’interface entre le bloc européen (de préférence libéré de l’anachronisme « otanien ») et le puzzle complexe et explosif du Levant et du Moyen-Orient, que le néo-ottomanisme déclaré aurait pu apaiser et, par la même, il aurait annihilé certains projets américains de balkaniser durablement cette région en y attisant la lutte de tous contre tous, selon la théorie de Donald M. Snow (l’intensification maximale du désordre par les uncivilwars).
Cependant l’Europe, entre la parution des premiers écrits géopolitiques et néo-ottomanistes de Davoutoglu et les succès de l’Etat islamique en Syrie et en Irak, a connu un ressac supplémentaire, qui se traduit par une forme nouvelle d’enclavement : elle n’a plus aucune entrée au Levant, au Moyen-Orient ou même en Afrique du Nord, suite à l’implosion de la Libye. La disparition du contrôle des flux migratoires par l’Etat libyen fait que l’Europe se trouve assiégée comme avant le 16ème siècle : elle devient le réceptacle d’un trop-plein de population (essentiellement subsaharienne) et cesse d’être la base de départ d’un trop-plein de population vers les Nouveaux Mondes des Amériques et de l’Océanie. Elle n’est plus une civilisation qui rayonne, mais une civilisation que l’on hait et que l’on méprise (aussi parce que les représentants officiels de cette civilisation prônent les dérives du festivisme post-soixante-huitard qui révulsent Turcs, Africains et Arabo-Musulmans).
Dimensions adriatiques
Si cette civilisation battue en brèche perd tous ses atouts en Méditerranée orientale et si la Grèce devient un maillon faible dans le dispositif européen, ce déclin irrémédiable ne pourra plus prendre fin. Raison majeure, pour tous les esprits qui résistent aux dévoiements imposés, de relire l’histoire européenne à la lumière des événements qui ont jalonné l’histoire du bassin oriental de la Méditerranée, de l’Adriatique et de la République de Venise (et des autres Cités-Etats commerçantes et thalassocratiques de la péninsule italienne). L’Adriatique est la portion de la Méditerranée qui s’enfonce le plus profondément vers l’intérieur des terres et, notamment, vers les terres, non littorales, où l’allemand est parlé, langue la plus spécifiquement européenne, exprimant le plus profondément l’esprit européen. La Styrie et la Carinthie sont des provinces autrichiennes germanophones en prise sur les réalités adriatiques et donc méditerranéennes, liées territorialement à la Vénétie. L’Istrie, aujourd’hui croate, était la base navale de la marine austro-hongroise jusqu’au Traité de Versailles. L’Adriatique donne accès au bassin oriental de la Méditerranée et c’est la maîtrise ininterrompue de ses eaux qui a fait la puissance de Venise, adversaire tenace de l’Empire ottoman. Venise était présente en Méditerranée orientale, Gênes en Crimée, presqu’île branchée sur les routes de la soie, laissées ouvertes par les Tatars avant qu’ils ne se soumettent à la Sublime Porte. Cette géopolitique vénitienne, trop peu arcboutée sur une masse territoriale assez vaste et substantielle, n’est peut-être plus articulable telle quelle aujourd’hui : aucun micro-Etat, de dimension urbaine ou ne disposant pas d’une masse de plusieurs dizaines de millions d’habitants, ne pourrait fonctionner aujourd’hui de manière optimale ni restituer une géopolitique et une thalassopolitique de grande ampleur, suffisante pour sortir justement toute la civilisation européenne de l’impasse et de l’enclavement dans lesquels elle chavire de nos jours.
Double atout d’une géostratégie néo-vénitienne
Le concert européen pourrait déployer une nouvelle géopolitique vénitienne, qui serait une perspective parmi bien d’autres tout aussi fécondes et potentielles, pour sortir de l’impasse actuelle ; cette géopolitique vénitienne devrait dès lors être articulée par un ensemble cohérent, animé par une vision nécessairement convergente et non plus conflictuelle. Cette vision pourrait s’avérer très utile pour une projection européenne efficace vers le bassin oriental de la Méditerranée et vers l’espace pontique. Venise, et Gênes, se projetaient vers le bassin oriental de la Méditerranée et vers la Mer Noire, au-delà du Bosphore tant que Byzance demeurait indépendante. Cette double projection donnait accès aux routes de la soie, au départ de la Crimée vers la Chine et aussi, mais plus difficilement au fil des vicissitudes qui ont affecté l’histoire du Levant, au départ d’Antioche et des ports syriens et libanais vers les routes terrestres qui passaient par la Mésopotamie et la Perse pour amener les caravanes vers l’Inde ou le Cathay.
La présence des villes marchandes italiennes à Alexandrie d’Egypte donnait aussi accès au Nil, à cette artère nilotique qui plongeait, au-delà des cataractes vers les mystères de l’Afrique subsaharienne et vers le royaume chrétien d’Ethiopie. Les constats que nous induisent à poser une observation des faits géopolitiques et géostratégiques de l’histoire vénitienne et génoise devraient tout naturellement amener un concert européen sérieux, mener par des leaders lucides, à refuser tout conflit inutile sur le territoire de l’Ukraine actuelle car ce territoire donne accès aux nouvelles routes qui mènent de l’Europe occidentale à la Chine, que celles-ci soient ferroviaires (les projets allemands, russes et chinois de développement des trains à grande vitesse et à grande capacité) ou offre le transit à un réseau d’oléoducs et de gazoducs. Aucune coupure ne devrait entraver le développement de ces voies et réseaux. De même, les territoires libanais, syriens et irakiens actuels, dans l’intérêt d’un concert européen bien conçu, devraient ne connaître que paix et harmonie, afin de restaurer dans leur plénitude les voies d’accès aux ex-empires persans, indiens et chinois. Le regard vénitien ou génois que l’on pourrait jeter sur les espaces méditerranéen oriental et pontique permettrait de générer des stratégies de désenclavement.
L’Europe est ré-enclavée !
Aujourd’hui, nous vivons une période peu glorieuse de l’histoire européenne, celle qui est marquée par son ré-enclavement, ce qui implique que l’Europe a perdu tous les atouts qu’elle avait rudement acquis depuis la reconquista ibérique, la lutte pluriséculaire contre le fait ottoman, etc. Ce ré-enclavement est le résultat de la politique du nouvel hegemon occidental, les Etats-Unis d’Amérique. Ceux-ci étaient les débiteurs de l’Europe avant 1914. Après le désastre de la première guerre mondiale, ils en deviennent les créanciers. Pour eux, il s’agit avant tout de maintenir le vieux continent en état de faiblesse perpétuelle afin qu’il ne reprenne jamais plus du poil de la bête, ne redevienne jamais leur créancier. Pour y parvenir, il faut ré-enclaver cette Europe pour que, plus jamais, elle ne puisse rayonner comme elle l’a fait depuis la découverte de l’Amérique et depuis les explorations portugaises et espagnoles du 16ème siècle. Cette stratégie qui consiste à travailler à ré-enclaver l’Europe est la principale de toutes les stratégies déployées par le nouvel hegemon d’après 1918.
Même s’ils ne signent pas le Traité de Versailles, les Etats-Unis tenteront, dès la moitié des années 20, de mettre l’Europe (et tout particulièrement l’Allemagne) sous tutelle via une politique de crédits. Parallèlement à cette politique financière, les Etats-Unis imposent dans les années 20 des principes wilsoniens de droit international, faussement pacifistes, visant à priver les Etats du droit à faire la guerre, surtout les Etats européens, leurs principaux rivaux, et le Japon, dont ils veulent s’emparer des nouvelles conquêtes dans le Pacifique. On peut évidemment considérer, à première vue mais à première vue seulement, que cette volonté de pacifier le monde est positive, portée par un beau projet philanthropique. L’objectif réel n’est pourtant pas de pacifier le monde, comme on le perçoit parfaitement aujourd’hui au Levant et en Mésopotamie, où les Etats-Unis, via leur golem qu’est Daech, favorisent «l’intensification maximale du désordre ». L’objectif réel est de dépouiller tout Etat, quel qu’il soit, quelle que soient ses traditions ou les idéologies qu’il prône, de sa souveraineté. Aucun Etat, fût-il assiégé et étouffé par ses voisins, fût-il placé par ses antécédents historiques dans une situation d’in-viabilité à long terme à cause d’une précédente mutilation de son territoire national, n’a plus le droit de rectifier des situations dramatiques qui condamnent sa population à la misère, à l’émigration ou au ressac démographique. Or la souveraineté, c’était, remarquait Carl Schmitt face au déploiement de ce wilsonisme pernicieux, la capacité de décider de faire la guerre ou de ne pas la faire, pour se soustraire à des situations injustes ou ingérables.
Notamment, faire la guerre pour rompre un encerclement fatidique ou un enclavement qui barrait la route à la mer et au commerce maritime, était considéré comme légitime. Le meilleur exemple, à ce titre, est celui de la Bolivie enclavée au centre du continent sud-américain, suite à une guerre du 19ème siècle, où le Pérou et le Chili lui avaient coupé l’accès au Pacifique : le problème n’est toujours pas résolu malgré l’ONU. De même, l’Autriche, vaincue par Napoléon, est privée de son accès à l’Adriatique par l’instauration des « départements illyriens » ; en 1919, Clémenceau lui applique la même politique : la naissance du royaume de Yougoslavie lui ôte ses bases navales d’Istrie (Pola), enlevant par là le dernier accès des puissances centrales germaniques à la Méditerranée. L’Autriche implose, plonge dans la misère et accepte finalement l’Anschluss en 1938, dont la paternité réelle revient à Clémenceau.
Versailles et le wilsonisme bétonnent le morcellement intra-européen
Ensuite, pour l’hegemon, il faut conserver autant que possible le morcellement territorial de l’Europe. Déjà, les restrictions au droit souverain de faire la guerre gèle le tracé des frontières, souvent aberrant en Europe, devenu complètement absurde après les traités de la banlieue parisienne de 1919-1920, lesquels rendaient impossible tout regroupement impérial et, plus précisément, toute reconstitution, même pacifique, de l’ensemble danubien austro-hongrois, création toute naturelle de la raison vitale et historique. Ces traités signés dans la banlieue parisienne morcellent le territoire européen entre un bloc allemand aux nouvelles frontières militairement indéfendables, « démembrées » pour reprendre le vocabulaire de Richelieu et de Haushofer, et une Russie soviétique qui a perdu les glacis de l’Empire tsariste (Pays Baltes, Finlande, Bessarabie, Volhynie, etc.). Le double système de Versailles (de Trianon, Sèvres, Saint-Germain, etc.) et des principes wilsoniens, soi-disant pacifistes, entend bétonner définitivement le morcellement de la « Zwischeneuropa » entre l’Allemagne vaincue et l’URSS affaiblie par une guerre civile atroce.
La situation actuelle en découle : les créations des traités iniques de la banlieue parisienne, encore davantage morcelées depuis l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et de l’ex-Tchécoslovaquie, sans oublier le démantèlement des franges ouest de la défunte Union Soviétique, permet aujourd’hui aux Etats-Unis de soutenir les revendications centrifuges tantôt de l’une petite puissance résiduaire tantôt de l’autre, flattées de recevoir, de toute la clique néoconservatrice et belliciste américaine, le titre louangeur de « Nouvelle Europe » audacieuse face à une « Vieille Europe » froussarde (centrée autour du binôme gaullien/adenauerien de la Françallemagne ou de l’Europe carolingienne), exactement comme l’Angleterre jouait certaines de ces petites puissances contre l’Allemagne et la Russie, selon les dispositifs diplomatiques de Lord Curzon, ou comme la France qui fabriquait des alliances abracadabrantes pour « prendre l’Allemagne en tenaille », obligeant le contribuable français à financer des budgets militaires pharaoniques, notamment en Pologne, principale puissance de la « Zwischeneuropa », censée remplacer, dans la stratégie française ce qu’était l’Empire ottoman contre l’Autriche des Habsbourg ou ce qu’était la Russie lors de la politique de revanche de la Troisième République, soit un « rouleau compresseur, allié de revers », selon la funeste habitude léguée par François I au 16ème siècle. La Pologne était donc ce « nouvel allié de revers », moins lourd que l’Empire ottoman ou que la Russie de Nicolas II mais suffisamment armé pour rendre plus difficile une guerre sur deux fronts.
Depuis les années 90, l’OTAN a réduit les effectifs de la Bundeswehr allemande, les a mis à égalité avec ceux de l’armée polonaise qui joue le jeu antirusse que l’Allemagne ne souhaitait plus faire depuis le début des années 80. La « Zwischeneuropa » est mobilisée pour une stratégie contraire aux intérêts généraux de l’Europe.
Des séparatismes qui arrangent l’hegemon
Dans la partie occidentale de l’Europe, des mouvements séparatistes sont médiatiquement entretenus, comme en Catalogne, par exemple, pour promouvoir des idéologies néo-libérales (face à d’anciens Etats jugés trop protectionnistes ou trop « rigides ») ou des gauchismes inconsistants, correspondant parfaitement aux stratégies déconstructivistes du festivisme ambiant, stratégies favorisées par l’hegemon, car elles permettent de consolider les effets du wilsonisme. Ce festivisme est pleinement favorisé car il se révèle l’instrument idéal pour couler les polities traditionnelles, pourtant déjà solidement battues en brèche par soixante ou septante ans de matraquage médiatique abrutissant, mais jugées encore trop « politiques » pour plaire à l’hegemon, qui, sans discontinuer, fabrique à la carte des cocktails affaiblissants, chaque fois adaptés à la dimension vernaculaire où pointent des dissensus exploitables. Cette adaptation du discours fait croire, dans une fraction importante des masses, à l’existence d’une « identité » solide et inébranlable, ce qui permet alors de diffuser un discours sournois où la population imagine qu’elle défend cette identité, parce qu’on lui fabrique toutes sortes de gadgets à coloration vernaculaire ; en réalité, derrière ce théâtre de marionnettes qui capte toutes les attentions des frivoles, on branche des provinces importantes des anciens Etats non pas sur une Europe des ethnies charnelles, ainsi que l’imaginent les naïfs, mais sur les réseaux mondiaux de dépolitisation générale que sont les dispositifs néo-libéraux et/ou festivistes, afin qu’in fine tous communient, affublé d’un T-shirt et d’un chapeau de paille catalan ou basque, flamand ou wallon, etc. dans la grande messe néo-libérale ou festiviste, sans jamais critiquer sérieusement l’inféodation à l’OTAN.
Rendre tous les Etats « a-démiques »
Ainsi, quelques pans entiers du vieil et tenace ennemi des réseaux calvinistes/puritains anglo-américains sont encore davantage balkanisés : l’ancien Empire de Charles-Quint se disloque encore pour rendre tous ses lambeaux totalement «invertébrés » (Ortega y Gasset !). Les Bretons et les Occitans, eux, ne méritent aucun appui, contrairement aux autres : s’ils réclament autonomie ou indépendance, ils commettent un péché impardonnable car ils visent la dislocation d’un Etat occidentiste, dont le fondamentalisme intrinsèque, pure fiction manipulatrice, ne se réclame pas d’un Dieu biblique comme en Amérique mais d’un athéisme éradicateur. Les Bretons ne revendiquent pas la dissolution d’une ancienne terre impériale et européenne mais d’un Etat déjà « adémique », de « a-demos », de « sans peuple » (« a » privatif + démos, peuple en grec, ce néologisme ayant été forgé par le philosophe italien Giorgio Agamben). Il faut donc les combattre et les traiter de ploucs voire de pire encore. La stratégie du morcellement permanent du territoire vise, de fait, à empêcher toute reconstitution d’une réalité impériale en Europe, héritière de l’Empire de Charles-Quint ou de la « Grande Alliance », mise en exergue par l’historien wallon Luc Hommel, spécialiste de l’histoire du fait bourguignon. La différence entre les indépendantismes anti-impériaux, néfastes, et les indépendantismes positifs parce qu’hostiles aux Etats rénégats, qui, par veulerie intrinsèque, ont apostasié l’idéal d’une civilisation européenne unifiée et combattive, ne doit pas empêcher la nécessaire valorisation de la variété européenne, selon les principes mis en exergue par le théoricien breton Yann Fouéré qui nous parlait de « lois de la variété requise ».
Des tissus de contradictions
En Flandre, il faut combattre toutes les forces, y compris celles qui se disent « identitaires », qui ne revendiquent pas un rejet absolu de l’OTAN et des alliances nous liant aux puissances anglo-saxonnes qui articulent contre l’Europe le réseau ECHELON. Ces forces pseudo-identitaires sont prêtes à tomber, par stupidité crasse, dans tous les pièges du néo-libéralisme. En Wallonie, on doit rejeter la tutelle socialiste qui, elle, a été la première à noyer la Belgique dans le magma de l’OTAN, que les adversaires de cette politique atlantiste nommaient le « Spaakistan », rappelle le Professeur Coolsaet (RUG).
En Wallonie, les forces dites « régionales » ou « régionalistes » sont en faveur d’un développement endogène et d’un projet social non libéral mais sans redéfinir clairement la position de la Wallonie dans la grande région entre Rhin et Seine. La littérature wallonne, en la personne du regretté Gaston Compère, elle, resitue ces régions romanophones de l’ancien Saint-Empire dans le cadre bourguignon et les fait participer à un projet impérial et culturel, celui de Charles le Téméraire, tout en critiquant les forces urbaines (et donc non traditionnelles de Flandre et d’Alsace) pour avoir torpillé ce projet avec la complicité de l’« Universelle Aragne », Louis XI, créateur de l’Etat coercitif moderne qui viendra à bout de la belle France des Riches Heures du Duc de Berry, de Villon, Rutebeuf et Rabelais.
Compère inverse la vulgate colportée sur les divisions de la Belgique : il fait des villes flamandes les complices de la veulerie française et des campagnes wallonnes les protagonistes d’un projet glorieux, ambitieux et prestigieux, celui du Duc de Bourgogne, mort à Nancy en 1477. Certes Compère formule là, avec un magnifique brio, une utopie que la Wallonie actuelle, plongée dans les eaux glauques de la crapulerie politique de ses dirigeants indignes, est aujourd’hui incapable d’assumer, alors que la Flandre oublie sa propre histoire au profit d’une mythologie pseudo-nationaliste reposant sur un éventail de mythes contradictoires où se télescopent surtout une revendication catholique (le peuple pieux) contre les importations jacobines de la révolution française et une identification au protestantisme du 16ème siècle, dont les iconoclastes étaient l’équivalent de l’Etat islamiste d’aujourd’hui et qui ont ruiné la statuaire médiévale flamande, saccagée lors de l’été 1566 : il est dès lors plaisant de voir quelques têtes creuses se réclamer de ces iconoclastes, au nom d’un pannéerlandisme qui n’a existé que sous d’autres signes, plus traditionnels et toujours au sein de l’ensemble impérial, tout en rabâchant inlassablement une hostilité (juste) contre les dérives de Daech, toutefois erronément assimilées à toutes les formes culturelles nées en terres islamisées : si l’on se revendique des iconoclastes calvinistes d’hier, il n’y a nulle raison de ne pas applaudir aux faits et gestes des iconoclastes musulmans d’aujourd’hui, armés et soutenus par les héritiers puritains des vandales de 1566 ; si l’on n’applaudit pas, cela signifie que l’on est bête et surtout incohérent.
Les mythes de l’Etat belge sont eux aussi contradictoires car ils mêlent idée impériale, idée de Croisade (la figure de Godefroy de Bouillon et les visions traditionnelles de Marcel Lobet, etc.), pro- et anti-hollandisme confondus dans une formidable bouillabaisse, nationalisme étroit et étriqué, étranger à l’histoire réelle des régions aujourd’hui demeurées « belges ».
En Catalogne, la revue Nihil Obstat (n°22, I/2014), publiée près de Tarragone, rappelle fort opportunément que tout catalanisme n’a pas été anti-impérial : au contraire, il a revendiqué une identité aragonaise en l’assortissant d’un discours « charnel » que l’indépendantisme festiviste qui occupe l’avant-scène aujourd’hui ne revendique certainement pas car il préfère se vautrer dans la gadoue des modes panmixistes dictées par les officines d’Outre-Atlantique ou communier dans un gauchisme démagogique qui n’apportera évidemment aucune solution à aucun des maux qui affectent la société catalane actuelle, tout comme les dérives de la NVA flamande dans le gendérisme (made in USA avec la bénédiction d’Hillary Clinton) et même dans le panmixisme si prisé dans le Paris hollandouillé ne résoudront aucun des maux qui guettent la société flamande. Cette longue digression sur les forces centrifuges, positives et négatives, qui secouent les paysages politiques européens, nous conduit à conclure que l’hegemon appuie, de toutes les façons possibles et imaginables, ce qui disloque les polities, grandes et petites, d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie et les forces centrifuges qui importent les éléments de dissolution néolibéraux, festivistes et panmixistes qui permettent les stratégies d’ahurissement visant à transformer les peuples en « populations », à métamorphoser tous les Etats-Nations classiques, riches d’une Realpolitik potentiellement féconde, en machines cafouillantes, marquées par ce que le très pertinent philosophe italien Giorgio Agamben appelait des polities « a-démiques », soit des polities qui ont évacué le peuple qu’elles sont pourtant censées représenter et défendre.
L’attaque monétaire contre la Grèce, qui a fragilisé la devise qu’est l’euro, afin qu’elle ne puisse plus être utilisée pour remplacer le dollar hégémonique, a ébranlé la volonté d’unité continentale : on voit réapparaître tous les souverainismes anti-civilisationnels, toutes les illusions d’isolation splendide, surtout en France et en Grande-Bretagne, tous les petits nationalismes de la « Zwischeneuropa », toutes les formes de germanophobie qui dressent les périphéries contre le centre géographique du continent et nient, par effet de suite, toute unité continentale et civilisationnelle. A cette dérive centrifuge générale, s’ajoutent évidemment les néo-wilsonismes, qui ne perçoivent pas le cynisme réel qui se profile derrière cet angélisme apparent, que percevait parfaitement un Carl Schmitt : on lutte parait-il, pour la « démocratie » en Ukraine ou en Syrie, pour le compte de forces sur le terrain qui s’avèrent très peu démocratiques. Les festivismes continuent d’oblitérer les volontés et ruinent à l’avance toute reprise d’une conscience politique. Les séparatismes utiles à l’hegemon gagnent en influence. Les séparatismes qui pourrait œuvrer à ruiner les machines étatiques devenues « a-démiques » sont, eux, freiner dans leurs élans. L’Europe est un continent devenu « invertébré » comme l’Espagne que décrivait Ortega y Gasset. L’affaire grecque est le signal premier d’une phase de dissolution de grande ampleur : la Grèce fragilisée, les flots de faux réfugiés, l’implosion de l’Allemagne, centre du continent, l’absence de jugement politique et géopolitique (notamment sur le bassin oriental de la Méditerranée, sur la Mer Noire et le Levant) en sont les suites logiques.
Robert Steuckers.
Madrid, Alicante, Hendaye, Forest-Flotzenberg, août-novembre 2015.pour voir les cartes liées à cet article => http://robertsteuckers.blogspot.fr/2015/11/reflexions-sur-la-geopolitique-et.html