Jeune historien et membre d’Egalité et réconciliation, Pierre de Brague oeuvre à la redécouverte d'une expérience politique très originale au XXe siècle le Cercle Proudhon.
RIVAROL : Quelles sont les origines idéologiques du Cercle Proudhon ?
Pierre de BRAGUE : Le Cercle Proudhon est à mon sens l'incarnation française la plus aboutie qui soit (au niveau de la formulation intellectuelle), de la conjonction des deux non-dits de la matrice bourgeoise issue de 1789, à savoir cette escroquerie philosophique (les Lumières), politique (la démocratie) et économique (l'exploitation capitaliste) qui constitue notre actuelle mythologie officielle. Face à ce "système", certains ont plébiscité l'appui sur le « monde d'avant », l'Histoire et la Tradition, devenant alors d'affreux réactionnaires pour le libéralisme (dont la définition pourrait être la dictature du présent), et d'autres ont voulu bâtir le « monde d'après », arc-boutant leurs aspirations révolutionnaires sur la défense des intérêts du prolétariat, devenant alors l'alibi progressiste de toutes les compromissions socialistes...
Lorsqu'elles furent intègres, radicales et authentiques, les mouvances monarchistes et syndicalistes ont représenté, chacune à leur manière, la quintessence des alternatives à cette "civilisation" bourgeoise. Ainsi de l'Action Française et du syndicalisme révolutionnaire. Le Cercle Proudhon est la réunion de certains militants — à mes yeux les meilleurs éléments de ces organisations , la crème de la crème de la radicalité patriote une sorte d'union sacrée anti-démocratique, anti-capitaliste, anti-bourgeoise et anti-Lumières qui nous apparaît impensable au premier abord, mais qui se révèle conforme à ce que le véritable « esprit politique français » a produit (et doit produire) de manière plus ou moins explicite au fil des époques.
R. : Pourquoi reprendre Proudhon comme figure tutélaire ?
P. de B. : A première vue, rien de plus éloigné des monarchistes catholiques de l'AF et des syndicalistes révolutionnaires que le supposé anarchiste libertaire se revendiquant de 1789 que serait Pierre-Joseph Proudhon. Mais c'est se borner aux délimitations malhonnêtes du conditionnement intellectuel de ne pas faire l'exégèse profonde de l'homme et de son œuvre. Le Cercle ne tombe évidemment pas dans cet écueil et s'il peut arborer légitimement le sulfureux patronage du penseur franc-comtois c'est par une fidélité quasiment métapolitique à « l'esprit proudhonien », cet esprit parfaitement français, à la fois traditionnel et révolutionnaire, qui, par une vive et libre opposition des antagonismes, se transcende et trouve l'équilibre, cette notion fondamentale à la richesse insoupçonnée (et pour le coup quasiment métaphysique).
Si l’on s'en tient aux théories, Proudhon, par son fédéralisme, son mutualisme, sa critique acide de la démocratie et de la propriété capitaliste, ainsi que son caractère de farouche pourfendeur de la culture bourgeoise, a su permettre — malgré les tentatives de récupération des socialistes républicains- « à des Français, qui se croyaient ennemis jurés, de s'unir pour travailler de concert à l'organisation du pays français ». Nous touchons là un point essentiel Proudhon était un homme d'ordre et non cet anti-étatiste anti-théiste et anti-propriétaire primaire que l’on veut nous faire accroire... C'est en tant que prophète de « l'ordre social français » que les membres du Cercle célèbrent ce « grand réaliste », ce « Maître de la contre-révolution », ce « Proudhon constructeur » à l'esprit et à la foi révolutionnaire. J'arrête ici, c'est certainement déjà trop de dialectique pour les quelques placides intellectuels de "gôche" qui prétendent s'accaparer la figure de ce rude fils de paysan, viril et guerrier, inaltérable et hardi défenseur du Travail de la la Famille et de la Terre (qui a dit Patrie ?), je ne voudrais pas être désigné responsable de l'ataraxie mentale dont ils souffrent, si peu nombreux soient-ils.
R. : Cette alliance de royalistes et de syndicalistes révolutionnaires a-t-elle reçu le soutien de leurs "maîtres" Charles Maurras et Georges Sorel ? Quelles furent les principaux animateurs du cercle ?
P. de B. : Allons immédiatement, si vous le voulez bien, au fond du sujet : Proudhon, Maurras et Sorel, incarnent pleinement et précisément, chacun à leur manière, avec des variations et des idiosyncrasies propres que nous n'ôterons pour rien au monde à l'histoire et à la fortune de l'humanité — cet « esprit politique français » si précieux à mes yeux. Ils le personnifient par leurs "êtres", par leurs pensées, par leurs authenticités mêmes. Ils sont, ensemble et chacun de leur côté, cet esprit révolutionnaire conservateur français qui configure certainement le pire affrontement possible pour la pseudo-"civilisation" ploutocratique actuellement bourgeoise et soi-disant démocratique et libérale dans laquelle nous baignons depuis bien trop longtemps.
Pour être concret tout en restant succinct que Ton songe aux conjonctions profondes qui animent cette si belle triade. Que ce soit sur l'Action, sur l'Intelligence, sur l'Organisation ou même sur l'État, les concordances, les filiations, les accords, les rapprochements et les frottements sont finalement pregnants ! Et ce jusqu'à constituer une philosophie politique véritablement française, foncière et radicale, qui se définirait par la recherche de l'organisation sociale qui rendra le plus justice à la dignité des travailleurs français et à la défense de leurs libertés et de leurs intérêts spirituels et matériels. J'invite le lecteur à reprendre un par un les mots de cette dernière phrase et à y déceler une quelconque résonance avec notre contemporanéité…
Il n’y avait donc aucun problème de fond à ce que Maurras et Sorel soutinssent initiative de leurs meilleurs (ou atypiques selon l'angle de vue) disciples, surtout lorsqu'elle se fit sous ce glorieux patronyme de Proudhon. Cessons ici tout essentialisme pour revenir aux réalités et aux contextes il n'était pas question pour les "maîtres" de fusionner leurs mouvements ou de participer activement et personnellement à ce genre d'"expériences" conférant pratiquement à l'aventure. Les maîtres respectifs sont restés à l'écart, en retrait, accompagnant d'abord avec entrain et bienveillance, mais également avec méfiance, la "tentative" du Cercle Proudhon. Notons néanmoins que c'est Sorel qui a fait le premier pas "officiel" dès 1908 dans une revue syndicaliste italienne en dressant l'éloge pragmatique de l’AF, considérée alors comme une vraie force vivante pour l'avenir de la France. Remarquons aussi que Maurras prononça une allocution à la première réunion du Cercle, qui fut tenue à l'Institut d'Action Française, donc dans ses locaux, le 17 décembre 1911 Dans la pure lignée de cet « esprit proudhonien », à l'instar, et peut-être plus encore que leurs aînés, Georges Valois et Edouard Berth furent les principaux protagonistes du Cercle, lui donnant une vie et une aura rares, représentant et formulant magnifiquement la Combativité et la Vitalité française, comme, ai-je l'impression, la France savait — malgré tout — encore en produire il y a quelques décennies... Citons les autres fondateurs et participants rédacteurs aux Cahiers du Cercle Henri Lagrange, Gilbert Maire, René de Marans, Marius Riquier, André Pascalon et Albert Vincent.
R. : Le rejet de la Démocratie est-il commun aux deux mouvances ?
P. de B. : Et comment ! Qualifiée de « plus grande erreur au siècle passé », de « maladie mortelle » et de « plus sotte des rêveries », la démocratie est mise en cause par ces deux écoles pour des raisons propres qui sont finalement similaires. À droite, on rejette la république démocratique car c'est le régime et le système politique de l'avènement de la classe bourgeoise, soit ce gouvernement des intérêts étrangers et anti-traditionnels, et à gauche parce que c'est l'alibi majeur de l'exploitation capitaliste. Le Cercle va directement à l'essentiel en attestant de la consubstantialité des institutions démocratiques, des "valeurs" bourgeoises et de la domination socio-économique.
La démocratie libérale bourgeoise est explicitement vomie en tant que "totalité" pour des raisons politiques et économiques, et en dernière instance parce qu'elle n'est que le symbole d'une vision du monde hypocrite et mortifère. Si l'on accepte de l'utiliser comme un terme générique, cette Démocratie (qui est encore la nôtre aujourd'hui) n'est qu'une fable avilissante, abrutissante, précaire, anti-Production et anti-Culture. « Ramenée parmi nous pour instaurer le règne de la vertu, elle tolère et encourage toutes les licences. Elle est théoriquement un régime de liberté ; pratiquement elle a horreur des libertés concrètes, réelles et elle nous a livrés à quelques grandes compagnies de pillards, politiciens associés à des financiers ou dominés par eux, qui vivent de l'exploitation des producteurs. » Voilà comment le Cercle Proudhon définissait la démocratie dans sa première Déclaration !
R. : Les animateurs du cercle insistaient sur les vertus viriles, vitalistes et héroïques. L'aspect guerrier était-il au coeur de la démarche de ce groupe ?
P. de B. : Proudhon restera l'immortel auteur de La Guerre et la Paix, ouvrage majeur par lequel il établit que toute construction humaine — et toute humanité — tient son origine dans la guerre. Il s'agit ici d'exalter le sentiment guerrier, mobilisateur, générateur « du sublime, de la gloire, de l'héroïsme, de l'idéal et de la poésie » et non de vanter la barbarie ou les va-t-en-guerre. Cet esprit combattant se retrouve transposé chez Sorel via ses Réflexions sur la Violence et le mythe de la « grève générale » où l'ouvrier devient le nouveau héros ; quant à Maurras et son Si le Coup de Force est possible, les vertus aristocratiques qu'il défend ne pouvaient que tomber en accord avec cet aspect. Tout ceci évidemment en opposition dialectique avec les pseudo-"valeurs" bourgeoises bien-pensantes hypocrites et maniérées que seraient le pacifisme, l'humanitarisme et l'intellectualisme.
R. : L'équipe de rédaction n'hésitait pas à attaquer la finance anonyme et vagabonde. En quoi l'anti-capitalisme était-il un élément fondamental de la démarche du cercle ?
P. de B. : Anonyme, anonyme. Pas tant anonyme que ça si l'on en croit certains textes ! L'anti-capitalisme est effectivement un élément fondamental de la démarche du Cercle, au même titre que l'anti-démocratisme, et pour cause ils sont indissociables, et ce constat n'a pas échappé aux militants du Cercle, bien au contraire. Admettant l'alliance des démocrates et des financiers, comme aujourd'hui celle des socialistes bobos et des néo-libéraux bling-bling, le Cercle y oppose une alliance des royalistes et des syndicalistes révolutionnaires, et ce sans forcer sa cohésion car la mise à bas du « régime de l'Or » (par opposition au "Sang") est une thématique forte chez les partisans de Maurras. Georges Valois lui-même, le principal initiateur du Cercle, la « recrue prolétarienne » de l’AF, fut toute sa vie durant l'homme d'un combat, celui de l'Humain contre l'Argent, et ce quoi que l'on en dise.
Citons encore une fois la si concise prose du Cercle « La démocratie enfin a permis, dans l’économie et dans la politique, le rétablissement du régime capitaliste qui détruit dans la cité ce que les idées démocratiques dissolvent dans l’esprit, c'est-à-dire la nation, la famille, les mœurs, en substituant la loi de l’or aux lois du sang. La démocratie vit de l'or et d'une perversion de l’intelligence. » Nous retrouvons ici le véritable moteur métapolitique du Cercle c'est le combat de la Vie et de la Civilisation contre son placebo fantoche aliénant et destructeur.
R. : L'accusation d'antisémitisme lancée contre le Cercle Proudhon est-elle valable ? Plus largement, comment analysez-vous l’antijudaisme présent dans le mouvement ouvrier de la fin du XIXe siècle ?
P. de B. : l’antijudaïsme du mouvement ouvrier, comme celui du Cercle Proudhon, de Proudhon lui-même ou de beaucoup d'autres, fut rarement racial ou théologique. La question juive s'y présente comme un problème essentiellement économique et social, perçu sous l'angle de la lutte des classes. Concernant le Cercle, si attester de la place prééminente de la bourgeoisie juive dans la société française suite à sa prise de pouvoir au sein même de cette classe bourgeoise (par l'instauration de la république démocratique) est un fait suffisant pour être taxé d'antisémitisme, alors oui le Cercle est antisémite !
R. : Pour vous, en quoi consiste le mélange de Réaction et de Révolution qui incarne l'esprit français ?
P. de B. : Il convient de manier les termes avec exactitude, comme dirait un certain Professeur. II est question de Tradition et non de Réaction. Comme explicité plus haut, toute la vérité de cet « esprit français » résulte de la libre opposition des antagonismes, que ce soit au point de vue politique ou individuel. Ce qui, à mon avis, définit le mieux l'esprit français tient en un mot l'équilibre, auquel nous devons impérativement accoler une qualité chérie par Proudhon lui-même, je veux parler de l'ironie. Définition simple mais subtile, et qui se décline à une multiplicité de niveaux. En dehors de ses théorisations politiques, Proudhon devient ici le symbole de la France éternelle, celui qui mêle « esprit classique et christianisme fondamental », ce révolutionnaire patriote, ce gaulois frondeur et spirituel, ce mélange unique et réussi entre la rudesse et la légèreté. Un « miracle français » reconnu dans le monde entier et qui engendrait, il y a encore peu de temps, une vision du monde, une identité et une mentalité propres que les agressions répétées du libéralisme mondialisé anti-humain ont mis à mal, illustrant cette « mutation anthropologique » que Pasolini constatait dans son pays dès les années 1970. Faire revivre l'esprit de la France, voilà ce qui importe !
Propos recueillis par Monika BERCHVOK. Rivarol 30 avril 2015
A lire
Les Cahiers du Cercle Proudhon, préface de Pierre De Brague, Editions Kontre Kulture (http://www.contrekulture.com/), 2014, 496 pages — 18 euros.
Le numéro 68 de la revue Rébellion avec un important dossier sur Sorel, le syndicalisme révolutionnaire français et le Cercle Proudhon (5 euros - Rébellion c/o RSE BP 62124 31020 Toulouse cedex 02).
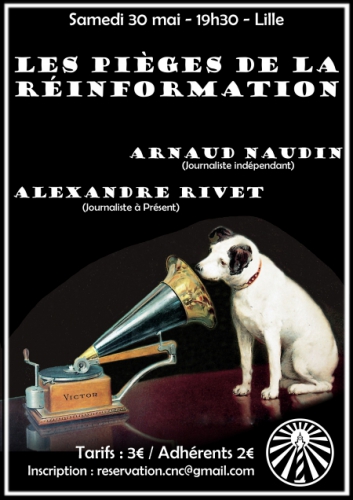
 Détails sur le produit :
Détails sur le produit :