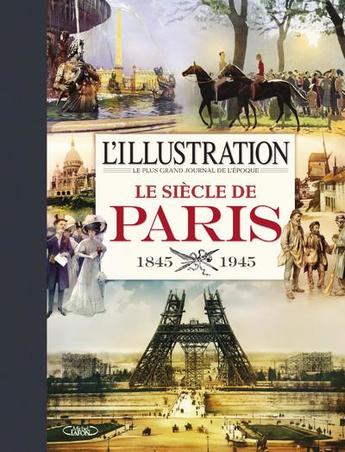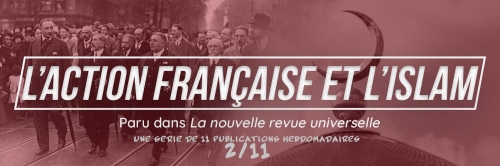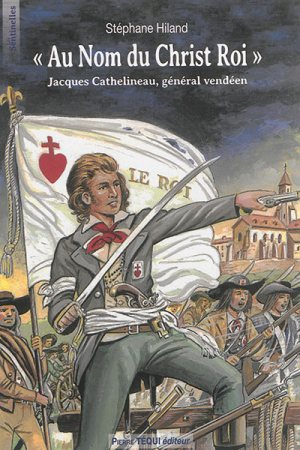Le cas finlandais
L’agitation débridée des bolcheviks en faveur de la sécession des nations les frappa eux-mêmes, dès 1918, comme par un retour du boomerang. C’est ainsi que la Finlande, généreusement affranchie par Lénine, sitôt qu’elle en eût terminé chez elle avec le “droit des travailleurs à disposer d’eux-mêmes” fit connaître ses prétentions territoriales, lesquelles englobaient des régions qui n’avaient même jamais appartenu aux Finnois (Petchenga, la Carélie orientale, Petrozavodsk et même Petrograd) . Cette erreur de calcul fut finalement payée par la cession, en 1920, de Petchenga à la Finlande. Au reste, les choses ne se présentaient pas mieux dans les territoires restés sous domination bolchevique. En mars 1918, Staline écrivit avec humeur que les régions périphériques étaient incapables de se prononcer « clairement et distinctement sur les formas concrètes d’une fédération ».