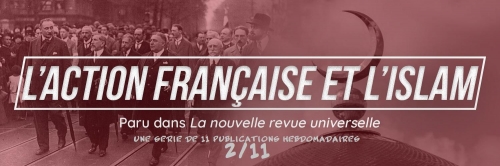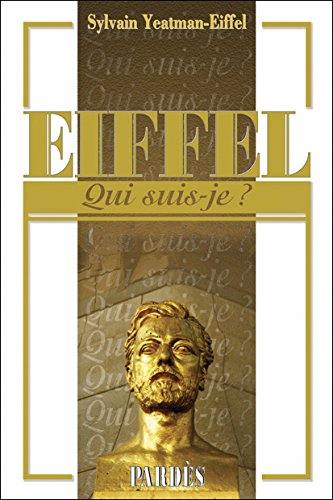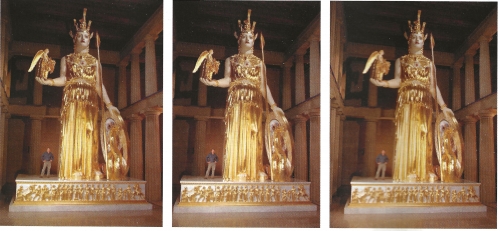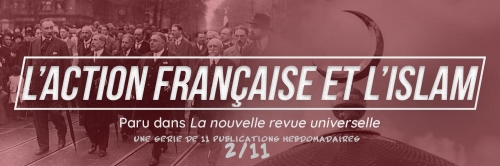
Quatre générations actives, porteuses de solutions originales
Par PHILIPPE LALLEMENT
Nous avions annoncé que cette série d’articles sur « l’Action Française et l’Islam » paraitrait chaque mercredi. Exceptionnellement, celui-ci parait accidentellement vendredi mais à partir de mercredi prochain, vous pourrez suivre cet important dossier réalisé par Philippe Lallement chaque mercredi. (NDLR)
Quatre générations actives, porteuses de solutions originales Pour tenter d’y voir plus clair, il faut remonter un peu en arrière. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale en 1918 – alors qu’avec la disparition de l’Empire ottoman, l’effervescence du monde arabe amorçait le grand réveil de l’Islam – le sort de la population musulmane d’Algérie est devenu, et n’a plus cessé d’être, pour la France, un enjeu politique majeur. Mais la République s’est montrée incapable d’une politique[1] suivie. Au gré des majorités et des opportunités successives, les deux modèles antagonistes de l’inclusion et de l’assimilation ont alterné selon un rythme quasi trentenaire : en 1936, encore dans le cadre colonial, sort le projet Blum-Viollette ; en 1959, c’est la décolonisation, De Gaulle impose sa politique d’abandon ; en 1989, l’immigration débordante et hors-contrôle provoque l’avis du Conseil d’État sur le port du voile ; en 2021, entre l’inquiétude croissante de la population et l’inaptitude patente du régime à affronter le problème, l’islamisme prend partout ses marques.