A l’occasion de la parution de son roman La fête est finie (Denoël), l’écrivain Olivier Maulin a accordé un entretien à la Revue Limite. Nous en publions ci-dessous cet extrait, qui porte sur la notion de progrès.
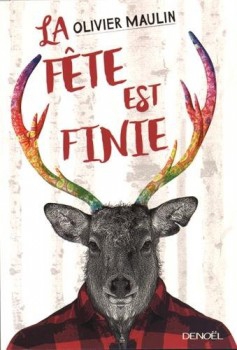 Limite : Dans la lignée de vos autres romans, La fête est finie s’apparente à une fable de la lutte contre le progrès. On vous classe sans trop se tromper parmi les antimodernes. Pourquoi ce thème du progrès est-il sous-jacent à l’ensemble de votre œuvre ?
Limite : Dans la lignée de vos autres romans, La fête est finie s’apparente à une fable de la lutte contre le progrès. On vous classe sans trop se tromper parmi les antimodernes. Pourquoi ce thème du progrès est-il sous-jacent à l’ensemble de votre œuvre ?
Olivier Maulin : Je crois que la question du progrès est absolument centrale et affreusement mal traitée aussi bien par ses partisans que par ses opposants (ou ce qu’il en reste). Comme l’a montré Jacques Ellul, chaque progrès implique un gain et une perte. Comme les deux faces d’une même médaille, chaque progrès charrie son lot de construction, son bénéfice, mais aussi son lot de destruction, son maléfice, et ceci en dépit de l’utilisation que l’on en fait.
Un exemple tout bête : les centres commerciaux qui ont fleuri ces dernières décennies dans les petites villes de province ont permis aux habitants d’avoir un accès moins coûteux aux biens de consommation, donc une augmentation de leur pouvoir d’achat (bénéfice) mais ils ont dans le même temps asséché les centres-villes et détruit une sociabilité et un mode de vie convivial (maléfice). Seuls les imbéciles croient que le progrès est univoque et que seule une mauvaise utilisation du progrès le rend préjudiciable.
Vous ne trouverez aucun progrès qui soit simplement « positif ». Certains apportent à la société des bénéfices qui dépassent ce qu’ils lui retirent. Mais d’autres apportent des bénéfices qui sont moindres que ce qu’ils détruisent. Ces derniers sont donc clairement nuisibles et s’ils sont imposés quand même, c’est parce que certains y ont un intérêt.
A chaque changement, il convient donc de s’interroger : « Sommes-nous prêts à perdre telle ou telle chose ? Est-ce que ce que l’on va gagner vaut vraiment le coup ? Jusqu’où sommes-nous capables de sacrifier ce qui nous constitue ? » C’était exactement le débat que l’on aurait dû avoir lorsque les Suisses ont voté par référendum il y a quelques années contre l’immigration massive. Au lieu de ça, toute la presse française leur est tombée dessus sur le mode « vous vous tirez une balle dans le pied, l’immigration est une chance pour l’économie ». Or, les Suisses ont simplement dit : oui, l’immigration est peut-être une opportunité économique (ce qui n’est du reste pas certain) mais nous sommes prêts à renoncer à ce bénéfice dans la mesure où le maléfice qui va avec (la perte de notre mode de vie et de notre identité) est une perte trop importante.
C’est finalement la même chose dans mon livre, les habitants de la vallée ne veulent pas de cette fameuse « croissance » qui prend la forme d’une décharge industrielle et d’un Center park débile. Ils estiment qu’ils ont trop à perdre, en dépit des emplois que va créer ce projet. Ces personnages enracinés ne veulent pas abandonner leur mode de vie, leur âme, ni voir leur vallée défigurée par le béton. C’est ce qui les conduit à prendre le chemin du combat.
Aujourd’hui, le vrai problème du progrès, c’est qu’il est divinisé. Nous le vénérons et l’approuvons quel qu’il soit dans un réflexe pavlovien dénué de tout sens critique. Il ne s’agit pas de rejeter le progrès en bloc, dans une attitude réactionnaire tout aussi pavlovienne, mais je crois que l’on devrait tout simplement le questionner. Pour cela, il faudrait le retirer des mains des experts « qui savent ce qui est bon pour nous » (et qui la plupart sont salariés de l’industrie productrice de ce progrès) et le mettre en débat sur la place publique. Le jeter dans l’Agora avec ses implications dévoilées. S’il y avait donc une révolution mentale à opérer dans notre société, elle tiendrait dans ces termes : donnons-nous les moyens de questionner le progrès, nous n’en serons que plus heureux !