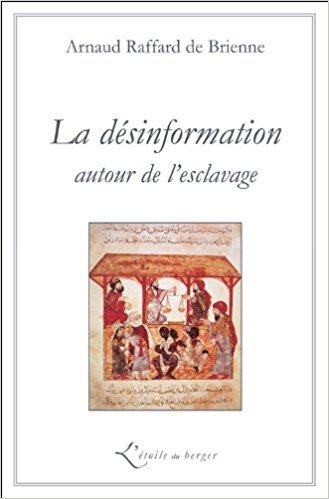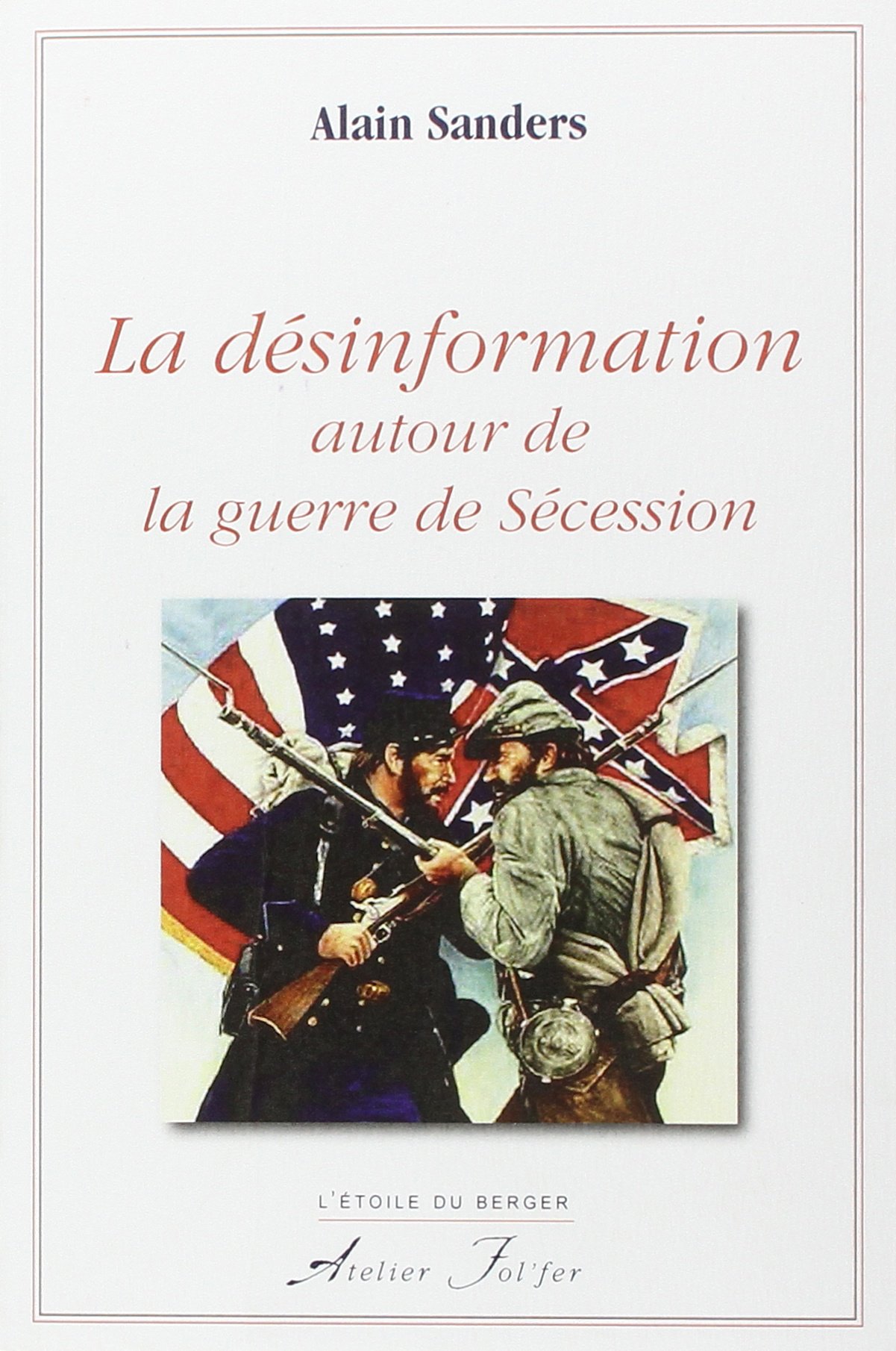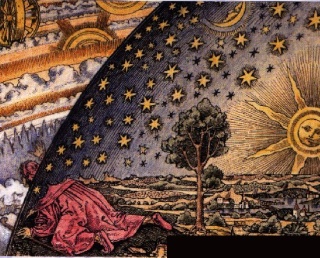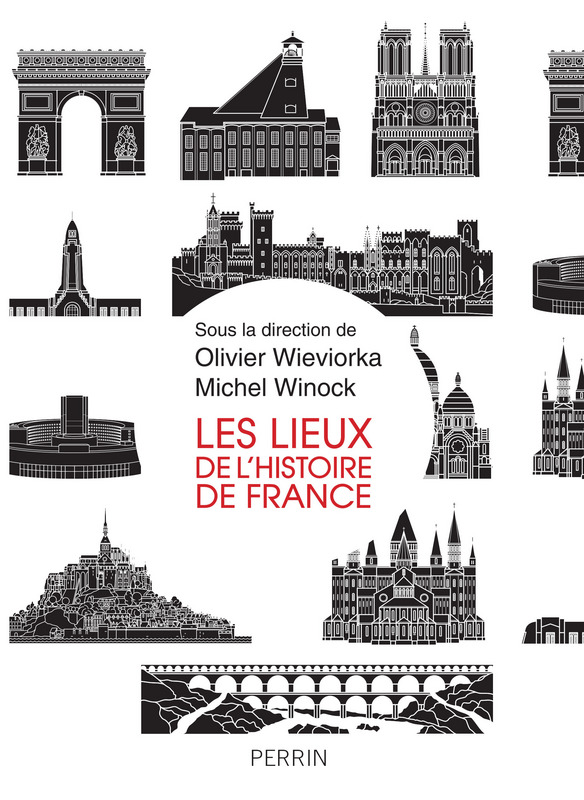Pour répondre à Luther -encore vivant- l’Église réunit à Trente, au Tyrol, un concile qui durera 18 ans et précisera le dogme catholique sur la liberté et la grâce. Institués pour propager au monde les canons du concile, les jésuites vont répandre le savoir par leurs collèges en Europe. Puis ils vont aller au Nouveau monde où ils s’opposeront, comme d’autres catholiques avant eux, à la barbarie de la colonisation qui voit les indigènes comme devant être asservis aux intérêts marchands. La réforme catholique née au Concile de Trente propagera ce qu’on pourra appeler l’humanisme chrétien.
http://re-histoire-pourtous.com/le-concile-de-trente-et-la-reforme-catholique/