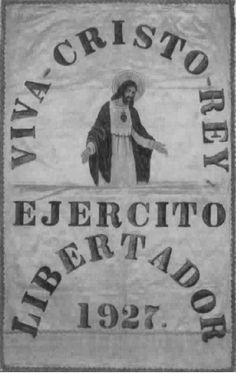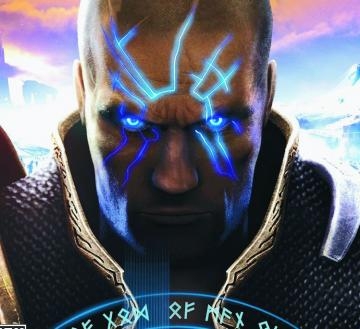L’histoire, une façon pour l’homme de devenir
Par suite, l’histoire n’est nullement à définir comme une suite d’événements ou de faits sans enchaînements, comme la simple succession des générations ; elle n’est pas non plus un “spectacle” ou un “objet de culte”. Elle est la perpétuelle transformation des sociétés par cette conscience historique qui est un spécifique de l’homme. L’histoire est la façon de devenir de l’homme : l’homme en tant qu’homme devient historiquement — et ce devenir ne dépend que de lui seul. Le “sens de l’histoire” n’est pas indépendant de sa volonté. Se demander quel est le sens de l’histoire, c’est se demander si l’homme lui-même a un sens : l’histoire prend un sens par rapport à la perspective la plus forte que l’homme institue sur elle. Dans cette conception qui nous est proposée par Nietzsche, l’homme est le seul qui fasse l’histoire — non en tant qu’il s’inclut dans une classe ou qu’il satisfait aux prescriptions d’une dogmatique, mais en tant qu’homme totalement libre, non déterminé, trouvant en lui-même seulement la possibilité d’être plus que lui-même.
Lire la suite