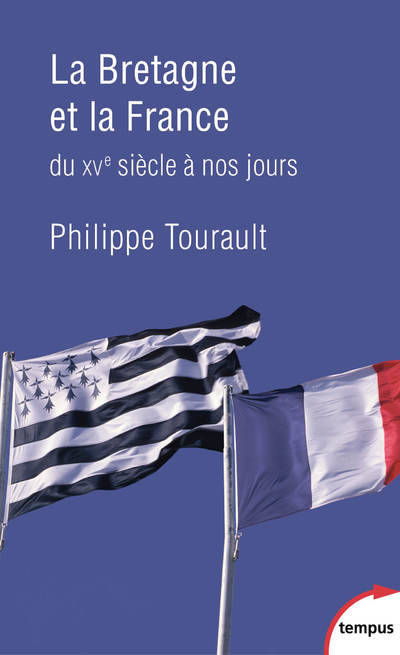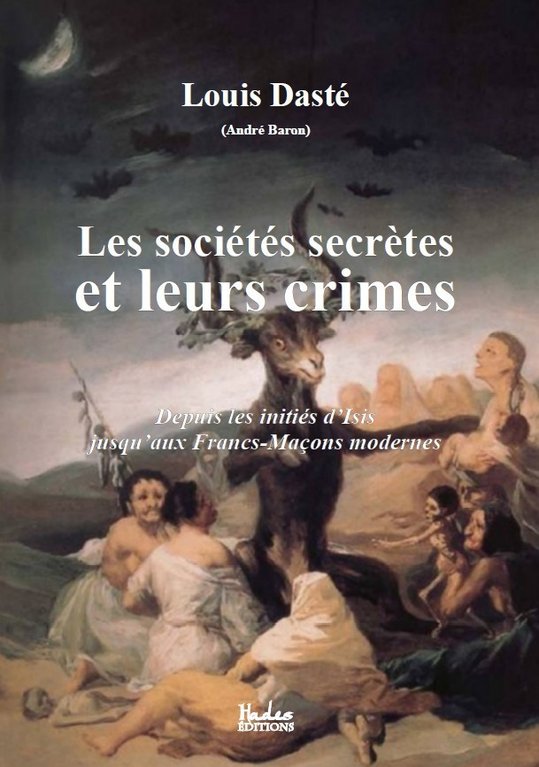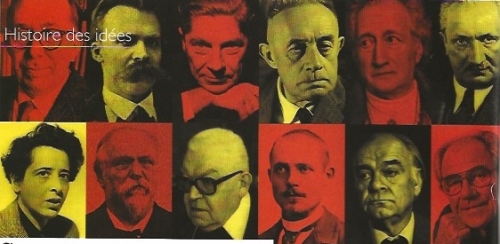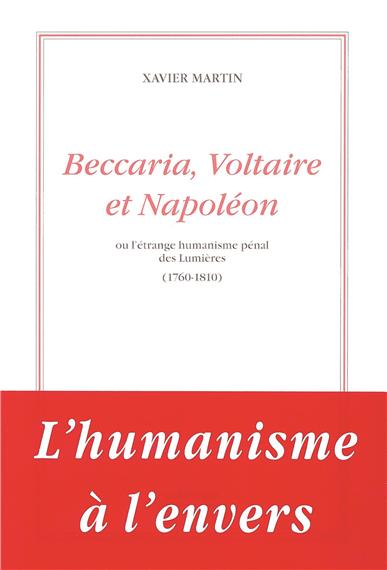Jean Lacouture, dans le premier tome de son De Gaulle, fait la part belle au colonel Mayer et à son cercle dans la formation intellectuelle du général. Certaines bonnes pages de cette somme sont d’ailleurs parues dans Le Nouvel Observateur sous le titre « L’homme qui a fait de De Gaulle un rebelle ». Cette annonce est quelque peu exagérée. Certes, le saint-cyrien de 1913 peut donner de lui une image assez conventionnelle dans ses carnets et correspondances, celle d’un jeune officier de la droite catholique.
Pourtant, son adhésion résolue à la République traduit déjà une évolution nette par rapport à sa famille. Il est abonné aux Cahiers de la quinzaine (1900-1914) de Péguy, l’auteur de Victor-Marie, comte Hugo et de la Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne. Les convergences entre de Gaulle et Péguy ont été maintes fois soulignées sans qu’il soit nécessaire de revenir sur ce sujet. Péguy, déçu par la gauche des combats dreyfusards, ne rejoint pas le camp des conservateurs. Il privilégie la mystique de l’idée républicaine et c’est sur ce terrain que de Gaulle peut le rejoindre.