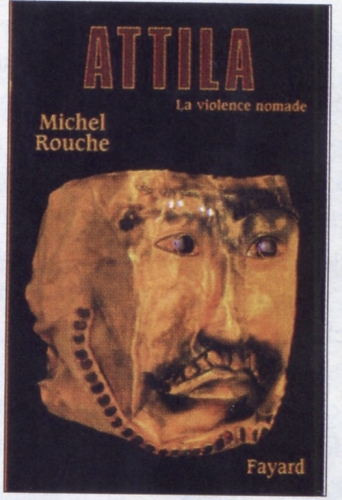 Dans une biographie de haute volée, Michel Rouche nous fait revivre l'affrontement entre deux civilisations un empire romain décadent et un peuple nomade dirigé par un certain Attila.
Dans une biographie de haute volée, Michel Rouche nous fait revivre l'affrontement entre deux civilisations un empire romain décadent et un peuple nomade dirigé par un certain Attila.
Attila ? Le nom fait frémir et nous renvoie aux incursions barbares décrites dans les manuels scolaires de la Troisième République, qui sacrifia au romantisme et, tout particulièrement, à celui de la défaite. La Petite Histoire de France de Bainville n'est d'ailleurs pas exempte des clichés du temps : « Ce fut une époque sombre et désolée où personne n’était sûr de retrouver sa maison ni de garder la vie sauve. De ces invasions, la plus terrible fut celle des Huns (…) Avec leur peau noire et leurs grandes oreilles, ils ressemblaient à des diables ou à des ogres. Ils ne faisaient même pas cuire leur viande et la mangeaient crue après l'avoir écrasée sous leur selle. On appelait Attila, leur roi, le « fléau de Dieu ». Et l'on disait que l'herbe ne poussait plus où il avait passé. »
/image%2F0931521%2F20201010%2Fob_417d18_hannah-arendt.jpg)
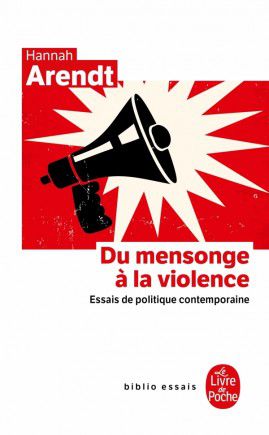 L'oeuvre : Hannah Arendt propose une réflexion générale sur le politique, à travers ses concepts fondamentaux. Elle étudie le rôle du mensonge et des techniques d'intoxication, et la manière de les combattre. Elle développe sa réflexion sur la notion de violence, sur les relations entre une structure étatique et les formes de contestation qui peuvent s'y opposer : la désobéissance civile, dont elle montre le développement aux Etats-Unis, et son importance à côté des voies classiques de recours et de contestation ; la violence des révoltes, dans les pays gouvernés par un régime totalitaire où se développe la bureaucratie.
L'oeuvre : Hannah Arendt propose une réflexion générale sur le politique, à travers ses concepts fondamentaux. Elle étudie le rôle du mensonge et des techniques d'intoxication, et la manière de les combattre. Elle développe sa réflexion sur la notion de violence, sur les relations entre une structure étatique et les formes de contestation qui peuvent s'y opposer : la désobéissance civile, dont elle montre le développement aux Etats-Unis, et son importance à côté des voies classiques de recours et de contestation ; la violence des révoltes, dans les pays gouvernés par un régime totalitaire où se développe la bureaucratie. Les éditeurs « installés » ne pourraient plus sortir des romans dont l’intrigue, y compris fictive, risquent de contredire la bienséance mémorielle et le dogmatisme historique officiel. C’est le cas pour L’appel du 17 juin d’André Costa paru à l’automne 1980.
Les éditeurs « installés » ne pourraient plus sortir des romans dont l’intrigue, y compris fictive, risquent de contredire la bienséance mémorielle et le dogmatisme historique officiel. C’est le cas pour L’appel du 17 juin d’André Costa paru à l’automne 1980. À en croire Robert Spaemann, ancien professeur de philosophie à l'Université de Munich, Louis de Bonald nous a joué un drôle de tour. Ce chantre de la contre-révolution, alter ego de Joseph de Maistre serait, en fait, un moderne qui s'ignore.
À en croire Robert Spaemann, ancien professeur de philosophie à l'Université de Munich, Louis de Bonald nous a joué un drôle de tour. Ce chantre de la contre-révolution, alter ego de Joseph de Maistre serait, en fait, un moderne qui s'ignore. L'historien Yves Chiron publie une biographie novatrice de l'auteur des Pensées et des Provinciales. On y découvre un Blaise Pascal plus complexe et complet que ce qu'en laisse connaître son image traditionnelle.
L'historien Yves Chiron publie une biographie novatrice de l'auteur des Pensées et des Provinciales. On y découvre un Blaise Pascal plus complexe et complet que ce qu'en laisse connaître son image traditionnelle.