
Par Pierre Debray
C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, dont nous commençons aujourd'hui la publication. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'étalera sur une dizaine de jours. Ceux qui en feront la lecture en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR
L’essai que Paul Sérant consacre au « Romantisme fasciste »* a sans doute le mérite de lever un tabou.
Qu’on le veuille ou non, le fascisme s’inscrit dans l’histoire contemporaine et il importe d’en traiter objectivement, comme d’un fait. Paul Sérant expose le dossier. Il ne plaide, ni davantage ne requiert. Tant de sérénité surprendra et peut-être choquera. Elle n’a de sens que si l’on est persuadé, comme c’est le cas pour Paul Sérant, que le fascisme appartient à un passé désormais révolu. On ne parle avec tant de détachement que des morts. Je crois d’ailleurs que, sur ce point, Sérant se trompe, et que le fascisme demeurera, longtemps encore, la tentation permanente de l’Europe.

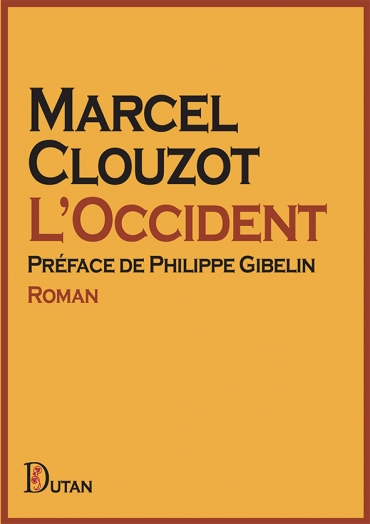

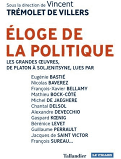 Je le dis très franchement: ce livre est un authentique petit bijou. Il a pour ambition de présenter les grandes œuvres de la philosophie politique dans le contexte de leur époque tout en mettant en valeur leur apport à la compréhension du temps présent. Moi même ai eu l’honneur d’y être associé à travers le chapitre sur Thomas Hobbes, le philosophe de la peur, qui montre comment Leviathan (l’Etat) a été inventé par les hommes pour assurer leur sécurité.
Je le dis très franchement: ce livre est un authentique petit bijou. Il a pour ambition de présenter les grandes œuvres de la philosophie politique dans le contexte de leur époque tout en mettant en valeur leur apport à la compréhension du temps présent. Moi même ai eu l’honneur d’y être associé à travers le chapitre sur Thomas Hobbes, le philosophe de la peur, qui montre comment Leviathan (l’Etat) a été inventé par les hommes pour assurer leur sécurité. 
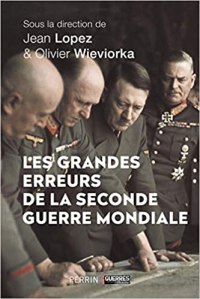 « Les grandes erreurs de la seconde guerre mondiale » aborde les années 1939-1945 sous un angle inattendu: celui des grandes erreurs politiques, diplomatiques et militaires qui ont marqué l’histoire de ce conflit. Le résultat est fascinant. L’ouvrage, réalisé par 12 auteurs sous la direction de deux spécialistes de cette époque, Jean Lopez et Olivier Wieviorka nous fait redécouvrir l’apocalypse à travers les fautes majeures, commises dans un camp ou dans l’autre.
« Les grandes erreurs de la seconde guerre mondiale » aborde les années 1939-1945 sous un angle inattendu: celui des grandes erreurs politiques, diplomatiques et militaires qui ont marqué l’histoire de ce conflit. Le résultat est fascinant. L’ouvrage, réalisé par 12 auteurs sous la direction de deux spécialistes de cette époque, Jean Lopez et Olivier Wieviorka nous fait redécouvrir l’apocalypse à travers les fautes majeures, commises dans un camp ou dans l’autre.