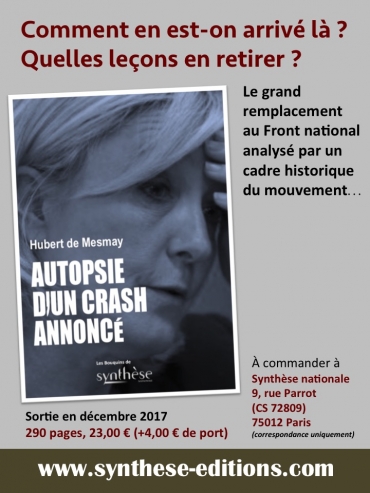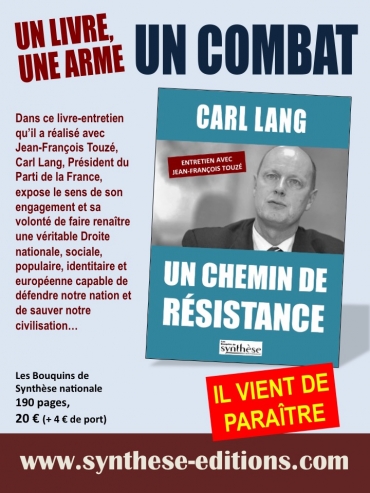L’adage « Rex est Imperator in regno suo », autrement dit, « le roi de France est empereur en son royaume » dénonce la volonté de consolider le positionnement du roi de France durant l’époque de l’Europe médiévale, ainsi que dans son royaume. Cet adage est initialement attribué à Jean de Blanot, juriste du XIIIe siècle ayant œuvré à la justification et la réaffirmation du pouvoir du roi de France, et notamment de la souveraineté du royaume de France. Le siècle qui suit est le théâtre de nombreux événements majeurs dans l’histoire de l’Europe du moyen Age. En effet, nombreux sont les bouleversements politiques comme le déclin du Saint empire romain germanique ou la guerre de cent ans dont l’origine réside dans des querelles dynastiques entre la couronne de France et celle d’Angleterre. C’est donc un siècle rythmé par la guerre et les projets de reconquête, puisque la Reconquista de la péninsule ibérique entamée au XIIIe siècle se poursuit. C’est également le siècle de graves crises notamment de 1347 à 1350 où la peste et la famine frappent violemment les populations européennes, décimant entre un quart et un tiers de sa population. En outre, la notion même de souveraineté naît en 1215, à la suite de la bataille de Bouvines, lorsque le roi de France Philipe Auguste remporte la victoire face à la coalition menée par Jean sans terre et l’empereur Otton IV du Saint empire romain germanique. Cet événement dénote l’ambition de certains puissants monarques européens, cherchant à surpasser le pouvoir du roi de France dès le début du XIIIe siècle, qui s’accentue jusqu’au XIVe siècle et se trouve à l’origine de tensions entre les différentes grandes puissances, dont certaines sont en perte de vitesse et ainsi menacées de disparaitre. Ces tensions sont tout d’abord causées par un affaissement du pouvoir universaliste. Il est vrai, deux pouvoirs ont la prétention de tendre vers un modèle universaliste, à savoir d’une part le Saint empire romain germanique et d’autre part l’Eglise catholique romaine. Ces deux puissances aspirent à atteindre une supériorité incontestable face à certains puissants royaumes. Face à cette menace latente, certains royaumes se sentent menacés et cherchent à se protéger. Ainsi donc le royaume de France, qui veut se préserver des pouvoirs extérieurs et en particulier des deux pouvoirs universalistes. Il ne manque pas d’user de tous les moyens pour assurer sa protection. Cette lutte s’intensifie tout au long du siècle. Malgré la volonté de réformer l’Empire, les empereurs ne parviendront pas à réhabiliter leur suprématie d’antan. L’ultime tentative de réforme sera celle de Charles IV de Luxembourg et sa bulle d’or. Ultime échec. Durant le XIIIe siècle, le royaume de France subit de nombreuses mutations qui renforcent sa suprématie. Tout d’abord, le royaume parvient à s’étendre et à renforcer son autorité sur l’ensemble de son territoire. Ensuite, le roi réussit à affirmer son pouvoir. Cela permet à Philipe le bel d’asseoir sa politique royale au début du XIVe siècle et de signifier son hostilité au pouvoir papal, et donc d’accroitre le territoire du royaume afin de devenir la plus grande figure de l’Europe. Sous son règne, le royaume de France est à l’apogée de sa puissance à l’époque médiévale. Philippe le bel rencontre de grandes difficultés économiques et mène une politique d’expansion territoriale. Il est un roi insoumis à l’autorité de l’Eglise et cherche à lutter contre les pouvoirs qui coexistent tels que l’ordre des templiers. L’Empire est un rival de taille et ne peut pas être réellement vaincu militairement mais peut l’être idéologiquement. Le royaume de France cherche se préserver.
Mais pour comprendre les contentieux doctrinaux qui demeurent entre ces deux géants il faut réaliser une brève autopsie des principes fondamentaux qui forment la dignité impériale. Ensuite, dans un second article il conviendra de traiter comment, par la suite, Philippe le bel va réaffirmer et argumenter l’essence originelle du royaume de France face cet empire rival.
Au regard de l’histoire, l’Empire romain, bien évidemment, ne va pas s’éteindre avec sa chute en 476. Bien au contraire, l’idée d’empire va survivre à Rome et dans toute l’Europe médiévale comme en témoignent les deux grands empires que sont l’Empire carolingien, mais surtout le Saint empire romain germanique fondé en 962 par Otton Ier qui se présente comme l’hériter de cet Empire. Ainsi, la chute institutionnelle de Rome ne signifie pas un irrémédiable effacement du modèle universaliste de gouvernement. L’idée d’empire va au fond survivre, et être reprise dans deux institutions : chez les peuples germains et dans l’Église romaine.
Il convient d’examiner en quoi le Saint empire est le digne héritier de l’Empire romain antique, avant de s’intéresser au caractère universaliste contesté, conservé par ce même Saint empire.
Il semble pour cela tout indiqué d’analyser la nature de cet empire qui fait de l’ombre au royaume de Philippe le bel. Pour mieux comprendre pourquoi il fut l’un de ses principaux et éternels rivaux, il faut s’intéresser aux fondements sur lesquels il repose.
Tout d’abord, « l’imperium romanum » affirme la romanité du Saint empire. Le Saint empire romain germanique, dès sa fondation, se présente comme la continuité de l’Empire romain : les empereurs germaniques se considèrent comme les légitimes successeurs de l’empereur romain. Ce fut précisément le cas de son créateur, Otton Ier, qui se fit proclamer seul et véritable empereur des romains et se présenta lui-même comme le successeur de l’empire romain d’occident. Son caractère impérial se révèle dans son titre qui est « imperator romanorum francorum ». En outre, le droit romain, qui est redécouvert au XIe siècle et étudié dans les universités des royaumes d’Italie, devient le droit de l’empire. Pour toutes ces raisons, le Saint empire romain germanique se considère comme l’incontestable héritier de ce passé romain. Cependant il ne s’agit là que du caractère politique et laïque. L’héritage romain se retrouve également dans le rapport que le Saint empire entretient avec la Sainte religion.
Le caractère chrétien de l’Empire est manifeste et primordial. Il s’agit d’ailleurs de son second fondement, l’ « imperium christianum et sacrum ». En effet l’empereur est présenté comme le protecteur de la foi. Cette fonction semble donc être indissociable de la personne de l’empereur. Initialement, l’Empire romain était polythéiste, mais avec un enchaînement d’événements, il se christianise. Tout commence en 311 avec la conversion au christianisme de l’empereur Constantin Ier, avant celle de tout l’empire sous le règne de Théodose Ier en 380, puisque le christianisme devient alors la religion officielle de l’empire. La caractéristique chrétienne de l’empire ne meurt pas avec sa chute en 476. Elle subsiste avec Charlemagne, qui se pose en souverain héritier des empereurs romains, et également en souverain chrétien. Celui-ci n’est pas seulement le défenseur des intérêts temporels et politiques des peuples germains, il veut également se présenter en tant qu’ultime protecteur de la Chrétienté. Finalement, cette vision de l’empire est en accord avec la thèse des deux royaumes de saint Augustin qui affirme que l’Empire romain est le vaisseau du christ et qu’il assure la protection du monde chrétien. Cette renaissance de l’Empire romain chrétien trouve son aboutissement lors du couronnement de Charlemagne comme empereur le 25 décembre 800, car c’est le pape Léon III qui exige son couronnement de ses mains permettant la « renovatio imperii ». Il est vrai que c’est bien le pape qui détient « l’imperium » car il a le pouvoir de nommer ou destituer l’empereur, et c’est ainsi ce qui renforce la légitimité chrétienne de l’empereur et de l’empire. Après le règne de Charlemagne, cette fonction de garant de la foi fera partie des caractéristiques propres de l’empereur du saint Empire.
Enfin, le dernier fondement est exclusif à l’Empire et se nomme « l’imperium mundi ». C’est-à-dire le caractère universel de l’empire. En effet, se prétendant héritier de Rome, l’empereur se présente comme le monarque incontesté régnant sur un ensemble de royaumes. Ainsi les rois sont des vassaux de l’empereur car ils sont soumis à son autorité. De plus, le terme « empire » renvoie à une monarchie qui a comme projet de s’étendre car il ne connaît pas de limites géographiques. Cela peut se justifier par le fait que l’empereur est le « chef temporel du peuple chrétien ». Les empereurs du Saint empire, se disent les continuateurs de l'Empire romain et carolingien et entendent exercer, même de façon théorique, leur autorité sur tous les territoires chrétiens de l'Europe occidentale. L'empereur doit apparaître comme le premier des princes occidentaux. En prenant exemple sur l'Empire carolingien, les empereurs ottoniens veulent se relier à l'Empire romain. Cette logique sera véhiculée tout au long de l’existence du Saint empire romain germanique. Cette vision universaliste de l’Empire sera un point contesté par le roi de France, qui a la volonté de renforcer l'institution royale et d'assurer sa suprématie sur toute autre puissance. C’est bien pour cela que Philippe le bel souhaite réaffirmer son statut de roi de France en rejetant tout pouvoir extérieur contraignant pour son règne.
Les premiers à lutter contre la conception universaliste du Saint empire sont les spécialistes du droit canonique qui œuvrent pour la réforme grégorienne. Ils cherchent avant tout à affirmer les prétentions du Pape par rapport à celles de l’Empereur germanique. Les canonistes veulent affaiblir l’Empereur germanique et affirment pour cela qu’en Europe chrétienne, les rois ont les mêmes droits que l’Empereur germanique. Parmi ces puissants rois qui profitent des thèses canonistes, il y a le roi de France. Les juristes qui sont au service du roi de France, reprennent les travaux des canonistes et les adaptent au bénéfice de leur suzerain. Ils profitent de la réforme grégorienne pour justifier que le roi de France ne doit pas être soumis à l’emprise impériale. Ces mêmes juristes français utilisent, pour étayer leurs idées, le droit commun redécouvert au XIIe siècle et enseigné dans les universités. Dans le droit romain, ils retrouvent une notion, celle de « princeps ». C’est ainsi que s’appelaient les empereurs romains à la période classique sous le principat. Dans le droit romain, les juristes du XIIIe siècle au service du roi de France trouvent ainsi une formule leur permettant de constituer un argument non négligeable « quod principi placuit legis habet vigorem » soit « ce qui plait au prince a force de loi ». Cet adage est tiré de la pensée du jurisconsulte romain Ulpien. Il fonde la domination du roi dans son royaume, contre l’empereur germanique. L’idée se dégage que le roi de France est empereur en son royaume. Une légitimité issue des anciens écrits romains. Finalement le roi de France officialise son Indépendance grâce à deux ordonnances royales de 1304 et 1314 qui disposent que le roi de France ne peut se soumettre par des liens vassaliques à aucun autre suzerain.
Après cette énonciation des trois grands fondements qui façonnent la nature propre du Saint empire, il est constable que l’ultime fondement, celui de l’universalisme pose un problème. Finalement, les deux premiers principes ne sont pas gênants pour l’exercice du pouvoir royal de Philippe le bel. Mais l’ultime principe heurte sa politique et les règles propre au royaume de France. Il existe, définitivement, un concours doctrinal. D’ailleurs c’est ce concours qui sera la source de bien des mots entre les deux géants. Le royaume de France n’est pas dépourvu d’arguments pour légitimer son indépendance et affirmer sa puissance face à l’aigle noir bicéphale, notamment grâce au passé du royaume franc qui lui donne une certaine légitimité. Il conviendra donc de s’intéresser aux origines du royaume de France afin de comprendre le statut si particulier qu’il possède. Cela sera explicité dans une seconde partie.
Michel du Hamel de Gélis
http://www.vexilla-galliae.fr/civilisation/histoire/2589-partie-i-l-ombre-de-l-aigle-bicephale-germanique-une-menace-silencieuse