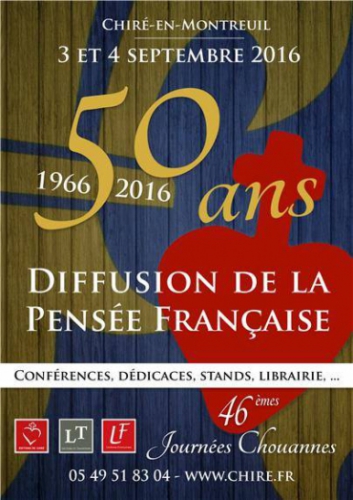Des économistes du FMI se demandaient récemment si le néolibéralisme n'avait pas été surestimé (voir leur texte ici). Leur texte était - évidemment - plein de précautions. Celui traduit ci-dessous n'en comporte aucune. Il est assez saisissant de se dire qu'il provient du Guardian britannique.
L'intérêt du texte, mais plus encore la liberté du ton méritait une mise à disposition en français. La voici.
Texte de George Monbiot traduit par Monique Plaza
Imaginez que le peuple de l'Union soviétique n'ait jamais entendu parler du communisme. Et bien pour la plupart d'entre nous, l'idéologie qui domine nos vies n'a pas de nom. Parlez-en au cours d'une conversation et vous obtiendrez en retour un haussement d'épaules. Même si vos auditeurs ont entendu le terme auparavant, ils auront du mal à le définir. Le « néolibéralisme » : savez-vous seulement ce que c'est ?
Son anonymat est à la fois un symptôme et la cause de sa puissance. Il a joué un rôle déterminant dans un très grand nombre de crises : la crise financière de 2007-2008, la délocalisation de la richesse et de la puissance, dont les Panama Papers nous offrent à peine un aperçu, le lent effondrement de la Santé publique et de l’Éducation, la résurgence du phénomène des enfants pauvres, l'épidémie de solitude, le saccage des écosystèmes, la montée de Donald Trump. Mais nous traitons ces crises comme si chacune émergeait de manière isolée, ne voyant pas qu'elles ont toutes été générées ou exacerbées par la même philosophie cohérente, une philosophie qui a - ou avait - un nom. Quel plus grand pouvoir que de pouvoir se déployer de manière anonyme ?
Le néolibéralisme est devenu à ce point omniprésent que nous ne le reconnaissons même pas comme une idéologie. Nous semblons accepter l'idée que cette foi utopique millénariste relève en fait d'une force neutre, une sorte de loi biologique, comme la théorie de l'évolution de Darwin. Pourtant, cette philosophie a bel et bien surgi comme une tentative consciente de remodeler la vie humaine et de modifier les lieu d'exercice du pouvoir.
Le néolibéralisme considère la concurrence comme la caractéristique principale des relations humaines. Il redéfinit les citoyens comme des consommateurs, dont les prérogatives démocratiques s'exercent essentiellement par l'achat et la vente, un processus qui récompense le mérite et sanctionne l'inefficacité. Il soutient que « Le marché » offre des avantages qui ne pourraient jamais être atteints par quelque type de planification que ce soit.
Les tentatives visant à limiter la concurrence sont considérées comme des dangers pour la liberté. L'impôt et la réglementation sont considérés comme devant être réduits au minimum, les services publics comme devant être privatisés. L'organisation du travail et la négociation collective par les syndicats sont dépeints comme des distorsions du marché qui empêchent l'établissement d'une hiérarchie naturelle entre les gagnants et les perdants. L'inégalité est rhabillée en vertu : elle est vue comme une récompense de l'utilité et un générateur de richesses, lesquelles richesses ruisselleraient vers le bas pour enrichir tout le monde. Les efforts visant à créer une société plus égalitaire sont considérés comme étant à la fois contre-productifs et corrosifs moralement. Le marché est supposé garantir que chacun obtienne ce qu'il mérite.
Or nous intériorisons et reproduisons ces croyances. Les riches se persuadent qu'ils ont acquis leur richesse par le mérite, en ignorant les avantages - tels que l'éducation, l'héritage et la classe d'origine - qui peuvent avoir contribué à son obtention. Les pauvres tendent à se blâmer pour leurs échecs, même quand ils ne peuvent guère changer leur propre situation.
Peu importe le chômage structurel : si vous ne disposez pas d'un emploi, c'est parce que vous n'êtes pas entreprenant. Peu importe les coûts invraisemblables du logement : si votre compte bancaire est vide, c'est que vous êtes irresponsable et imprévoyant. Peu importe que vos enfants n'aient plus de terrain de jeu : s'ils deviennent gras, c'est de votre faute. Dans un monde régi par la concurrence, ceux qui échouent sont vus et s'auto-perçoivent comme perdants.
Paul Verhaeghe montre les conséquences de tout ceci dans son livre What About Me ? : épidémies d'automutilation, troubles alimentaires, dépression, solitude, angoisse de la non-performance et phobie sociale. Il n'est pas surprenant que la Grande-Bretagne, où l'idéologie néolibérale a été appliquée le plus rigoureusement, soit la capitale de la solitude de l'Europe. Nous sommes tous d'authentiques néolibéraux à présent.
Le terme « néolibéralisme » a été inventé lors d'une réunion à Paris en 1938. Deux délégués, Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, ont alors défini les contours de cette idéologie. Tous deux exilés d'Autriche, ils considéraient la social-démocratie, illustrée par le New Deal de Franklin Roosevelt aux États-Unis et par le développement progressif du welfare en Grande-Bretagne, comme les manifestations d'un collectivisme de même nature que le nazisme et le communisme.
Dans La Route de la servitude, publié en 1944, Hayek a notamment souligné que toute forme de planification par un gouvernement conduisait inexorablement, en écrasant l'individualisme, à un contrôle social de type totalitaire. Tout comme Bureaucratie, le livre de Mises, La Route de la servitude a été énormément lu. Il a notamment attiré l'attention de certains très riches, qui ont vu dans cette philosophie une occasion de se libérer de la réglementation et de l'impôt. Lorsqu'en 1947, Hayek fonde la première organisation de promotion de la doctrine du néolibérale - la Société du Mont Pelerin - il est soutenu financièrement par des millionnaires et par leurs fondations.
Avec leur aide, il commence à créer ce que Daniel Stedman Jones décrit dans Les Maîtres de l'Universcomme « une sorte d'Internationale néo-libérale » : un réseau transatlantique d'universitaires, d'hommes d'affaires, de journalistes et de militants. Les riches bailleurs de fonds du mouvement financent une série de groupes de réflexion pour affiner et promouvoir l'idéologie. Parmi eux, l'American enterprise Institute, laHeritage foundation, le Cato institute, l'Institut des affaires économiques, le Centre des études politiques et l'Institut Adam Smith. Ils financent également des postes et des départements universitaires, en particulier dans les universités de Chicago et de la Virginie.
En évoluant, le néolibéralisme est devenu plus virulent. L'idée de Hayek que les gouvernements devraient réglementer la concurrence pour empêcher la formation des monopoles a cédé la place - chez les apôtres américains comme Milton Friedman - à la croyance que la situation monopolistique pourrait être considéré comme une récompense de l'efficacité.
Quelque chose d'autre s'est produit au cours de cette transition : le mouvement a perdu son nom. En 1951, Friedman était heureux de se décrire comme un néolibéral. Mais peu après, le terme a commencé à disparaître. Plus étrange encore, alors même que l'idéologie devenait plus nette et le mouvement plus cohérent, le nom effacé n'a été remplacé par aucun substitut.
Dans un premier temps, en dépit du financement somptueux de sa promotion, le néolibéralisme est resté en marge. Le consensus d'après-guerre était quasi universel : les prescriptions économiques de John Maynard Keynes étaient largement appliquées, le plein emploi et la réduction de la pauvreté étaient des objectifs communs aux États-Unis et à une grande partie de l'Europe occidentale, les taux d'imposition supérieurs étaient élevés et les gouvernements cherchaient avant tout des résultats sociaux, en développant de nouveaux services publics et des filets de sécurité.
Mais dans les années 1970, lorsque les politiques keynésiennes ont commencé à tomber en désuétude et que les crises économiques ont frappé des deux côtés de l'Atlantique, les idées néolibérales ont commencé à s'infiltrer dans le grand public. Comme le faisait remarquer Friedman, « lorsque le moment s'est présenté de changer d'orientation ... il y avait une alternative toute prête qui attendait ». Avec l'aide de journalistes sympathisants et de conseillers politiques, des éléments du néolibéralisme, en particulier ses prescriptions dans le domaine de la politique monétaire, ont été adoptés par l'administration de Jimmy Carter aux États-Unis et par le gouvernement de Jim Callaghan en Grande-Bretagne.
Après que Margaret Thatcher et Ronald Reagan eurent pris le pouvoir, le reste suivit : réductions d'impôts massives pour les riches, écrasement des syndicats, déréglementation, privatisations, externalisation, concurrence dans les services publics. Grâce au FMI, à la Banque mondiale, au traité de Maastricht et à l'Organisation mondiale du commerce, les politiques néolibérales ont été imposées - souvent sans le consentement démocratique des populations - dans une grande partie du monde. Le plus remarquable a été leur adoption par les partis qui appartenaient autrefois à la gauche : le Labour et les Démocrates, par exemple. Comme le fait remarquer Stedman Jones, «il est dur d'imaginer aucune autre utopie qui ait été aussi pleinement réalisée ».
Il peut sembler étrange qu'une doctrine glorifiant le choix individuel et la liberté ait été promue avec le slogan « il n'y a pas d'alternative ». Mais, comme Hayek l'a fait remarquer lors d'une visite au Chili de Pinochet - l'une des premières nations où le programme néolibéral a été complètement appliqué - « ma préférence personnelle penche vers une dictature libérale plutôt que vers un gouvernement démocratique dénué de libéralisme ». La liberté que le néolibéralisme offre et qui semble si séduisante lorsqu'elle est exprimée en termes généraux, signifie la liberté pour le brochet, et non pour les vairons.
La liberté syndicale et la négociation collective signifie la liberté d'amputer les salaires. La liberté de la réglementation signifie la liberté d'empoisonner les rivières, de mettre en danger les travailleurs, d'imposer des tarifs iniques d'intérêt et de concevoir des instruments financiers exotiques. La liberté de l'impôt signifie la liberté de s’extraire de la redistribution des richesses qui permet de sortir des gens de la pauvreté.
Comme le montre Naomi Klein dans La théorie du choc, les théoriciens néolibéraux ont préconisé d'utiliser les crises pour imposer des politiques impopulaires pendant que les gens étaient distraits comme, par exemple, à la suite du coup d’État de Pinochet, de la guerre en Irak et de l'ouragan Katrina, que Friedman a décrit comme «une occasion de réformer radicalement le système éducatif » à la Nouvelle Orléans.
Lorsque les politiques néolibérales ne peuvent pas être imposées directement aux pays en interne, elles le sont iau niveau international, par le biais des traités commerciaux incorporant des ISDS ( juridictions privées ad hoc dédiées au règlement des différends investisseur-État : voir à ce sujet une longue interview sur le TAFTA ici ) qui peuvent faire pression pour supprimer des protections sociales et des législations environnementales. Lorsque les Parlements de certains États ont par exemple voté pour restreindre les ventes de cigarettes, protéger l'approvisionnement en eau des compagnies minières, geler les factures d'énergie ou empêcher les firmes pharmaceutiques de voler l'état, des multinationales ont attaqué les États concernés au tribunal, souvent avec succès. La démocratie se réduit ainsi à un théâtre.
Un autre paradoxe du néolibéralisme est que la concurrence universelle repose sur la quantification universelle et la comparaison. Le résultat est que les travailleurs, les demandeurs d'emploi et les services publics de toute nature sont soumis à un ergotage procédurier, étouffant le régime d'évaluation et de surveillance, afin d'identifier les « gagnants » et de punir les « perdants ». La doctrine que Von Mises avait proposée pour nous libérer du cauchemar bureaucratique de la planification en a plutôt fabriqué un.
Le néolibéralisme n'a pas été conçu comme un self-service à visée d'extorsion, mais il en est rapidement devenu un. La croissance économique a été nettement plus lente dans l'ère néolibérale (depuis 1980 en Grande-Bretagne et aux États-Unis) qu'elle ne l'était dans les décennies précédentes, sauf pour les très riches. L'inégalité dans la distribution des revenus et la répartition des richesses, après 60 années de résorption, a augmenté rapidement depuis, en raison de l'écrasement des syndicats, des réductions d'impôt, de la hausse des loyers, des privatisations et de la dérégulation.
La privatisation ou la marchandisation des services publics tels que l'énergie, l'eau, les trains, la santé, l'éducation, les routes et les prisons a permis aux entreprises de mettre en place des péages, des loyers ou des dépôts de garantie, payables par les usagers et par les gouvernements.
Au bout du compte, ces rentes ne sont ni plus ni moins que des revenus du capital, désignés d'une autre façon. Lorsque vous payez un prix artificiellement gonflé pour un billet de train, seule une partie du prix sert à rémunérer les opérateurs, les dépenses d'énergie, les salaires ou l'amortissement du matériel roulant. Le reste, c'est ce qu'on vous ponctionne.
Ceux qui possèdent et dirigent les services privatisés ou semi-privatisés du Royaume-Uni amassent des fortunes prodigieuses en investissant peu et en facturant cher. En Russie et en Inde, les oligarques ont acquis des actifs de l’État à des prix dérisoires. Au Mexique, Carlos Slim a obtenu le contrôle de presque tous les services de téléphonie, et il est rapidement devenu l'un des hommes les plus riches du monde.
La financiarisation, comme le note Andrew Sayer dans Why We Can’t Afford the Rich, a eu un impact similaire. « Comme la rente », soutient-il, « l'intérêt est... un revenu du capital obtenu sans aucun effort ». Comme les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches, les riches acquièrent de plus en plus le contrôle d'un autre outil essentiel : la monnaie. Le paiements d'intérêt, à une écrasante majorité, permet un transfert financier des pauvres vers les riches. Comme les prix de l'immobilier et le retrait de l’État pèsent sur les personnes endettées (exemple : le remplacement des bourses d'études par des prêts aux étudiants), les banques et leurs dirigeants s'enrichissent à leur détriment.
Selon Sayer, les quatre dernières décennies ont été marquées par un transfert de richesse non seulement des pauvres vers les riches, mais également parmi les riches, depuis ceux qui gagnent de l'argent en fournissant de nouveaux produits ou services vers ceux qui en gagnent en contrôlant les actifs existants, en récoltant des loyers, des intérêts ou des gains de capital. Le revenu acquis a été supplanté par les revenus du capital non acquis.
Mais partout, les politiques néolibérales se heurte à des défaillances du marché. Les banques sont devenues « too big to fail », et des sociétés privées sont désormais chargées de fournir les services publics. Comme souligné par Tony Judt, le raisonnement d'Hayek a omis le fait que les services publics vitaux n'avaient pas le droit de s'effondrer, ce qui signifie que la concurrence ne peut pas suivre son libre cours. Dès lors, le monde du business prend les profit les bénéfices, mais les États conservent les risques.
Or plus l'échec apparaît comme grand, plus l'idéologie se radicalise. Les gouvernements utilisent les crises du néolibéralisme lui-même pour l'approfondir, s'en servant comme occasion de réduire les impôts, de privatiser les services publics restants, d'agrandir les trous dans les filets de sécurité sociale, de déréglementer les sociétés et de re-réglementer les citoyens. La haine de soi de l’État plante maintenant ses crocs dans l'ensemble des services publics.
L'effet le plus dangereux du néolibéralisme ne réside peut-être pas les crises économiques mais les crises politiques qu'il génère. Dans la mesure où le domaine de l’État se réduit, notre capacité à changer le cours de nos vies par le vote se réduit également. A la place, la théorie néolibérale affirme que les gens peuvent exercer leur liberté choix en orientant leurs dépenses. Mais certains ont plus à dépenser que d'autres : dans la grande démocratie du consommateur ou de l'actionnaire, un vote n'équivaut pas à un autre vote. Le résultat est une déresponsabilisation des pauvres et de la classe moyenne. Comme les partis de droite et de l'ex-gauche adoptent des politiques néolibérales similaires, la déresponsabilisation tourne à la privation effective des droits. Un grand nombre de personnes ont été exclues de fait du débat politique.
Chris Hedges note que « les mouvements fascistes s'appuient sur une base constituée non des actifs mais des inactifs politiques, des « perdants » qui sentent, souvent à raison, qu'ils n'ont aucune voix ni aucun rôle à jouer ». Lorsque le débat politique ne s'adresse plus à lui, le peuple devient sensible aux slogans, symboles et sensations qui le remplacent. Pour les admirateurs de Trump, par exemple, les faits et les arguments semblent sans importance.
Judt explique pour sa part que lorsque le maillage épais des interactions normales entre les individus et l'État se réduit à l'exercice de l'autorité et à l'obéissance, la seule force qui nous reste et nous lie est le pouvoir décuplé de l’État. Le totalitarisme que Hayek craignait tant est plus susceptible de voir le jour dans une situation où les gouvernements ayant perdu l'autorité morale qui découle de la fourniture des services publics, sont réduits à « cajoler, menacer et finalement contraindre les gens à leur obéir ».
Tout comme le communisme, le néolibéralisme est une sorte de Dieu déchu. Mais la doctrine zombie continue sa route en bringuebalant. L'une des principales raisons est son l'anonymat, ou plutôt une série de choses qu'on omet de nommer.
Des bailleurs de fonds invisibles maintiennent en vie la doctrine invisible de la main invisible. Lentement, très lentement, nous commençons à découvrir l'identité de quelques-uns d'entre eux. Nous constatons que l'Institut des affaires économiques, qui s'est opposé avec force dans les médias à toute nouvelle réglementation de l'industrie du tabac, a été secrètement financé par la British American Tobacco depuis 1963. Nous découvrons que Charles et David Koch, deux des hommes les plus riches le monde, ont fondé l'institut qui a lui-même mis sur pied le mouvement Tea Party. Nous constatons que Charles Koch, en fondant l'un de ses groupes de réflexion, avait noté que « dans le but d'éviter les critiques indésirables, la façon dont l'organisation est contrôlée et dirigée ne doit pas être largement diffusée ».
Les concepts utilisés par le néolibéralisme dissimulent souvent plus qu'ils ne désignent. « Le marché » sonne comme un phénomène naturel, tout comme pourraient l'être comme la gravité ou la pression atmosphérique. Mais il se heurte à des relations de pouvoir. Ce que « le marché veut » tend à signifier « ce que les entreprises et leurs patrons veulent » Le terme « investissement », comme le note Sayer, peut désigner deux choses très différentes. La première est le financement d'activités productives et socialement utiles. La deuxième est le simple achat d'actifs existants pour percevoir des intérêts, des dividendes et des gains en capital. En utilisant le même mot pour différentes activités, on « camoufle les sources de richesse », ce qui conduit à confondre la création de richesse et la ponction opérée sur la richesse.
Il y a un siècle, les nouveaux riches étaient décriés par ceux qui avaient hérité leur argent. Les entrepreneurs ont cherchaient la reconnaissance sociale en se faisant passer pour des rentiers. Aujourd'hui, la relation a été inversée: les rentiers et les héritiers se présentent comme entrepreneurs. Ils prétendent avoir gagné leur revenu qui n'est que prélevé.
Cette confusion verbale s'ajoute à l'absence de nom et de lieu qui caractérise le capitalisme moderne, et le modèle de la franchise qui garantit que les travailleurs ne savent pas pour qui ils triment. Certaines entreprises sont enregistrées à travers un réseau de régimes offshore si complexe que même la police ne peut pas en découvrir les véritables propriétaires. Des montages fiscaux embobinent les gouvernements. Des produits financiers sont créés, si complexes que personne n'y comprend rien.
L'anonymat du néolibéralisme est jalousement protégé. Ceux qui sont influencés par Hayek, Mises et Friedman ont tendance à rejeter le terme, clamant - non sans justesse - qu'il n'est aujourd'hui utilisé que de façon péjorative. Mais ils ne nous proposent aucun terme substitutif. Certains se décrivent comme libéraux ou libertaires classiques, mais ces descriptions sont à la fois trompeuses et curieusement dissimulatrices, comme si elles suggéraient qu'il n'y a rien de nouveau depuis la La Route de la servitude, Bureaucratie ou le travail classique de Friedman Capitalisme et liberté.
On doit bien convenir qu'il y a quelque chose de remarquable dans le projet néolibéral, du moins tel qu'il existait à ses débuts. Il constituait une philosophie innovante promue par un réseau cohérent de penseurs et de militants ayant un plan d'action clair. Il était patient et persévérant. La route de la servitude est devenue la voie vers le pouvoir.
Le triomphe du néolibéralisme reflète d'ailleurs l'échec de la gauche. Lorsque l'économie du laissez-faire a conduit à la catastrophe en 1929, Keynes a conçu une théorie économique globale pour la remplacer. Lorsque la formule keynésienne de relance par la demande a atteint ses limites dans les années 70, une alternative était prête, le néolibéralisme. Mais lorsque celui-ci a semblé s'effondrer en 2008 il n'y avait ... rien. Voilà pourquoi le zombie continue de marcher. La gauche n'a produit aucun nouveau cadre général de la pensée économique depuis 80 ans.
Chaque invocation de Lord Keynes est un aveu d'échec. Proposer des solutions keynésiennes aux crises du XXI° siècle revient à ignorer trois problèmes évidents: il est difficile de mobiliser les gens sur de vieilles idées; les défauts du keynésianisme révélés dans les années 70 n'ont pas disparu; surtout, les keynésiens n'ont rien à dire au sujet d'une préoccupation nouvelle et de première importance : la crise environnementale. Le keynésianisme fonctionne en stimulant la demande des consommateurs pour promouvoir la croissance économique. La demande des consommateurs et la croissance économique sont les moteurs de la destruction de l'environnement.
Ce que l'histoire des deux doctrines, keynésianisme et du néolibéralisme, démontre, c'est qu'il ne suffit pas de s'opposer à un système à bout de souffle. Il faut aussi proposer une alternative cohérente. Pour le Labour, les Démocrates et les plus à gauche, la tâche centrale devrait être de développer une sorte de « programme économique Apollo », c'est à dire de concevoir un nouveau système de pensée, adapté aux exigences d'aujourd'hui.