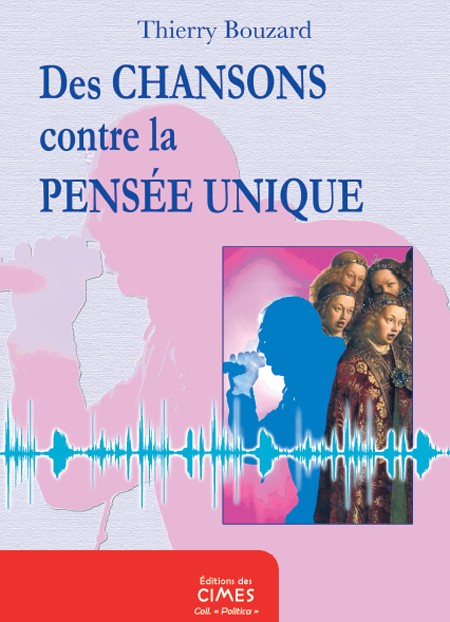Journaliste et essayiste, Arnaud Guyot-Jeannin a dirigé les ouvrages collectifs Aux sources de l’erreur libérale (1999) et Aux sources de la droite (2000) dans la collection "Vu autrement" aux éditions de L’Âge d’Homme. Les questions portant sur l’argent, l’écologie, le libéralisme, le socialisme, le travail, etc, y étaient abordées dans une perspective résolument anticonformiste. Le 27 novembre dernier, il a même consacré son "Libre Journal des enjeux actuels" sur Radio Courtoisie à « la nécessité des luttes sociales » face à la libéralisation du travail du dimanche, à la retraite à soixante-dix ans, à la privatisation de la Poste, etc. L’Action Française 2000 l'accueille avec plaisir une nouvelle fois dans ses colonnes…
L'Action Française 2000 - "Travailler plus pour gagner plus" : cette consigne de M. Sarkozy, qui va maintenant jusqu'à remettre en cause le repos dominical, n'est-elle pas le signe d'une conception nouvelle et bien peu catholique, du travail ?
Arnaud Guyot-Jeannin - Elle n'est pas "nouvelle" et avant d'être "peu catholique", cette consigne est surtout bien peu humaine en vérité. Il est impératif que la fameuse common decency ou décence ordinaire, préconisée par Georges Orwell et reprise par Jean-Claude Michéa de nos jours, se déploie dans la vie quotidienne des individus, des communautés et des peuples.
Des catholiques sociaux déterminés
Je rappelle qu'il a fallu attendre le vote de la loi Lerolle du 13 juillet 1906 pour abroger le travail dominical. En effet, le XIXe siècle avait connu une exploitation inhumaine et une misère sociale effrayantes. L'État centralisé, complice du ploutocapitalisme, avait favorisé une industrialisation massive et un déracinement social et géographique sans précédent. Heureusement, face à ce processus de désintégration nationale, provinciale et sociale se dressèrent des penseurs et députés catholiques sociaux attachés à défendre le génie populaire et les socialités primaires de la France traditionnelle.
L'AF 2000 - Pouvez-vous rappeler quelques lois pour lesquelles les catholiques sociaux ont milité au XIXe siècle et au début du XXe ?
A.G.-J. - Bien sûr. Dès le 21 mars 1841, la loi Montalembert a proscrit le travail des femmes et des enfants dans les manufactures. Le 7 juillet 1891, Albert de Mun a proposé la suppression du travail de nuit pour les femmes et les enfants. Le 29 octobre 1892, le même député s'est engagé en faveur de la limitation du temps de travail. La future loi de Martine Aubry sur les 35 heures en représente le très pâle reflet, car elle ne vise pas l'amélioration des conditions de travail, mais une meilleure intégration à la société productiviste et au marché du travail qui sert exclusivement les intérêts du capital.
On doit encore aux catholiques sociaux plusieurs propositions de loi sur la retraite et notamment sur les retraites ouvrières, en 1910 par exemple ; elles doivent être mentionnées au moment où le gouvernement Sarkozy-Fillon légifère en faveur de la retraite à soixante-dix ans. Et pourquoi pas, jusqu'à soixante-quinze ans, à l'instar des États-Unis, modèle préféré du chef de l'État ?
Démesure
Au total, une centaine de lois et propositions de lois ont été défendues avec détermination par les catholiques sociaux et les Cercles catholiques d'ouvriers (1871) dont les initiateurs s'appelaient Maurice Maignen, René de La Tour du Pin et Albert de Mun. Sans oublier l'influence pontificale à travers l'encyclique sociale Rerum Novarum (1891) rédigée par Léon XIII !
L'AF 2000 - N'est-ce pas en fait sur la conception de l'homme lui-même que Nicolas Sarkozy et les libéraux se séparent de ces catholiques sociaux ?
A.G.-J. - Assurément, la formule de Nicolas Sarkozy, "travailler plus pour gagner plus", s'inscrit dans la dynamique quantitative de la démesure capitaliste du "toujours plus" : toujours plus d'argent, toujours plus d'objets, toujours plus de consommation, toujours plus de travail, etc. L'homme y est envisagé comme un numéro-matricule du système marchand postdémocratique, ce système où la valeur travail et la valeur marchande se confondent au détriment de la valeur d'usage.
Bien sûr, Nicolas Sarkozy n'est qu'un symbole fort de ce système mondialisé. Mais les symboles sont importants en politique. D'autant plus que la formule sarkozyenne du "travailler plus pour gagner plus" a finalement comme résultat pour les salariés de travailler plus pour gagner moins. Et même de travailler moins bien en raison d'un cadre général de travail de plus en plus inhumain.
Face à une telle régression sociale et environnementale, mais plus largement civilisationnelle, il faut opposer un vrai modèle alternatif, où écologie sociale et économie solidaire réactivent le sens des responsabilités ordonnées et partagées dans un cadre de vie qui n'exclut pas un peu de flânerie. Tout est une question d'éthique, de politique et de mesure ! Le bien commun doit l'emporter sur un utilitarisme marchand, vecteur de modes de management délétères entraînant une course effrénée à la productivité et un stress épouvantable qui causent de la souffrance au travail.
En résumé : Sois cool et tais-toi !
L'AF 2000 - Comment se manifeste aujourd'hui cette "souffrance au travail" ?
A.G.-J. - 53 % des Français disent souffrir dans leur activité professionnelle. Plusieurs centaines de cadres se suicident chaque année dans notre pays. Le harcèlement actionnarial et patronal va de pair avec une idéologie de la performance qui prône les mêmes formules commerciales de technocentres entrepreunariaux - plus chaleureusement appelés les entreprises copains - : Il faut faire plus, toujours plus ! L'open space établit une dictature du bonheur qui provoque un malheur intériorisé chez le salarié. De nouvelles formes de domination d'un post-libéralisme sympa et meurtrier se mettent donc en place. Sois cool et tais-toi ! Dans de plus en plus d'entreprises, le tutoiement et l'appellation de son patron par ses initiales sont obligatoires. L'obligation de résultat est le seul paramètre qui compte dans un cadre décloisonné où les relations sont fluides et opérationnelles ! Le patron est à la fois un GO en apparence et un serial killer en fin de mois. Nous ne sommes pas loin de la description de la World compagny moquée par Les Guignols de l'Info. Comment voulez-vous que la valeur travail ne soit pas décrédibilisée dans une société où le travail n'a plus de valeur ?
Au métier qualifié, enraciné, sédentaire et humanisé a succédé - à partir du milieu des années soixante-dix – un travail découpé, parcellarisé, nomadisé et globalisé. Au métier organique a fait place un travail mécanique. Une besogne machinale et anonyme qui foudroie les cadres, les cadres moyens et les secrétaires de direction qui tombent en dépression. N'oublions jamais que la France est le premier pays au monde - avant les États-Unis - à utiliser des calmants et des anxiolytiques. Sarkozy est-il de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques ? Plaisanterie mise à part, le constat s'impose à nous : le travail tue de plus en plus. La société positive du travail s'avère négative. Il s'agit là d'une société anxiogène et mortifère.
L'AF 2000 - En ce qui concerne la nouvelle mesure sur le travail le dimanche, le texte qu'a présenté le gouvernement n'est-il pas beaucoup plus minimaliste qu'au départ ?
A.G.-J. - Certes, mais Nicolas Sarkozy va faire passer habilement sa loi en insistant sur la notion de "volontariat" et de "liberté" du travailleur comme du consommateur. De façon évidente, les réfractaires au travail dominical seront immédiatement mal vus et mal notés. Le conditionnement négatif ambiant les poussera vite à revoir leur décision. Avec une telle liberté surveillée, je parie même que beaucoup d'entre eux seront dissuadés de recourir à un tel choix hypocrite et préféreront travailler bien gentiment le dimanche au détriment de leurs autres activités. Puis Nicolas Sarkozy s'occupera des aménagements nécessaires à la généralisation progressive du travail dominical, toujours au nom de la volonté, de la liberté et du marché pour tous... Mais en réalité, au détriment de l'ensemble des salariés et au profit - c'est le cas de le dire - des grosses fortunes dont il est l'ami !
Liberté sous surveillance
La question reste posée : les Français doivent-ils consommer à tout prix, tous les jours, tout le temps, y compris le dimanche ? Allons-nous devenir un peuple de salariés et de consommateurs ?
Pour des raisons humaines, sociales, familiales, amicales, religieuses, le repos dominical demeure essentiel. Il représente un jour de partage et sert à resserrer les liens entre les personnes et leur environnement. Moins de travail ne signifie pas "plus de travail". Le travail est un moyen en vue de subvenir à ses besoins, pas une fin en soi. Les partisans de la sanctification par le travail - qui comptent de nombreux chrétiens conservateurs et progressistes devraient faire cette nuance de taille. « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat » proclame hiérarchiquement l'Évangile selon saint Marc (2, 23-28). Ralentir les cadences de travail et décélérer les activités économiques en termes de production et de consommation ne signifie pas abolir le travail. Décroître n'est pas synonyme de récession. Une décroissance soutenable ne peut qu'être volontaire, tandis que notre récession économique et sociale ne l'est pas. C'est la décroissance qui peut empêcher de nouvelles crises. Pour cela, encore faut-il rompre avec la logique du capitalisme. La seule alternative politique et civilisationnelle réside aujourd'hui dans la pratique d'une décroissance de la production, de la consommation et du travail permettant de produire moins, consommer moins et travailler moins pour travailler bien et vivre mieux
L'AF 2000 - Peut-on donc envisager de travailler autrement ? Que pensez-vous du "dividende universel" préconisé à une époque par Christine Boutin ?
A.G.-J. - D'abord, je remarque que Christine Boutin ne le préconise plus depuis qu'elle est ministre du Logement. D'ailleurs, comment le pourrait-elle dans un gouvernement dont l'hyperprésident représente la droite bling-bling ? Le "dividende universel" appelé aussi "revenu social inconditionnel", "revenu d'existence" ou encore "revenu universel de citoyenneté" représente des allocations populaires responsabilisantes, intégratrices et solidaires. André Gorz, Yoland Bresson ou encore Alain Caillé, le directeur du Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales (MAUSS) ont travaillé sur leur possible mise en pratique dans la société française.
Le "dividende universel"
Leur théorie pratique vise à réduire le temps de travail en obtenant un revenu inconditionnel d'inclusion sociale - et non d'exclusion comme le RMI et le RSA, tous deux conditionnels - pour chaque membre de la communauté nationale. Dans une société où le travail est considéré comme pénible et surplombant, où la désaffiliation sociale et familiale engendre l'anomie, où les pauvres se comptent par millions et où le chômage n'est plus seulement conjoncturel, mais structurel, ne faut-il pas permettre à chacun de libérer un peu de temps pour ses activités familiales, amicales, paroissiales, culturelles, sportives etc, tout en vivant décemment ? Poser la question, c'est y répondre. L'établissement du "dividende universel" - perçu de la naissance à la mort par chaque personne - rompt avec la société du tout travail et du travail salarié. Il faut pouvoir travailler et gagner sa vie au minimum sans se voir astreint automatiquement à occuper un poste de salarié dans une société salariale. Avec l'essor des réseaux et de la mondialisation-fragmentation tribale, l'avenir n'est plus au salariat. Précisons que le montant du revenu doit être ni trop élevé pour éviter l'assistanat, ni trop bas pour ne pas engendrer la précarité.
L'AF 2000 - La crise actuelle ne marque-t-elle pas la défaite du libéralisme ? N'est-il pas temps de remettre en cause le capitalisme lui-même ?
A.G.-J. - La crise financière mondiale était prévisible. En effet, en 1945, la signature des accords de Yalta a permis de livrer l'Europe et une grande partie du globe au communisme soviétique et au capitalisme américain. Plus de quarante ans après, le mur de Berlin s'est effondré et l'Union soviétique s'est désintégrée. Le communisme disparaissait à l'Est ! Le capitalisme se retrouvait alors seul dans un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Seulement, il ne pouvait plus instrumentaliser les tares de son ennemi de la Guerre froide pour légitimer son système. Il trouvait alors un diable de rechange : l'islamisme. Mais cela ne suffit pas ! Les crises économiques et géopolitiques américaines éclataient peu après. La volonté de puissance marchande et la démesure guerrière des États-Unis aboutissaient à une récession interne doublée d'une grande méfiance des États et des peuples sur le plan externe.
Le mur de l'argent
La loi de la jungle néolibérale ne peut présider justement et durablement au destin d'une puissance. Le capitalisme se fonde sur l'accumulation du capital et du profit. Il porte l'excès en lui. « La monnaie créée ex-nihilo » pour reprendre l'expression de Maurice Allais, la spéculation des échanges monétaires virtuels et la dématérialisation planétaire de l'argent, ne peuvent que mener à d'autres fuites en avant suivies de crises préjudiciables aux sociétés occidentales de marché. Ces autres crises financières vont survenir parce que le système de l'illimité ne peut survivre dans un monde qui connaît nécessairement des limites. Le mur de l'argent chutera alors à son tour. Le système capitaliste américanocentré explosera comme sa bulle. Le capitalisme est né du système de l'argent, il mourra du système de l'argent.
Propos recueillis par Michel Fromentoux
L’ACTION FRANÇAISE 2000 n° 2761 – du 18 au 31 décembre 2008