16 avril 1922 : Traité de Rapallo : l’Allemagne vaincue en 1918 et l’URSS, sortant de la guerre civile qui avait opposé Blancs et Rouges, concluent un accord bilatéral, sous la houlette de leurs ministres respectifs, Walther Rathenau et Georges Tchitchérine. L’URSS renonce à réclamer des réparations de guerre à l’Allemagne, qui, en échange, promet de vendre des biens et produits d’investissement infrastructurel à la Russie rouge. La conférence de Gênes avait été suggérée par la Grande-Bretagne, pour régler l’ordre d’après-guerre, après que l’URSS ait refusé de payer les dettes de l’Empire des Tsars. Les Britanniques suggéraient une reconnaissance de l’URSS, l’établissement de relations diplomatiques normales et, surtout, visaient à récupérer des intérêts dans les pétroles de Bakou. Le financement par les Britanniques de la contre-révolution blanche avait pour objectif principal d’éloigner le pouvoir rouge, centré autour de Moscou et de Petersbourg, des champs pétrolifères caucasiens : les artisans de cette manœuvre étaient Churchill et le magnat Deterding, de la Shell. L’échec des armées blanches et la reconquête soviétique du Caucase obligèrent les Britanniques à changer de stratégie et à accepter d’intervenir dans le fameux « NEP » (Nouveau Programme Économique), lancé par Lénine. Au même moment, les Américains commencèrent à s’intéresser, eux aussi, au pétrole du Caucase, espérant profiter des déconvenues britanniques, suite à la défaite des armées blanches. Avant le coup de Rapallo, imprévu, un conflit frontal entre la Grande-Bretagne et les États-Unis se dessinait à l’horizon, ayant pour objet la maîtrise planétaire du pétrole. Il se poursuivit néanmoins, par personnes interposées, notamment en Amérique ibérique, mais le bloc informel germano-russe constituait désormais le danger principal, interdisant toute confrontation directe entre Londres et Washington.
Rathenau n’avait nulle envie, au départ, de lier le sort de l’Allemagne à celui de la jeune URSS. Mais le poids colossal des réparations, exigées par les Français et les Britanniques, était tel qu’il n’avait pas d’autres solutions. En 1921, Londres avait imposé une taxe prohibitive de 26% sur toutes les importations allemandes, contrecarrant de cette façon toute possibilité de rembourser les dettes imposées à Versailles dans des conditions acceptables. L’Allemagne avait besoin d’une bouffée d’air, d’obtenir des matières premières sans avoir à les acheter en devises occidentales, de relancer son industrie. En échange de ces matières premières, elle participerait à la consolidation industrielle de l’URSS en lui fournissant des biens de haute technologie. L’ « Ultimatum de Londres » de 1921 avait exigé le paiement de 132 milliards de marks-or, somme que John Maynard Keynes jugeait disproportionnée, si bien qu’elle entraînerait à terme un nouveau conflit. Pire : si l’Allemagne n’acceptait pas ce diktat, finalement plus draconien que celui de Versailles, elle encourait le risque de voir la région de la Ruhr, son cœur industriel, occupée par les troupes alliées. L’objectif était de pérenniser la faiblesse de l’Allemagne, de juguler tout envol de son industrie, de provoquer un exode de sa population (vers les Etats-Unis ou les possessions britanniques) ou une mortalité infantile sans précédent (comme lors du blocus des côtes allemandes dans l’immédiat après-guerre).
Avec le Traité de Rapallo, les Britanniques et les Français voyaient se dessiner un spectre à l’horizon : la relance de l’industrie allemande, le paiement rapide de la dette donc l’échec du projet d’affaiblissement définitif du Reich, et le développement tout aussi rapide des infrastructures industrielles soviétiques, notamment celles de l’exploitation des champs pétrolifères de Bakou, qui serait dès lors aux mains des Russes eux-mêmes et non pas de « patrons » anglais ou américains. Sur tout le territoire allemand, prévoyaient les accords bilatéraux de Rapallo, un réseau de distribution d’essence, dénommé DEROP (Deutsch-Russische Petroleumgesellschaft), permettant à l’Allemagne de se soustraire à toute dépendance pétrolière à l’égard des puissances anglo-saxonnes. Le 22 juin 1922, un peu plus de deux mois après la conclusion des accords de Rapallo, Rathenau fut assassiné à Berlin par un commando soi-disant nationaliste et monarchiste, relevant d’une mystérieuse « Organisation C ». À la fin de l’année, le 26 décembre 1922, Poincaré, lié aux intérêts anglais, trouve un prétexte –l’Allemagne n’a pas livré suffisamment de bois pour placer des poteaux télégraphiques en France- pour envahir la Ruhr. Les troupes françaises entrent dans la région dès le 11 janvier 1923. Les Anglais s’abstiennent de toute occupation, faisant porter le chapeau à leurs alliés français, sur qui retombe tout l’opprobre dû aux 150.000 déportés et expulsés, aux 400 ouvriers tués et aux 2.000 civils blessés, sans omettre dans cette sinistre comptabilité l’exécution du Lieutenant Léo Schlageter.
L’assassinat de Rathenau n’est pas un fait historique isolé. Les organisations terroristes, chargées d’exécuter les planificateurs politiques de stratégies industrielles jugées inacceptables pour Londres ou Washington, n’ont pas toujours eu une couleur monarchiste et/ou nationaliste, comme dans le cas de Walther Rathenau. Les services anglo-saxons ont aussi, pour exécuter leurs basses besognes, des pantins d’extrême gauche, notamment ceux de la RAF ou Bande à Baader. Ainsi, Jürgen Ponto, Président de la Dresdner Bank, qui avait planifié, avec les Sud-Africains, le retour de l’étalon-or pour pallier aux fluctuations du dollar et du prix du pétrole, fut assassiné le 31 juillet 1977 par des tueurs se réclamant de la Bande Baader-Meinhof. Quelques semaines plus tard, ce fut au tour du « patron des patrons », Hanns-Martin Schleyer. Mais ce n’est pas tout. Le 29 novembre 1989, la voiture blindée d’Alfred Herrhausen, directeur de la Deutsche Bank, explose. Herrhausen avait été le conseiller économique du Chancelier Kohl, à l’époque de la dislocation de l’empire soviétique et des manifestations populaires en Allemagne de l’Est réclamant la réunification allemande. L’Allemagne projetait d’investir dans les nouveaux Länder de l’ancienne RDA, dans les pays de l’ex-Comecon et en Russie. Les milieux financiers anglais et américains craignaient que cette masse de capitaux, destinés au développement de l’Europe centrale et orientale n’alimentât plus les investissements européens et allemands aux Etats-Unis, ne permettant plus, par conséquent, de maintenir le système américano-centré à flot. La presse anglaise venait de faire campagne, via notamment le Sunday Telegraph, contre l’émergence d’un « Quatrième Reich ». Malgré l’assassinat de Herrhausen, le Chancelier Kohl annonça publiquement, quelques semaines plus tard, que son gouvernement envisageait le développement des grands moyens de communication en Europe, notamment la création d’un chemin de fer Paris-Hanovre-Berlin-Varsovie-Moscou.
La mort tragique de Herrhausen fut le premier acte d’une contre-stratégie anglo-saxonne : pour ébranler cet axe Paris-Berlin-Moscou en gestation, il fallait frapper à deux endroits, dans les Balkans, où commence alors le processus de dislocation de la Yougoslavie, et en Irak, site des principaux champs pétrolifères de la planète. De Rapallo aux guerres contre l’Irak et de celle-ci à la proclamation unilatérale de l’indépendance du Kosovo, il existe un fil conducteur bien visible pour ceux qui n’ont pas la naïveté de prendre pour argent comptant les vérités de propagande diffusées par les grands médias internationaux et les discours larmoyants sur les droits de l’homme bafoués que glapissaient les Lévy, Glucksmann et autres Finkelkraut (Robert Steuckers).
• Source (à lire et à relire !) : William ENGDAHL, Pétrole : une guerre d’un siècle – L’ordre mondial anglo-américain, éd. Godefroy, 2007.

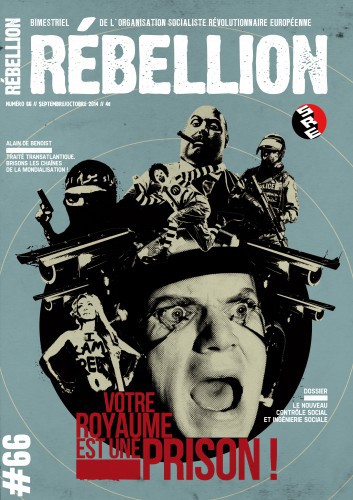
 La voie, connue sous le nom d'Avenue, fait 2.4km de long depuis le monument. Après la fermeture de la route A344, les archéologues ont pu y faire des fouilles pour la première fois. Le Professeur Parker Pearson a identifié des fissures d'origines naturelles qui se trouvaient entre les bords situés le long de la voie.
La voie, connue sous le nom d'Avenue, fait 2.4km de long depuis le monument. Après la fermeture de la route A344, les archéologues ont pu y faire des fouilles pour la première fois. Le Professeur Parker Pearson a identifié des fissures d'origines naturelles qui se trouvaient entre les bords situés le long de la voie.