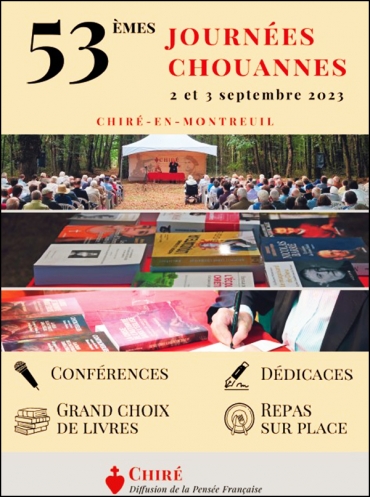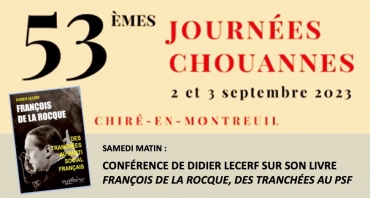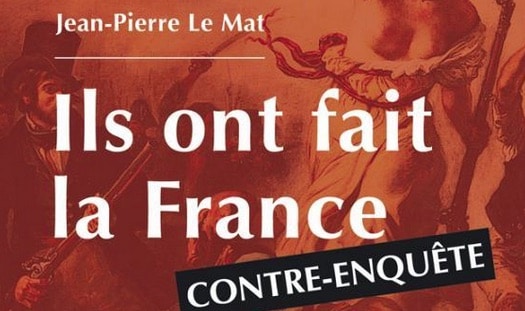culture et histoire - Page 214
-
Le Charnier de la République, horreur de la Grande Terreur
L'été : l'occasion pour beaucoup de se plonger enfin dans ce livre dévoré des yeux toute l'année sans pour autant avoir eu le temps de le lire. À cette occasion, BV vous propose une sélection de ses meilleures recensions. Aujourd'hui, Le Charnier de la République.À ceux qui se demanderaient (et ils sont sûrement nombreux) quelles sont ces fameuses « valeurs de la République » dont nous parle sans cesse le courageux et efficace Gérald Darmanin, Joachim Bouflet offre ici, indirectement, une réponse précise, complète et argumentée. Son livre, Le Charnier de la République, publié par les toujours excellentes Éditions Salvator, s'intéresse à la période de la Grande Terreur à Paris, en juin et juillet 1794. Du 14 juin au 27 juillet 1794, précisément, près de 1.300 personnes ont été guillotinées, le plus souvent après des parodies de jugement. Un grand nombre d'innocents, parfois arrêtés à cause d'une simple homonymie avec des « suspects » qui n'avaient, eux-mêmes, rien fait de mal. -
Samedi 2 et dimanche 3 septembre à Chiré-en-Montreuil (86) : 53e Journées chouannes
Renseignements : cliquez ici
Venez nous retrouver sur le stand de Synthèse nationale
-
Joseph de Maistre : la nation contre les droits de l’homme, par Marc Froidefont
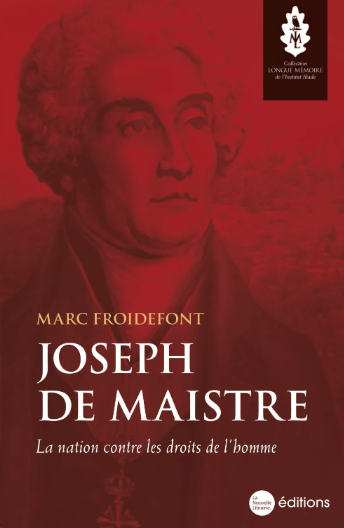
Marc Froidefont, agrégé de philosophie, est docteur en poétique et littérature. Déjà auteur de Théologie de Joseph de Maistre dont nous vous parlerons probablement prochainement, il vient de signer un excellent petit opuscule intitulé Joseph de Maistre, La nation contre les droits de l’homme.
-
La FOLIE de CHARLES VI & le BAL des ARDENTS
-
[L’été BV] Demain, saura-t-on encore écrire à la main ?

Ils vous avaient peut-être échappé. Cet été, nous vous proposons de lire ou relire les meilleurs articles publiés cette année par BV.
Cet article a été publié le 14/04/2023.Bonne question ! La question pourrait même être : sait-on encore écrire à la main ? Comparer les copies d'un élève des années 50 avec celles d'un gamin d'aujourd'hui a de quoi donner envie de pleurer. Le signe d'un changement de civilisation ?
-
Saint Martin, Foch et le 11 Novembre

Le maréchal Ferdinand Foch, polytechnicien, artilleur – ce qu’on appelait, alors, une arme savante -, était un « grand cartésien » qui « avait foi dans la raison humaine », comme l’écrivit André Tardieu (1876-1945), son collaborateur pendant la guerre et futur président du Conseil. Raymond Recouly (1876-1950), un autre de ses biographes d’avant-guerre, rapportait les propos de Foch au sujet d’un homme politique que l’on disait appelé à un bel avenir : « C’est un sceptique. Il ne croit à rien. Ainsi, n’arrivera-t-il à rien. » Foch était donc aussi un homme de foi : « Une foi de simple, de charbonnier » qui lui donnait « une assiette fixe, inébranlable, pour y bâtir et y organiser son existence tout entière », poursuivait Recouly. Toujours dans son Mémorial de Foch, Recouly raconte que le maréchal évoquait souvent ce légionnaire romain prévoyant qui emportait toujours avec lui un pieu pour étayer sa tente lorsqu’il arrivait le soir à l’étape. Foi et raison.
-
La Gaule et les Gaulois avant César (rediif)
Avant notre ère, le territoire compris entre les Pyrénées, les Alpes et le Rhin (France, Bénélux, Suisse et Rhénanie actuels) a une unité toute fictive et ce n'est en rien un pays de sauvages selon l'idée cultivée par les historiens du XIXe siècle…Appelé Gallia (Gaule) par Jules César dans son célèbre compte-rendu de la guerre des Gaules, ce territoire appartient à l'immense domaine de peuplement celte qui s'étend des îles britanniques jusqu'au bassin du Danube et même jusqu'au détroit du Bosphore (le quartier de Galatasarai, à Istamboul, rappelle encore aujourd'hui la présence de Galates, cousins des Gaulois, dans la région). -
Fantôme Déconnecté présente ses meilleurs morceaux, ses artistes préférés et son nouvel album
-
2ème entretien avec Alice Tertrais : NEDERLAND, le dernier bijou de Guillaume Faye - Roman français
-
A La Une, Histoire Jean-Pierre Le Mat : « Je ne pense pas que les tenants d’une dictature républicaine apprécieront mon livre »