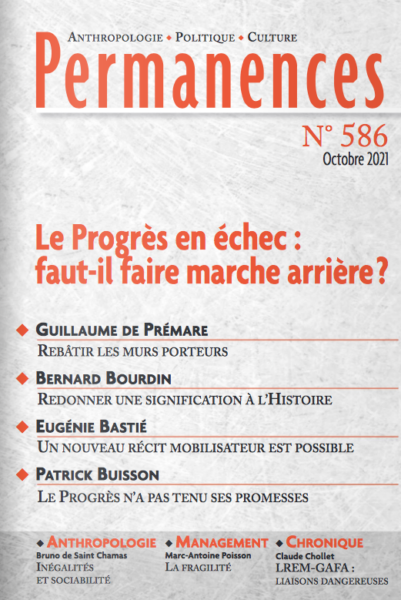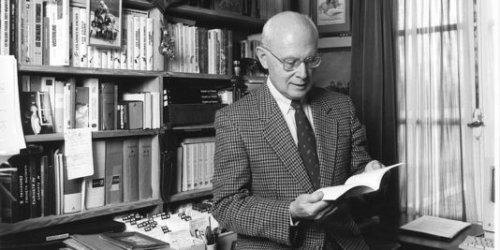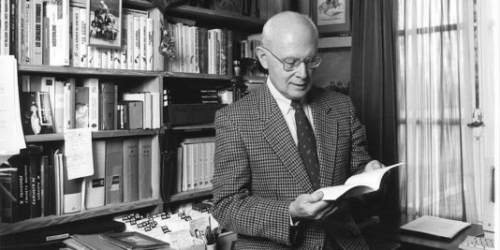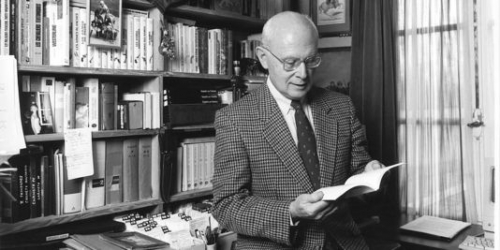
photographie : Louis Monier © - Rue des Archives
Venner, exégète de Jünger
Dans Ernst Jünger : Un autre destin européen, Venner nous a légué le livre le plus didactique, le plus clair et le plus sobre, sur l’écrivain allemand, incarnation de l’anarque et ancien combattant des “Stosstruppen”. Cet ouvrage de 2009 s’inscrit dans le cadre d’une véritable renaissance jüngerienne, avec, pour apothéose, le travail extrêmement fouillé de Jan Robert Weber (Ästhetik der Entschleunigung – Ernst Jüngers Reisetagebücher 1934-1960) et surtout l’ouvrage chaleureux de Heimo Schwilk (Ernst Jünger – Ein Jahrhundertleben), où l’auteur se penche justement sur les linéaments profonds du “nationalisme révolutionnaire” d’Ernst Jünger et de son “anti-bourgeoisisme”, un “anti-bourgeoisisme” qui critique précisément cette humanité qui sort de l’histoire pour s’adonner à des passe-temps stériles comme la spéculation, la distraction sans épaisseur éthique ou civique, le confort matériel, etc., bref ce que Venner appelait, dans Pour une critique positive, « la décomposition morbide d’un certain modernisme [qui] engage l’humanité dans une impasse, dans la pire des régressions ». Les esprits et les forces “kathéchoniques” participent, disait Venner dans Pour une critique positive, d’un “humanisme viril”, assurément celui de Brantôme, garant d’un “ordre vivant” (et non pas mortifère comme celui dont Chaunu redoutait l’advenance).