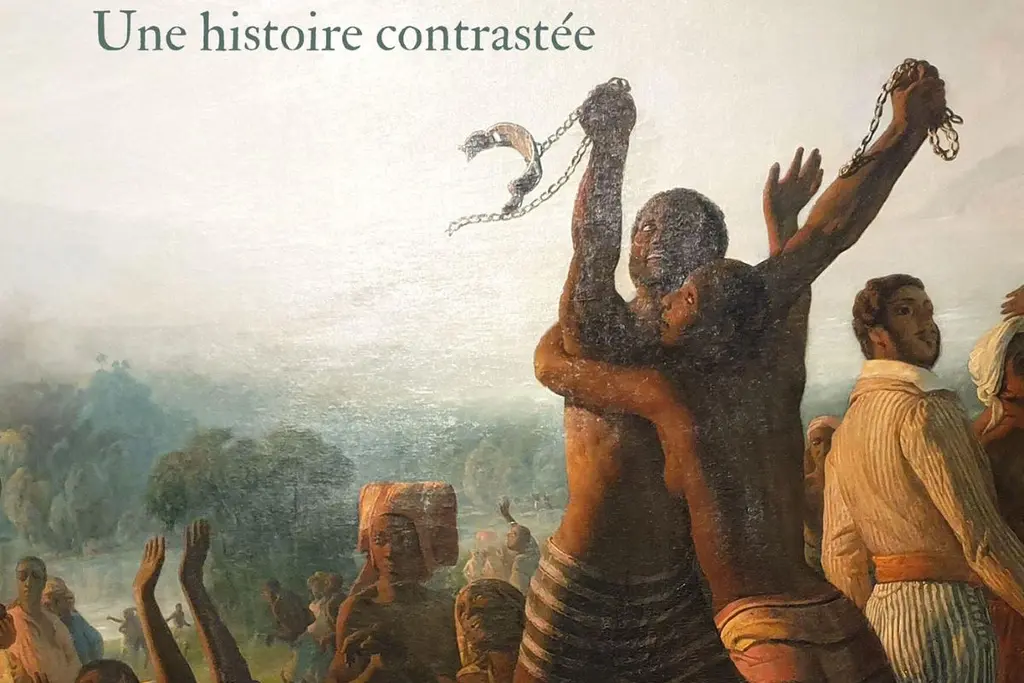
Les Chrétiens et l’Esclavage, ouvrage qui fait désormais référence, montre que c’est bien la conception chrétienne de l’homme qui a étouffé la tendance naturelle de celui-ci à asservir ses semblables. Explications avec l’auteur, l’historien Jean-Pierre Montembault.
Propos recueillis par Étienne Lombard pour Le Bien Commun
Le Bien commun : Vous déclarez que l’esclavage est dans la nature humaine. Pourquoi ?
Jean-Pierre Montembault : Il suffit de regarder autour de soi pour voir tous les défauts des êtres humains : l’orgueil, l’égoïsme, la volonté d’exploiter l’autre, de dominer. Autant de défauts qui sont universels, même s’ils peuvent être plus criants dans certains pays que dans d’autres. Chez les chrétiens, on explique cela par le péché originel. L’historien, lui, constate que le christianisme a fait éclore l’idée du caractère universel de l’être humain, lié à sa dignité d’enfant de Dieu, quel que soit son origine sociale ou ethnique. Or, ce concept n’existait nulle part ailleurs. Dans l’antiquité ou la préhistoire, les hommes étaient animistes, et beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs tendance à le redevenir aujourd’hui. Or, les animistes ne font pas de distinction entre l’homme et la nature, ce qui veut dire que la hiérarchisation va se faire entre les groupes humains, entre lesquels il n’y a pas d’égalité. Chez les Romains, les autres sont des Barbares ou des Berbères. Ailleurs, en Inde par exemple, ils sont impurs, d’une caste inférieure, etc. Et aujourd’hui, c’est un peu la même chose : on a le camp du bien, en quelque sorte, qui peut se permettre de faire des monstruosités contre celui qu’il considère comme le camp du mal. Ce dernier est déshumanisé, on ne va donc pas pleurer sur son sort. On peut brutaliser les « méchants » ou les asservir. Cette conception du caractère universel de l’être humain a donc beaucoup de mal à imprégner nos esprits, même aujourd’hui.
Comment expliquer que le christianisme ait été la seule religion à combattre l’esclavage ?
Dans la conception catholique, l’homme a été créé à l’image de Dieu, c’est-à-dire libre et autonome. Il a été sublimé par l’Incarnation, sauvé par la Rédemption. Tout cela le rend sacré. Le christianisme définit donc la personne humaine par elle-même et non par rapport à sa cité ou à son statut : citoyen, clan, « race »… Tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu, et ce quelle que soit leur origine ou leur religion. C’est l’épître de Saint Paul aux Galates. Il n’y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, mais des hommes libres. Ajoutons enfin que pour un chrétien, tout homme va être jugé par Dieu sur ses actes, dont il est responsable. Or comment pourrait-on être responsable si on n’est pas libre ? Et cette liberté ne peut être qu’individuelle chez les chrétiens. C’est-à-dire qu’on doit être libre parce qu’on est un homme, et non pas parce qu’on appartient à tel groupe ou telle cité.
Cette idée était en rupture totale avec la conception habituelle de l’homme, et le christianisme a été la seule à la promouvoir. Saint Thomas d’Aquin l’avait bien résumé en disant que « seuls les êtres sans raison sont par nature destinés à servir ». L’homme a une raison. Il doit donc être libre. Il reprenait les propos de Saint Grégoire de Nysse : « Dieu a fait l’homme libre. Quel homme pourrait oser se considérer comme supérieur à Dieu, en affirmant le contraire ? » Il faut enfin rappeler que le christianisme dit d’aimer son prochain, ami comme ennemi. Comment pourrait-on, dès lors, le transformer en esclave ? Cette conception est aux antipodes de celle de l’Islam, qui a de ce fait intégré et pratiqué l’esclavage pendant des siècles.
Selon vous le christianisme a-t-il été aidé dans son entreprise par l’institution royale, en Europe et notamment en France, et si oui pourquoi et comment ?
Oui parce que les rois étaient chrétiens, et cherchaient à faire des lois chrétiennes. En 1315, Louis X le Hutin a supprimé le servage dans ses États, et non pas l’esclavage, parce que l’esclavage n’existait déjà plus. Malgré des exceptions, la disparition de l’esclavage s’est étendue à toute l’Europe, à l’initiative ou avec le soutien explicite des pouvoirs politiques. Sans leur accord, l’esclavage aurait perduré. Cela s’est fait progressivement, parce qu’on ne peut pas changer les mentalités d’un seul coup. Au début, les rois ont interdit les marchés d’esclaves, puis favorisé le rachat des esclaves chrétiens, puis des autres. Ce travail par étape, en France notamment, s’est fait parallèlement avec le renforcement de l’autorité royale. Plus le pouvoir royal s’affirmait face aux seigneurs, plus ses édits avaient force de loi. Leurs dons aux organisations religieuses ont aussi permis à ces dernières de racheter la liberté de nombreux esclaves en terre d’Islam.
Mais cette lutte contre l’esclavage avait aussi ses limites. Le roi vit dans un contexte précis, réagit en fonction de ce contexte et doit tenir compte d’autres contraintes, d’autres priorités. Il n’est pas hors sol. La lutte contre l’esclavage ne constitue pas l’alpha et l’oméga de sa politique.
Louis XIV et Colbert n’ont-ils pas illustré cette difficulté avec le Code noir, qui leur est beaucoup reproché aujourd’hui ?
Il n’y avait plus d’esclavage dans la métropole depuis le XIIe, mais il est réapparu dans certaines colonies. Le roi savait que les colons n’allaient pas lui obéir. Il n’avait pas les moyens de les contraindre et il avait besoin des produits venant d’Amérique. Donc, il a officiellement toléré l’esclavage, en le réglementant avec le Code noir, afin de l’adoucir, de l’humaniser. Et le code comptait de ce point de vue des aspects positifs. Il se souciait des conditions de vie de l’esclave et imposait beaucoup de devoirs au maître. On ne le souligne jamais, de nombreux maîtres se sont correctement comportés avec leurs esclaves, en leur permettant par exemple de cultiver leur propre lopin de terre (le Samedi Jardin). De fait, la situation de l’esclave était moins mauvaise qu’en pays protestant, et beaucoup moins mauvaise qu’en pays islamique. Mais il n’empêche : l’esclavage reste indigne pour un pays qui se disait officiellement chrétien avec un roi très chrétien. Enfin cette codification permettait aux colons de se donner bonne conscience à moindre frais. Et en ne luttant plus contre cette pratique, on la légitimait, on la justifiait et on la faisait rentrer dans les mœurs, tout en permettant des punitions terribles contre les fuyards.
Comment expliquer la différence d’attitude entre catholicisme et protestantisme vis-à-vis de l’esclavage ?
Les catholiques obéissent à une autorité, celle du pape et par ricochet aux conciles, évêques, etc., contrairement aux protestants. Boileau disait : « Tout protestant est pape, une bible à la main ». Les protestants interprètent la Bible par eux-mêmes, aidés disent-ils par l’illumination divine et par leurs connaissances religieuses. Ces interprétations divergentes expliquent pourquoi certains protestants ont légitimé l’esclavage, notamment à partir de l’histoire du rejet par Noé de son fils Cham, que l’on va voir comme noir, alors que ce n’est écrit nulle part dans le texte de la Bible. Mais vu qu’il est considéré comme noir, l’esclavage a trouvé une justification ra- ciste chez certains protestants. A l’inverse, d’autres protestants, notamment les Quakers, qui y étaient favorables au XVIIe, ont ensuite changé d’interprétation et lutté contre l’esclavage. La seconde raison tient à la haine des protestants contre tout ce qui venait de Rome, qui les conduisait à prendre souvent le contre-pied des textes pontificaux. Et cela a particulièrement vrai concernant l’esclavage.
Que dire de l’attitude en France vis-à-vis de l’esclavage au XVIIIe siècle et pendant la Révolution ?
Le XVIIIe n’a pas été très net sur la question pour plusieurs raisons. Du fait d’un affaiblissement de la foi chrétienne, mais aussi de l’attitude de nombreux prélats français : parce qu’ils sont gallicans, ils écoutent peu Rome et développent parfois un discours différent, un peu comme les protestants. Quant aux philosophes des Lumières, qui tenaient alors le haut du pavé, ils ont donné l’impression de combattre virulemment l’esclavage dans certains passages de leurs écrits, mais de façon très ambiguë en réalité, comme je le montre dans mon livre. Quant aux révolutionnaires français, ils se sont fondés sur les écrits des Lumières, avec les mêmes ambiguïtés, une certaine hypocrisie et un racisme latent. On le voit dès le début de la Révolution, avec l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme, qui déclarait le 26 août 1789 que « les hommes naissent libres et égaux en droit », mais ne supprimait pas l’esclavage. Il a fallu pour cela attendre 1794, en pleine Terreur, et la raison n’est pas humanitaire mais politique. On était en guerre contre l’Angleterre, des es- claves se révoltaient à Saint-Domingue notamment. Les Anglais s’apprêtaient à prendre la Martinique, la Guadeloupe : on avait besoin de soldats. Donc, on a fait une loi permettant de libérer ces esclaves, puis de les enrôler dans l’armée. Ce n’est pas un acte d’humanité : cette loi n’a pas été appliquée dans les îles où il n’y avait pas de menace anglaise : l’île Bourbon (la Réunion) et l’île Maurice. Puis, une fois les Anglais vaincus, les révolutionnaires imposèrent le travail forcé aux noirs qu’ils avaient libérés quelques mois avant.