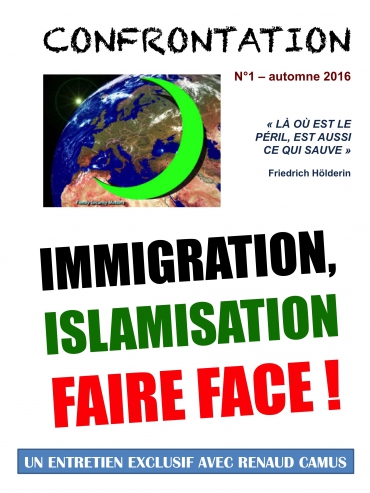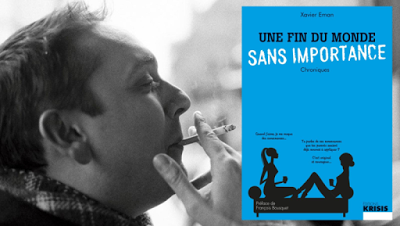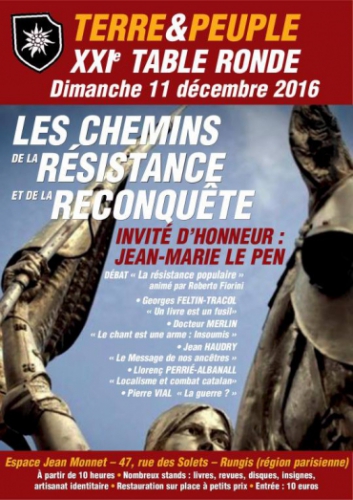Le 5 octobre 816, Louis Ier était le premier roi sacré à Reims
Quatrième fils de Charlemagne, Louis, né en 778, fut le seul roi des Francs que l’on couronna trois fois et le premier que l’on sacra à Reims. En 781, son père en fit, à Rome, le roi des Aquitains, sacré par le pape Hadrien. En 813, devenu l’aîné des Carolingiens par la mort de ses trois frères, il fut proclamé par avance empereur à Aix-la-Chapelle, encore par son père, qui disparut l’année suivante. Enfin, le 5 octobre 816, le pape Etienne IV le sacra à Reims.
Le choix de ce lieu ne devait rien au hasard mais ne visait pas pour autant à instaurer un rite. Très pieux – d’où son surnom – et, plus encore, attaché aux traces symboliques de l’Histoire, Louis avait voulu inaugurer son règne par un pèlerinage en l’église où Clovis, par l’évêque Rémi, avait été baptisé. Car il était le premier des Carolingiens à porter le nom du premier Mérovingien. Dérivé du prénom germain Hlodovic -signifiant « glorieux à la guerre » -, qui évolua en Chlodowig, fut latinisé en Lodovico puis en Ludovicus, enfin francisé en Louis.
Élu le 12 juin précédent, de façon précipitée par les cardinaux romains dont on disait qu’ils avaient ainsi voulu empêcher une intervention de l’Empereur, Étienne IV entendait, sinon se faire pardonner son élévation, du moins ne pas irriter l’empereur. C’est pourquoi, il demanda aussitôt au peuple romain de jurer fidélité au roi des Francs et empereur d’Occident. Puis il proposa à celui-ci de le rencontrer, dans un lieu à sa convenance : difficile de se monter plus conciliant. C’est ainsi que Reims, de surcroît sur la route de Rome à Aix-la-Chapelle, fut retenu.
Mais les successeurs immédiats de Louis ne suivirent pas son exemple. Charles II fut sacré à Orléans, Louis II à Compiègne, Louis III à Ferrières, Charles III à Rome. C’est Eudes qui renoua avec Reims, le 13 novembre 888 : le premier roi des Francs qui n’avait ni vocation ni prétention à la couronne impériale. C’est d’ailleurs pourquoi certains historiens regardent Eudes comme le véritable premier roi de France.
Après quoi, la cérémonie du sacre se perfectionna et enrichit peu à peu sa symbolique, concentrant trois célébrations : le couronnement, qui place le monarque au sommet de la pyramide féodale, l’intronisation, qui lui attribue le pouvoir de suprême commandement, et l’onction qui atteste que son règne satisfait la volonté divine.
En remontant au baptême de Clovis, Louis Ier avait conforté la doctrine esquissée par Grégoire de Tours, assimilant l’onction baptismale, qui donne naissance à l’homme nouveau, et l’onction royale qui, par la même grâce divine, fait d’un homme prédestiné le missionnaire de Dieu.
Archevêque de Reims écrivant à la fin du neuvième siècle la vie de Saint Rémi, Hincmar exalta le miracle de la Sainte-Ampoule, déposée par une colombe venue du ciel entre les mains de l’officiant et renfermant le Saint-Chrême lors du baptême de Clovis. Le médiéviste Jacques le Goff voyait dans cette allégorie la « contamination » de l’iconographie du baptême du Christ, au cours duquel, selon les Évangiles, l’esprit de Dieu descendit sur Jésus sous la forme d’une colombe. Le parallélisme des deux scènes était propre à frapper les imaginations empreintes de mysticisme au cours du haut Moyen-Âge. C’est pourquoi l’onction royale, cœur de la cérémonie du sacre, relève bien d’un acte divin. Un acte réservé au seul roi de France, faisant de lui un lointain successeur de David.
Le prodige de la Sainte Ampoule n’est pas non plus sans rappeler le mystère de la transsubstantiation et de la présence charnelle du Christ au cours de la Communion. Plusieurs séquences de la cérémonie du sacre se réfèrent d’ailleurs clairement à la Cène : douze pairs du royaume, tels les apôtres, soutiennent la couronne au-dessus de la tête du roi puis l’entourent lors du festin servi dans la grande salle du Tau, le palais des archevêques de Reims. Comme auprès de Jésus, ils ne constituent que des témoins : déposer la couronne sur la tête du roi revient à l’Archevêque seul, qui opère en tant qu’officier de Dieu, postérieurement à l’onction.
C’est pourquoi le décret de la Convention du 16 septembre 1793 ordonnant la destruction publique de la Sainte-Ampoule avait, lui aussi, une portée plus que symbolique : il s’agissait de supprimer l’instrument unique et inreproductible par lequel Dieu fait les rois en France. En d’autres termes, de casser le moule. C’est pourquoi aussi, afin de pouvoir procéder, en 1825, au sacre de Charles X, il parut absolument indispensable de disposer du Saint-Chrême. On établit donc qu’au terme d’un parcours rocambolesque, quelques fragments brisés de la précieuse fiole avaient été récupérés, mis à l’abri et sauvegardés, nécessairement avec l’aide de Dieu.
Plusieurs rois cependant avaient dû, dans le passé, renoncer au Saint-Chrême, soit en se faisant sacrer ailleurs qu’à Reims, siège unique de la Sainte-Ampoule, soit en ne se faisant pas sacrer du tout. Dans la première catégorie, figurent Hugues Capet, sacré probablement à Noyon en 987 (On ne sait en réalité que peu de choses de lui), son fils Robert II, sacré par avance la même année mais à Orléans, Louis VI en 1108 à Orléans toujours et Henri IV, en 1594, à Chartres. Dans ce dernier cas, on exhuma de l’abbaye de Marmoutier, fondée par Saint Martin de Tours, une autre ampoule miraculeuse, dont l’ancienneté dépassait celle de Reims : la raison d’État commandait de feindre d’y croire.
Dans la deuxième liste, on ne trouve que trois rois : Jean Ier, dit le posthume, qui ne vécut que cinq jours en 1316, Louis XVII, emprisonné et empêché de régner, et Louis XVIII, qui retarda indéfiniment la cérémonie qu’il prétendait néanmoins avoir prévue.
Mis à part les cas très particuliers de Jean Ier et de Louis XVII, il est évident que l’absence de sacre, comme de Sainte-Ampoule, n’en fit pas des monarques amputés de la moindre parcelle de pouvoir. Alors ? Quelle valeur faut-il finalement accorder au sacre et à l’onction ?
La symbolique royale française était nécessairement appelée à évoluer. D’abord perfectionnée, jusqu’au sacre de Charles V en 1364, qui introduisit dans l’ordo (le protocole de la cérémonie) une prière royale en forme de promesse et d’humilité en faveur du peuple de France (« Qu’en ce jour naisse à tous équité et justice … »), elle ne cessa par la suite de s’alourdir, de s’épaissir, de s’allonger et de se bigarrer. Le sacre de Louis XIV fut morne. Celui de Louis XV prêta au ridicule lorsqu’on fit danser des poupées afin de distraire l’enfant royal. Celui de Louis XVI s’étira comme une ennuyeuse formalité. Les courtisans se marchaient sur les pieds et les questions de préséance avaient évacué toute ferveur religieuse. Avec l’institutionnalisation du pouvoir, le roi ne tenait plus son pouvoir, ni de l’élection, ni de Dieu mais des lois fondamentales du royaume.
Après la Révolution, le sacre de Napoléon passa, au choix, pour une profanation ou pour une mascarade. Charles X voulut relever la tradition mais ruina son prestige dans ce que Chateaubriand appela « non un sacre mais la représentation d’un sacre », perturbée par de nombreux incidents parfois grotesques.
En cas de Restauration, la question du sacre ne pourrait être éludée. Sans doute est-ce dans la pureté, la finesse et la simplicité de l’ordo de Charles V « revisité » qu’il conviendrait de puiser le ciment d’un nouveau contrat entre le roi et le peuple.
Daniel de Montplaisir
http://www.vexilla-galliae.fr/civilisation/histoire/2185-il-y-a-mille-deux-cents-ans-louis-ier-etait-le-premier-roi-sacre-a-reims