culture et histoire - Page 1133
-
[Guerre de Sécession] La Guerre de Sécession - Épisode 1
-
Le roman national est une invention républicaine née de l’absence du roi
De Stéphane Blanchonnet, Président du Comité directeur de l’Action française :
 "Le roman national est une invention républicaine née de l’absence du roi. Il a fallu substituer à l’incarnation vivante de notre histoire qu’était le monarque un récit mobilisateur censé donner des couleurs et de la chair au contrat social.Cette nécessité était d’autant plus grande que s’ajoutait à l’absence du roi la destruction des corps intermédiaires (provinces, corporations), éléments également fondamentaux de l’identité française sous l’Ancien Régime. Aujourd’hui, après l’accélération du déracinement entraîné par l’exode rural, la fin des terroirs et l’américanisation, après des décennies d’immigration de masse qui disloquent d’une autre manière le corps de la nation, le roman national serait plus nécessaire que jamais. Mais c’est justement le moment choisi par la République pour l’abandonner ou plutôt pour le remplacer par un roman noir, repentant, où la France n’est plus exaltée mais rabaissée.
"Le roman national est une invention républicaine née de l’absence du roi. Il a fallu substituer à l’incarnation vivante de notre histoire qu’était le monarque un récit mobilisateur censé donner des couleurs et de la chair au contrat social.Cette nécessité était d’autant plus grande que s’ajoutait à l’absence du roi la destruction des corps intermédiaires (provinces, corporations), éléments également fondamentaux de l’identité française sous l’Ancien Régime. Aujourd’hui, après l’accélération du déracinement entraîné par l’exode rural, la fin des terroirs et l’américanisation, après des décennies d’immigration de masse qui disloquent d’une autre manière le corps de la nation, le roman national serait plus nécessaire que jamais. Mais c’est justement le moment choisi par la République pour l’abandonner ou plutôt pour le remplacer par un roman noir, repentant, où la France n’est plus exaltée mais rabaissée. Si l’Action française reconnaît la nécessité du roman national, qui apparaît, au même titre que le nationalisme, comme une sorte de régence en attendant le retour de la monarchie, elle en voit aussi les failles et les limites. Le récit proposé par la défunte IIIe République n’était syncrétiste que pour une part et tendait aussi à relativiser l’action déterminante des Capétiens dans la constitution de la France, notamment à travers la formule « nos ancêtres les Gaulois ». La France est en réalité le résultat de l’action de la dynastie nationale sur une matière première gauloise ou plutôt gallo-romaine pré-existante, mais dont la destinée aurait pu être tout autre, aucune frontière n’étant absolument naturelle comme le rappelait Jacques Bainville. Pour les maurrassiens, l’identité française se présente comme un composé dont chaque élément (le celtique, l’helleno-latin, le chrétien) compte, mais qui tire son unité et sa vitalité du mouvement organisateur initié par les Capétiens, qui ne pourra être repris durablement que par eux"
-
La java de l'identié - Docteur Merlin
-
EUROPA - Robert Steuckers
EUROPA - Robert Steuckers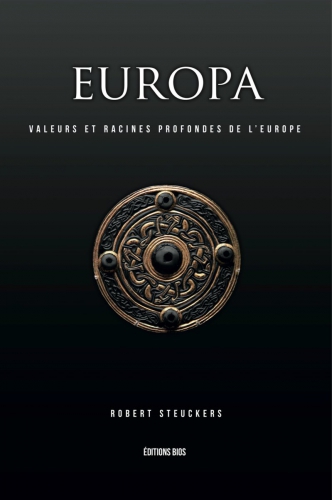
-
La bataille de la Somme - Film documentaire Première guerre mondiale
-
Alexandre Douguine: « Nous n'avons jamais été aussi proche d'une 3ème guerre mondiale »
Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, l’aspect principal de cette saison politique ne réside pas pas dans les élections, mais dans la guerre. Mais si les élections ont une importance quelque part, cela ne peut être qu’aux États-Unis où, encore une fois, elles sont étroitement liées à la guerre. Il y a deux jours, le samedi 17, Septembre, la probabilité de cette guerre a grimpé de manière vertigineuse. Comme nous le savons, les troupes américaines, qui n’ont jamais été invitées en Syrie, ont bombardé les positions de l’armée syrienne à Deir ez-Zor. À la suite de l'attaque, au moins 60 soldats syriens ont été tués.
Cette frappe était extrêmement importante pour les terroristes de l'Etat Islamique, que les États-Unis conseillent et arment de façon officieuse tout en prétendant les combattre. Ceci constitue le franchissement d’une ligne rouge. Bombarder les soldats syriens est une chose, mais cela signifie non seulement une déclaration de guerre contre la Syrie, mais aussi contre la Russie, qui se bat en Syrie du côté du gouvernement syrien légitime d’Assad. Et cela signifie aussi que nous avons atteint un point culminant.Bien sûr, le leadership américain a immédiatement signalé que le raid aérien était une erreur et a mis en garde les dirigeants russes afin qu'il n’expriment aucune émotion. Mais les Américains ne peuvent que mentir sur ce point, car la technologie moderne permet aux satellites de voir des objets à partir d’un ordinateur de bureau. Théoriquement, les bombardiers américains ne pouvaient pas se tromper de cibles. Et le plus important est que : si l’on vous avait dit qu’ils se préparaient à vous bombarder, et que vous n’avez dit rien, est-ce que cela veut dire que vous êtes d’accord?Il est tout à fait évident que les États-Unis se préparent à lancer une guerre contre la Russie. Les incidents frontaliers représentent des opérations de reconnaissance. Mais comment Moscou, Poutine, et le Kremlin réagiront-ils? Le point de non-retour n’a pas encore été franchi, mais la réaction de Moscou ne montre-t-elle pas à quel point les russes sont prêts pour une confrontation frontale directe avec les États-Unis et avec l’OTAN? C’est pour cette raison que l’attaque aérienne a été lancée contre les positions de l’armée syrienne.Le leadership globaliste américain ne peut évidemment pas gouverner le monde entier. De plus, Trump représente pour eux une menace pour leur contrôle sur l’Amérique elle-même. Le fait que la marionnette Barak Obama soit toujours en fonction et que la candidate globaliste Hillary Clinton s’effondre à vue d’œil devant les électeurs américains, représente la dernière chance de commencer une guerre. Cela leur permettrait de reporter les élections ou de forcer Trump, s’il devait gagner, à commencer sa présidence dans des conditions catastrophiques. C'est pourquoi, les élites (néo-conservateurs, globalistes) américaines ont besoin de la guerre. Et vite, avant qu’il ne soit trop tard. Si Trump obtient la Maison Blanche, il y aura la paix, et il n’y aura pas une telle guerre, ou du moins pas dans un avenir proche. Et cela signifierait la fin de l’omnipotence des élites maniaques mondialistes.Ainsi, sommes arrivé à un stade très, très grave. Les idéologues de l’OTAN et les globalistes américains, tombant dans l’abîme, ont besoin d'une guerre en ce moment, avant les élections américaines. Une Guerre contre nous (ndt: les russes). Pas tellement pour la victoire, mais pour le processus lui-même. Ceci est la seule façon pour eux de prolonger leur domination en détournant l’attention des américains et du monde entier de leur interminable série d’échecs et de crimes. Le jeu des globalistes a été révélé. Bientôt, ils vont devoir se retirer du pouvoir et comparaître devant les tribunaux. Seule la guerre peut sauver la situation.Mais qu’en est-il de nous? Nous n'avons pas besoin d'une guerre. Ni maintenant, ni demain, jamais. Jamais dans l’histoire nous n'avons eu besoin de la guerre. Mais nous avons constamment combattu et, en fait, nous n’avons presque jamais perdu. Le coût des guerres qui nous ont été imposées a été terrible et nos efforts ont été colossaux, mais nous avons gagné. Et nous allons toujours gagner. Si ce n’était pas le cas, alors aujourd’hui nous n’aurions pas un pays tellement immense et sans aucun contrôle étranger.Mais dans ce cas, nous avons besoin de gagner autant de temps que possible. Les Américains ont essentiellement attaqué nos positions, comme les Géorgiens à Tskhinvali en Août 2008. Les Russes sont sous le feu ennemi et cela ne peut être ignoré. Notre réaction est extrêmement prudente et équilibrée. Nous avons exprimé ce que nous pensons de cet acte d’agression américaine, mais en des termes très délibérées.La fatalité de la situation réside dans le fait que, si Washington décide d’opter pour la guerre maintenant, alors nous ne pouvons pas l’éviter. Si Washington insiste et répète encore et encore la situation du 17 Septembre, alors nous devrons relever le défi et partir en guerre, ou admettre sciemment notre défaite.Dans cette situation, le résultat de la lutte pour la paix qui est, comme toujours, pleinement dans notre intérêt, ne dépend pas de nous. Nous avons vraiment besoin de la paix, pour gagner du temps jusqu’au 8 Novembre, et alors tout sera beaucoup plus facile. Mais est-ce que l’effondrement du colosse va nous permettre de gagner ce temps?Dans tous les cas, notre objectif est toujours et seulement la victoire. Notre victoire.Les Américains bombardent nos gars. Une troisième guerre mondiale n’a jamais été aussi proche.Source: Katehon (Alexander Dougine, politologue russe)video en Français ici :https://gaideclin.blogspot.fr/2016/09/lanalyse-de-douguine-la-troisieme.htmlTraduction: Fawkes NewsLien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire -
Dimanche dernier, à Rungis, Marc Rousset présentait son nouveau livre : "Adieu l'argent-roi ! Place aux héros européens !"
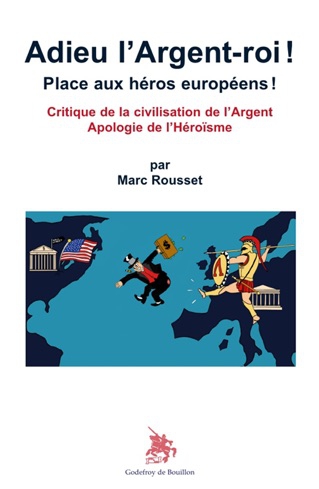 Après son livre "La nouvelle Europe, Paris-Berlin-Moscou" sorti en 2010, l'auteur se livre ici à un vraie critique de la civilisation de l'argent et nous fait une apologie de l'héroïsme
Après son livre "La nouvelle Europe, Paris-Berlin-Moscou" sorti en 2010, l'auteur se livre ici à un vraie critique de la civilisation de l'argent et nous fait une apologie de l'héroïsme
Cet ouvrage est la suite, à un siècle de distance, de « Händler und Helden » (Commerçants et Héros) écrit à Leipzig en 1915, mais jamais traduit en français, par le sociologue allemand Werner Sombart, à la lumière des réflexions sur l’héroïsme grec du regretté Dominique Venner.
L’héroïsme n’est plus une valeur directrice dans l’imaginaire européen alors que pendant quinze siècles, la pire des choses en Europe était de « préférer la vie à l’honneur et pour garder la vie de perdre la raison de vivre ». Nous vivons l’époque de la civilisation individualiste de l’argent, de la civilisation hédoniste matérialiste sans idéal, sans âme, sans courage, sans héroïsme.Selon le philosophe allemand Peter Sloterdijk, la France, comme la plupart des autres pays européens a cru bon après Mai 1968 de « sortir de l’héroïsme par le consumérisme ». Aujourd’hui la seule discrimination tolérée entre les hommes est celle de l’argent. Toutes les autres formes de discrimination nationale, ethnique, religieuse, culturelle sont devenues illégitimes.
Le carriérisme sans âme et la consommation matérialiste effrénée en guise de bonheur ont remplacé dans l’esprit de nos contemporains l’idéal, la vocation, le sens de la transcendance, du sacré, le courage, le goût de l’effort, du dépassement, du don de soi, de donner un sens plus élevé à son existence
L’homme ne peut accepter de donner sa vie que pour sa famille, une collectivité, une nation, une culture, une civilisation, une foi, une croyance. On ne meurt pas pour une société individualiste et matérialiste qui n’a rien d’autre à offrir à sa jeunesse que le sexe et l’argent.L’esprit est plus fort que la matière : c’est parce qu’elle l’a oublié que la civilisation européenne est sur le déclin. L’Europe du XXIe siècle retrouvera son âme ou disparaitra. Pour y parvenir et permettre le renouveau de la civilisation européenne, un seul moyen : une révolution conservatrice des mentalités, des valeurs et de l’éducation.
Tout au long du XXe siècle, les Européens n’ont cessé de répéter aux Américains que l’argent n’était pas tout. C’est maintenant au Vieux Continent de retrouver ses valeurs structurantes fondamentales et de mettre son ancien conseil en pratique.Selon Antoine de Saint Exupéry « Le bonheur est une récompense et non un but ». Etre heureux ne signifie pas être riche et posséder. Ce n’est pas l’argent, mais le sens que l’on donne à sa vie qui rend heureux.
Un livre de référence sur l’antinomie argent/héroïsme encore plus important à l’heure du terrorisme islamiste !Marc Rousset, diplômé H.E.C, Docteur ès Sciences Economiques, MBA Columbia University, AMP Harvard Business School, a occupé pendant 20 ans des fonctions de Directeur Général dans des groupes multinationaux. Marc Rousset collabore régulièrement à la revue Synthèse nationale.
"Adieu l’Argent-roi! Place aux Héros européens !" Critique de la civilisation de l’Argent et Apologie de l’héroïsme, Editions Godefroy de Bouillon, septembre 2016, 500 pages, 37 euros.
-
[Annonce de Vexilla Galliae ] Quand on se bat pour ses idées, …
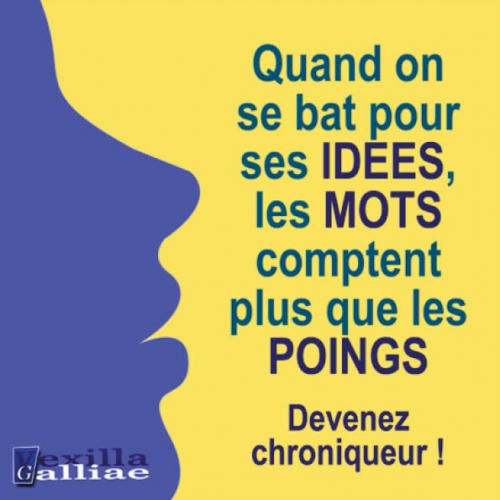
Chers amis,
Vexilla Galliae existe depuis maintenant quatre ans, et c’est aujourd’hui une équipe de plus de 30 personnes qui contribue à la visibilité et au rayonnement du principe que nous défendons tous et de l’homme qui incarne ce principe, le prince Louis de Bourbon.
Vous aussi, vous pouvez participer au combat que nous menons. Oui, vous pouvez vous lever, résister et combattre avec nous en participant au développement de Vexilla Galliae.
Rejoignez notre équipe ! Nous recherchons :
- 1 correcteur,
- 1 posteur,
- 1 maquettiste, graphiste,
- 1 caricaturiste.
Intégrez l’équipe Vexilla Galliae en devenant aussi chroniqueur !
Vous aimez rebondir sur l’actualité ? Vous avez du talent ? Un domaine d’expertise ?
Ça vous dit d'essayer ?
Vous pouvez être publié. Vexilla Galliae est toujours preneur de bons papiers.
Contactez-moi en me communiquant votre adresse courriel et téléphone. Je vous informerai de nos conditions et conseils pour la publication de vos articles.
Et surtout, vive le roi !
Dominique Hamel
Directeur de publication
d.hamel@vexilla-galliae.frVexilla Galliae : Qui sommes-nous ?
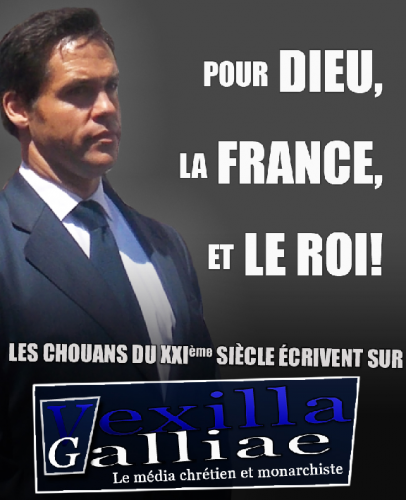
http://www.vexilla-galliae.fr/royaute/vie-des-royalistes/2180-annonce-quand-on-se-bat-pour-ses-idees
-
Contre l’école du "genre" : tous à Paris le 16 octobre !
Communiqué des Enseignants pour l'enfance :
 "La polémique sur la présence de l’idéologie du genre à l’école française a mis chacun face à ses responsabilités. A ce titre, les « Enseignants pour l’Enfance » affirment, en dépit des réfutations de Madame Vallaud-Belkacem, que cette doctrine est présente à tous les niveaux de l’institution scolaire.
"La polémique sur la présence de l’idéologie du genre à l’école française a mis chacun face à ses responsabilités. A ce titre, les « Enseignants pour l’Enfance » affirment, en dépit des réfutations de Madame Vallaud-Belkacem, que cette doctrine est présente à tous les niveaux de l’institution scolaire.Des ressources en ligne, à la disposition des enseignants, proposent des documents qui au nom de la déconstruction des stéréotypes incitent à la mise en question des identités. Des sites ouverts aux élèves offrent des supports fictionnels qui relèvent de la même démarche. Des syndicats enseignants proposent sur le sujet une prose éloquente. Des associations luttant contre l’ « homophobie » et la « transphobie » s’appuient sur le concept de genre pour entrer dans les établissements scolaires. La formation universitaire enfin, adressée à tous les étudiants et donc à de futurs enseignants, intègre ce paramètre dans certains modules. La présence du genre à l’école est donc incontestable, globale et permise par la passivité d’une institution complice.
Or cette doctrine, qui se refuse elle-même le nom de théorie, n’a rien de scientifique et ne relève que de la conviction individuelle. A ce titre, le genre est contraire à l’article 11 de la « Charte de la laïcité » qui stipule que « les personnels ont un devoir de stricte neutralité » à l’école. De même, l’imposition de ce point de vue à de jeunes personnes est une entrave à la responsabilité des parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
Pour toutes ces raisons, les « Enseignants pour l’Enfance » appellent les professeurs, les parents et les étudiants à rejoindrela grande manifestation qui aura lieu à Paris, le 16 octobre 2016. Nous refusons l’éducation au genre et demandons l’abrogation de la loi Taubira, qui en est la caution institutionnelle. Nous ne voulons pas être les agents d’une propagande imposée. L’école ne peut devenir le lieu des idéologies inculquées. Les enfants ne sauraient être les cibles d’un endoctrinement institué.
Cette école du genre ne sera jamais notre genre d’école. Nous réclamons la transparence d’un Ministère qui doit être capable de dire ce qu’il fait comme de faire ce qu’il dit. Oui aux partage des responsabilités, confiant aux parents l’éducation, aux maîtres l’instruction. Oui à une école du savoir, de la confiance et de l’exigence. Oui à une école au service des enfants. Oui à l’école des familles !"
-
DEMAIN, samedi 8 octobre 2016, colloque du Réveil français :
Le Réveil français, groupe de réflexion stratégique, organise son colloque annuel : « Culture de l’économie, économie de la culture », le samedi 8 octobre 2016. Présentation…
Olivier Dejouy : « Il faut retrouver le fil d’Ariane entre économie et culture »
http://www.actionfrancaise.net/craf/?Samedi-8-octobre-2016-colloque-du