2016 est une date historique le royaume-Uni : avec un peu de chance, les futures écoliers britanniques apprendrons que cette année-là, leur pays s’est libéré des chaînes bruxelloises, autre moment fondateur de l’histoire anglaises et de sa monarchie : 1066, une victoire normande… dont on fête cet automne le 950e anniversaire.
Son nom est connu dans la France entière. On l'imagine guerrier et conquérant, à la proue de son navire cinglant vers l'Angleterre. Assurément, le duc Guillaume est l'un de nos héros. Régnant éternellement sur notre familière Normandie, il peuple notre inconscient national. Pour autant, est-il un véritable héros national ? Rien n'est moins sûr.
Guillaume n'est pas véritablement français ; du moins, pas selon l'acception moderne. L'Europe qui voit naître le futur vainqueur d'Hastings,vers 1027, est celle de la féodalité : le duc de Normandie est vassal du roi de France, mais un vassal remuant. Les ducs normands ont de qui tenir : leurs racines sont Scandinaves.
Du premier d'entre eux, Rollon, qui est en quelque sorte le Clovis normand (la vision christique en moins !), nous ne savons que peu de choses. Danois ou Norvégien, qu'importe, Rollon était un de ces cadets de famille Scandinaves partis chercher fortune au-delà des mers. Tandis que ses pairs fondaient Dublin, régnaient sur York et colonisaient l'Islande, Rollon, lui, fonda une principauté en Neustrie, chez les Francs. Las des pillages, le roi Charles le Simple lui octroya, lors d'une entrevue à Saint-Clair-sur-Epte en 911, un territoire allant de l'Epte à la mer. Selon Jean de la Varende, auteur d'une biographie dédiée au Conquérant, « loin d'être une capitulation lâche, c 'était une intelligente concession : les pirates, de voleurs, devenaient gendarmes ». La Normandie voyait le jour.
Quand les voleurs devenaient gendarmes
Un siècle sépare Rollon de Guillaume, mais un même sang coule en leurs veines. Guillaume sera, lui aussi, un fondateur, un conquérant.
Mais avant cela, il est d'abord un bâtard, né des amours clandestines du duc Robert le Magnifique et de sa concubine Ariette. Le bâtard devient duc à huit ans et doit batailler contre de puissant ennemis : le roi de France, son suzerain ; et ses propres vassaux normands, les barons. Ces derniers seront vaincus en 1047 à Val-ès-Dunes. Symbole entre tous : les félons chargent au cri de « Thor Aie ! », invoquant sur eux la bénédiction des antiques divinités Scandinaves. Dans les rangs de Guillaume, un tout autre cri émeut les poitrines : « Diex Aïe ! ». La Normandie chrétienne a triomphé de son propre vieil homme païen. On verra le duc, tout au long de son règne, soutenir l'Église, faisant construire l'Abbaye aux Hommes et celle aux Dames, assistant à la dédicace des cathédrales de Rouen ou de Bayeux, Guillaume, le bâtard bâtisseur, est d'abord, selon l'expression de La Varende, « le vainqueur de la Normandie » : « vainqueur des bandits, vainqueur des grands, des rois, vainqueur de lui-même ; et, parti d'une nation restreinte, devenant maître de l'Angleterre, fondateur de l'Europe moderne, aïeul de tous les princes », Le vent de l'Histoire souffle déjà, qui gonfle les voiles du conquérant.
L'Angleterre du XIe siècle, contrairement à la Normandie, n'est pas sortie du cycle de violences et d'intrigues entre princes locaux et pillards Scandinaves. Un viking, Knut de Danemark, est brièvement roi d'Angleterre de 1040 à 1042. Il invite son demi-frère Edouard, mi-anglais, mi-danois, à régner avec lui comme co-régent. Edouard lui succédera et régnera de 1042 à 1066 sous le pieux nom d'Edouard le Confesseur. ; il sera canonisé. Sans descendance, le roi désigne un successeur : un cousin, Guillaume de Normandie. En d'autres termes : un étranger.
La félonie d'Harold
Les nobles saxons ne l'entendent pas de cette oreille. L'un des leurs, Harold Godwinson, prétend avoir été choisi par le défunt roi, sur son lit de mort, pour lui succéder. Couronné le lendemain, il doit rapidement troquer son sceptre pour l'épée, car une invasion norvégienne menace ses côtes. Une seconde invasion, normande celle-là, est en préparation de l'autre côté de la Manche. Le duc Guillaume est furieux de voir ses droits bafoués ; il faut dire qu'Harold Godwinson, qui connaît bien le duc pour avoir combattu à ses côtés contre les Bretons, s'était engagé, par serment, à servir le Normand. Bafouant une parole donnée sur reliques, voilà Harold devenu parjure. Guillaume a le droit pour lui et obtient le soutien du pape Alexandre II, qui ne peut souffrir le parjure d'Harold. Le duc reçoit un étendard pontifical et le hisse au mat de son navire. Une troupe nombreuse - six-cents navires, plus de sept mille hommes-, mêlant Normands, Bretons et Flamands, se rassemble autour du duc de Normandie afin de participer à la grande expédition qui s'élance de Dives-sur-Mer et doit transiter par le port picard de Saint-Valéry-sur-Somme, en raison d'une tempête. Le désagrément n'est que passager et l'Armada continentale foule le sol anglais le 28 septembre 1066. L'armée d'Harold accourt vers le Sud, épuisée car elle vient à peine de combattre et de vaincre les troupes norvégiennes à Stamford Bridge, au nord du pays. Face à des Saxons à bout de souffle, Guillaume a déjà débuté sa conquête méthodique. Il se retranche et choisit le lieux de l'affrontement : ce sera Hastings, dans le Sus-sex oriental. Que dire de la formidable mêlée mettant aux prises Saxons et Normands, le 14 octobre 1066 ? La scène est magnifiquement rendue par la tapisserie de Bayeux, fascinante bande-dessinée longue de soixante-dix mètres, composée par des moines anglais après la Conquête. On sait que les chevaliers normands ont eu recours à la ruse, feignant la retraite, pour mieux se retourner contre les Saxons et créer des brèches dans leurs murs de boucliers. La mêlée est incertaine. On croit Guillaume perdu, mais le duc relève son heaume sur son crâne pour se faire reconnaître et ragaillardir ses hommes. Son ennemi Harold aura moins de fortune : la tradition normande le représente gisant, une flèche dans l'œil. Privés de leur chef, les Saxons fuient les combats et ouvrent la voie de Londres aux envahisseurs. La conquête est loin d'être terminée pour Guillaume qui, après avoir obtenu la soumission de l'archevêque londonien, est couronné à la Noël. Singulière cérémonie qui voit les chevaliers normands, suspicieux, dévaster les environs de Westminster. Lorsque Guillaume prête serment en langue saxonne, la nef de l'abbaye est presque vide. La pacification, doux euphémisme pour une conquête âpre, ne s'achèvera qu'en 1070.
Vae victis ! Le vainqueur impose sa loi : l'anglais disparaît des textes officiels au profit du latin. La cour et la bonne société adoptent le français ou, plutôt, le normand. La féodalité continentale investit l'île qui, d'un point de vue foncier, tombe entre les mains des chevaliers normands et bretons ayant accompagné Guillaume. La géopolitique anglaise est bouleversée : il aura fallu l'invasion d'un descendant de pirates normands pour que l'Angleterre échappe à son vieux tropisme Scandinave. La Conquête normande tourne en effet le regard de l'Angleterre vers le continent et, pour les Anglais, la Manche et les côtes de l'Atlantique deviennent un véritable mare nostrum ; une situation qui ne prendra fin qu'avec l'expulsion des Anglais de Bordeaux en 1453.
Naturellement, la conquête de l'Angleterre sera célébrée cette année en Normandie. On fête l'enfant du pays qui, selon La Varende, « couvre toute la province de sa haute stature et de son ombre gigantesque, qui s'allonge et se meut, fouillant tous les coins de notre terre ». « Le moins mort de nos héros », dit encore l'auteur des Manants du Roi à propos du duc dont la devise, brodée en lettres d'or sur la Tapisserie de Bayeux, n'est autre que Viriliter et sapienter. Il y a peut-être là une belle occasion de renouveau identitaire pour la Normandie, heureusement réunifiée depuis quelques mois. Puisse le 950e anniversaire d'Hastings redonner aux Normands la conscience de leur être, l'amour de ce « pays fièrement beau, sombre, grand et idéal » (Barbey d'Aurevilly), loin d'une pseudo-identité bricolée par les Parisiens et les touristes, où la Normandie se réduirait à un drakkar fantasmé, des pis de vache rose bonbon et des barges de débarquement américaines.
Les Anglais ont la mémoire longue
Mais surtout, il y a l'Angleterre. La bataille d'Hastings est aussi un problème pour la mémoire anglaise : est-ce une victoire ou une défaite ? Faut-il célébrer la victoire normande, ou se féliciter que les Saxons - les "vrais anglais" aient survécu ? Il n'en demeure pas moins que 1066 est là date choisie par Bernard Cottret, grand spécialiste de la matière, pour débuter sa magistrale Histoire de l'Angleterre (Tallandier). Victoire ou défaite, Hastings reste un drame fondateur auquel les Anglais devront revenir. Avec le Brexit, les Britanniques ont décidé de reprendre le pouvoir (« take back control »), de recouvrer leur souveraineté et de faire prévaloir le Parlement et le droit anglais sur Bruxelles. Mais tout cela n'a pas grand sens si les Anglais ne renouent pas avec leur identité propre et leurs épopées nationales. Une anecdote significative des traces de 1066 dans la culture politique anglaise ? Lorsqu'un projet de loi est adopté par le Parlement de Westminster, il lui faut l'approbation - toute théorique - du souverain pour que le texte soit promulgué définitivement. La formule consacrée est alors « Le Roy le veult », expression normande tout droit issue de la Conquête. Le patriotisme anglais, on le voit, ne peut faire l'économie du roi Guillaume. Nigel Farage, héraut de la souveraineté britannique, l'a bien compris, arborant volontiers une cravate très kit'sch aux motifs issus de la Tapisserie de Bayeux... La Reyne le veult, Dieu sauve la Reyne !
Thibault Bertrand monde&vie 1er septembre 2016
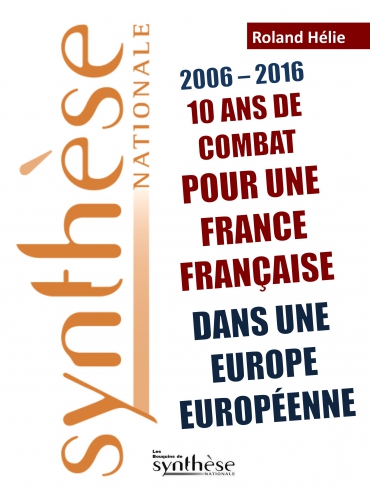
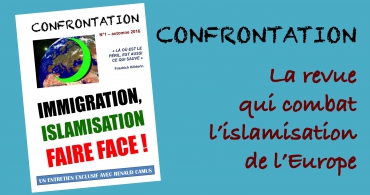


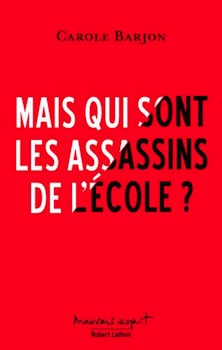 Mais qui sont les assassins de l’école ? (Robert Laffont) se demande Carole Barjon. Rassurons tout de suite le lecteur : à cette question l’auteur répond en alignant nommément tous ceux qui, depuis quarante ans, ont empilé réforme sur réforme, affirmations hasardeuses sur certitudes accablantes afin que nos enfants, comme le prédisait Marc Le Bris en 2004, ne sachent plus lire ni compter.
Mais qui sont les assassins de l’école ? (Robert Laffont) se demande Carole Barjon. Rassurons tout de suite le lecteur : à cette question l’auteur répond en alignant nommément tous ceux qui, depuis quarante ans, ont empilé réforme sur réforme, affirmations hasardeuses sur certitudes accablantes afin que nos enfants, comme le prédisait Marc Le Bris en 2004, ne sachent plus lire ni compter.